PARUTIONS RECENTES
Dans le désordre, et juste pour le plaisir de partager et de faire connaître quelques livres qui ont retenu mon attention. Ouvrages sur les médias, la radio, la télévision, Internet, les nouveaux médias. Ouvrages scientifiques, ou ouvrages de fiction ou de prise de position. Je ne suis pas toujours d'accord, j'aimerais parfois chicaner sur un propos, une date, une lacune. Peu importe : ces livres valent la peine d'être lus ou consultés. Je n'ai malheureusement pas le temps de rédiger des notes de lecture pour chacun des ouvrages que j'ai trouvé intéressants. Je me contente ici de reproduire les quatrièmes de couverture.
N'hésitez pas à me faire connaître vos publications (écrire à a.lange@uliege.be)
André Lange
Sylvain Athiel
L'histoire secrète des grandes radios pyrénéennes
Privat, 2026
Saviez-vous que l’Occitanie et l’Andorre furent le théâtre d’une impitoyable bataille des ondes ? Cet ouvrage plonge le lecteur au cœur d’une aventure captivante et méconnue.
Si, dès les années 1920, Radio Toulouse s’impose comme un média européen incontournable par son influence et son rayonnement, l’histoire se poursuit avec la création de Radio Andorre, marquée par des péripéties rocambolesques, illustrant l’audace et la ténacité des fondateurs. La deuxième partie du livre s’intéresse à la naissance de Sud Radio, projet ambitieux initié dans un contexte de rivalités politiques et de manœuvres diplomatiques, alors que le peuple andorran aspire à l’émancipation.
De l’émergence de ces stations historiques à leur extinction, ce récit met en lumière intrigues, complots et personnages hauts en couleur. Avec la précision de l’enquêteur et le regard du professionnel passionné, l’auteur restitue, dans le majestueux décor des Pyrénées, une fresque haletante couvrant près d’un siècle d’histoire de la radio.
.
John Wyver
Magic Rays of Light
The Early Years of Television in Britain
Bloombury Publishing / BFI, 2026
On the evening of 26 January 1926, inventor John Logie Baird held a public demonstration in his workspace on London's Frith Street of a 'seeing by wireless' apparatus that he and many others had been working towards, television. In the years that followed, variants of this astonishing device produced programming that was rich, complex and excitingly imaginative. Familiar television genres, including studio drama, quiz shows, variety spectaculars and sports broadcasts, were all fully realised in the 1930s. At the same time, early television was often strikingly different from later domestic broadcasting.
Television began with intimate entanglements with interwar cinema, theatre, music and dance. And, despite reaching only tiny audiences, from its beginnings television responded to key strands of social history, embracing legacies of the Great War, changing roles for women, suburban living and more.
Magic Rays of Light is a unique and comprehensive cultural history of early television, exploring its technologies and institutions, while also celebrating the programmes and the people, the ideas and the innovations of the first decade of what would become the most consequential medium of the subsequent century.
Bruno Ruiz
Horace Hurm. Le kalédioscope de sa vie
2ème édition revue et corrigée, à compte d'auteur, 2025
Concertiste et Professeur de Hautbois, Magicien, Inventeur au Concours Lépine, Représentant en produits Pharmaceutiques, Constructeur de Radio-TSF, fabriquant d’aiguille en bambou pour le phonographe, Historien sur le phonographe, poète, dessinateur, peintre photographe et pigiste du » Vieux Montmartre », etc.
Cet ouvrage, ne parle pas que de Radio TSF, il traverse l’histoire avec les moments importants de la vie d’Horace Hurm depuis sa naissance en 1880 jusqu’à son décès en 1958.
L’Exposition Universelle de 1889, bien évidemment, qui marqua profondément Horace Hurm, mais également, cette journée du 14 avril 1931 lors de la première transmission « Officielle » de la Télévision Française ou Horace Hurm était présent à côté de René Barthélemy.
C’est toute l’histoire en cette fin du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e siècle des débuts des télécommunications qui est évoquée.
Le documentaire est aujourd'hui partout : sur nos écrans de télévision, bien sûr, mais aussi, plus largement, sur l'ensemble des services de médias audiovisuels et sur les plateformes. Cette démultiplication ne va pas sans de nouveaux formats, de l'unitaire au sériel, de la télévision au cinéma, des festivals aux chaînes YouTube. Les documentaires sont aujourd'hui aux prises avec des enjeux esthétiques et artistiques, politiques et éditoriaux, ou encore professionnels et économiques.
Pour saisir ces migrations et l'expérimentation de formats nouveaux qui élargissent la définition même du documentaire, les auteurs réunis dans ce dossier étudient des objets variés, traçant de nouveaux contours : l'aventure d'un youtubeur parti à la conquête de l'Everest, la projection futurologique de la première expédition martienne, la mémoire de la guerre d'Algérie, les commémorations des attentats du 13-Novembre ou encore le handisport. Ce faisant, ils proposent une mixité d'approches, de méthodologies et de terrains.
Toutes ces productions documentaires démultipliées ont malgré tout en commun de constituer un genre élargi d'expériences spectatorielles du monde, adapté à la diversité des médiatisations actuelles.
À la croisée de l’histoire de l’art et des études de médias, cet ouvrage retrace une archéologie des écrans interactifs à travers une étude de la tradition nord-américaine dite de la Mobile Color. Entre les années 1910 et le début des années 1970, ce terme décrit de nombreux appareils chromolumineux, inventés et envisagés par leurs créateurs comme les supports techniques d’un médium inédit de création, d’un tout nouvel art visuel. Si la Mobile Color est certes en position de minorité au sein de l’écologie médiatique de la modernité, elle ouvre la lignée explorant la voie de l’interactivité iconique.
Revue générale
N°2025/3- Novembre 2025
Dossier / Paul Valéry toujours recommencé
Avec les contributions de Jan Baetens, Jean Claude Bologne, Julien Boulanger, Michel Brix, Bruno Colmant, Laurence Dahan-Gaida, Luc Dellisse, Francis Delpérée, Pascal Durand, Rémi Furlanetto, Sylvain Gouguenheim, Olivier Houdé, Jean Jauniaux, Félix Katikakis, Robert Kopp, Jean Lacroix, André Lange, Paul Magnette, Philippe Marchandise, William Marx, Atsuo Morimoto, Benoît Peeters, Frédéric Saenen, Pierre Somville et Myriam Watthee-Delmotte
On y trouvera un article d'André Lange, "Paul Valéry, témoin privilégié de l'invention de la télévision", analysant la visite de l'écrivain, en 1928, à Fernand Holweck, qui fut le premier, à l'Institut du radium de Marie Curie, à réussir la transmission d'images sur tube cathodique. Valéry fut également l'hôte d'un colloque international sur la télévision qui se tint à Nice en 1935, présidé par Louis Luimère et auxquels participaient notamment les inventeurs John Logie Baird et René Barthélemy. L'intérêt de Valéry pour la radio et la télévision ne l'empêcha pas de se montrer très sévère à l'égard du rôle des moyens de communication de masse dans la société.

Le téléphonoscope n°32
Robida, homme de presse
Articles par Philippe Brun, Dominique Lacaze, Michel Thiébaut, Laurent Antoine.
Association des Amis d'Albert Robida
Pendant un demi-siècle, du Journal amusant en 1866 jusqu’en 1920 avec les Annales politiques et littéraires, Robida a écrit et dessiné pour environ 70 périodiques. C’est dire que ce voyageur dans le temps, passé et futur, est aussi un homme de son temps sur lequel il promène en général un regard amusé et satirique. Ce nouveau numéro du Téléphonoscope propose sept articles retraçant l'activité de Robida durant plus d'un demi-siècle.

Ian Christie
What Made Cinema ? Essays on Visuall Culture and Early Films
Sticking Place Books, 2025
"Immersion" is everywhere in entertainment today. But this promise didn't start with digital media - it was over two hundred years ago that Georgian London became the world centre of such immersive spectacles as the Leicester Square Panorama, the Eidophusikon's magical moving pictures with music, and a hundred years later, cinema itself was born in the capital's giant music halls. No - not in Paris or New York, but first and foremost at the Empire and the Alhambra in Leicester Square.
In essays written across thirty years, Ian Christie explores how these novelties gave London an appetite for media innovation, with the earliest film studios ringed around the city - as their successors are once again. Discover Queen Victoria as a connoisseur of early photography, Fred Karno as the architect of slapstick comedy, and how Ancient Rome was reborn on screen, giving cinema its first box-office hits.
Having written The Last Machine, Terry Gilliam's 1994 series for BBC Television that marked the centenary of moving pictures, and a prize-winning 2019 book about Britain's overlooked film pioneer Robert Paul, Ian Christie adds a fresh account of how early cinema opened new windows onto the 20th-century world, drawing on new digital access to many of its treasures and curiosities.

Richard TAWS
Time Machines: Telegraphic Images in Nineteenth-Century France,
MIT Press, 2025
In Time Machines Richard Taws examines the relationship between art and telegraphy in the decades following the French Revolution. The optical telegraph was a novel form of visual communication developed in the 1790s that remained in use until the mid-1850s. This pre-electric telegraph, based on a semaphore code, irrevocably changed the media landscape of nineteenth-century France. Although now largely forgotten, in its day it covered vast distances and changed the way people thought about time. It also shaped, and was shaped by, a proliferating world of images. What happens, Taws asks, if we think about art telegraphically?
Placed on prominent buildings across France—for several years there was one on top of the Louvre—the telegraph’s waving limbs were a ubiquitous sight, shifting how public space was experienced and represented. The system was depicted by a wide range of artists, who were variously amused, appalled, irritated, or seduced by the telegraph’s intractable coded messages and the uncanny environmental and perceptual disruption it caused. Clouds, architecture, landscapes, and gestures: all signified differently in the era of telegraphy, and the telegraph became a powerful means to comprehend France’s technological and political past. While Paris’s famous arcades began to crisscross the city at ground level, a more enigmatic network was operating above. Shifting attention from the streets to the skies, this book shows how modern France took shape quite literally under the telegraph’s sign.
VIEW
Volume 14 - Issue 28 - 2025
With and Against the Grain: Creative Dialogues with Broadcast Archives
Edited by Bas Agterberg, Lisa Kerrigan, Dana Mustata & Alistair Scott, members of the Media Studies Commission of the International Federation of Television Archives FIAT/IFTA.
This special issue foregrounds creative forms of television history writing. It shines a light on experimental and imaginative modes of engaging with and being in dialogue with broadcast archives. The creative tenets of this special issue seek to challenge norm-bound conventions of academic writing and in doing so, broaden the horizon of what counts as knowledge production in television scholarship. Equally, silences, structural power differentials and inequalities in archive-based knowledge production are probed and broken open. The issue features contributions by media scholars, artists, media practitioners and broadcast archivists.
Pascal Kamina
Droit de la communication audiovisuelle et numérique : Télévision, Radio, Services à la demande, Plateformes numériques, Deuxième édition
LGDJ, 2025
Cet ouvrage présente l'ensemble de la réglementation applicable aux services de télévision et de radio, aux services audiovisuels à la demande et aux plateformes de partage de contenus audiovisuels.
Destiné principalement aux professionnels du droit et du secteur de la communication audiovisuelle et numérique (avocats, juristes d'entreprises...), il traite ainsi :
-
la liberté de communication et les principes de pluralisme, d'indépendance et de neutralité
-
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
-
l'audiovisuel public
-
la diffusion et la mise à disposition des services
-
les obligations des éditeurs et des distributeurs de services
-
les obligations des distributeurs de services
-
les systèmes d'accès conditionnel
-
les plateformes de partage de contenus audiovisuels
-
la protection des services de communication audiovisuellePoints forts
Un ouvrage complet et pratique sur un secteur en évolution permanente À jour des derniers textes et des projets de réforme en cours, au niveau national et européen, notamment celui portant sur le service public de l'audiovisuel
VIEW
Volume 14 - Issue 27 - 2025
Echoes and Frequencies: Tele-Visions and Wireless Technologies 19th-21st Centuries
Edited by Léa Dreyer, Evgenii Kozlov, Pierre J. Pernuit, Clara M. Royer & Anne-Katrin Weber.
This issue investigates the layered temporalities, shifting modalities, and evolving infrastructures of tele-visions – a plural, hyphenated term designating the spectrum of remote viewing technologies that have shaped, and continually reshape, how images travel and appear across distances. From early optical telegraphs and nineteenth-century electromagnetic signal relays to today’s ubiquitous digital environments, these systems condition how we think about, imagine, and experience the televisual. One element emerges as a particularly fruitful entry point into the archeology of tele-visions: the wireless. In many ways, the integration of Hertzian waves into telecommunications at the close of the nineteenth century marked an epistemic shift – a profound reordering of the technical, perceptual, and conceptual frameworks through which reality is organised and understood. The present issue explores the historical, technical, and artistic dimensions of that transformation, which, beyond the mere absence of cables, ushered in a new media paradigm whose political, philosophical, and environmental ramifications continue to be redefined with each successive wave of wireless innovation.
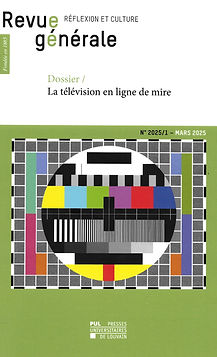
Revue générale
N°2025/1 - Mars 2025
Dossier / La télévision en ligne de mire
Il y a 125 ans, à l'occasion du Congrès international d'éléctricité qui a eu lieu à Paris dans le cadre de l'Exposition universelle de 1900, l'ingénieur russe Constantin Perskyi présentait une communication "Télévision au moyen de l'électricité" qui marquait la première apparition du terme "télévision" en français. Cet appreil révolutionnaire a marqué, voire modelé, les esprits de plusieurs générations d'"enfants de la télé", depuis l'après-guerre jusqu'à l'orée du XXIe siécle.
Un dossier coordonné par Frédéric Saenen, avec des approches très diverses d'un médium qui n'a pas dit son dernier mot. Inclut notamment un entretien "2000 ans de télévision" entre Frédéric Saenen et André Lange, directeur du site Histoire de la télévision.
Mireille Lusienne Zena
Télévision et santé : Conditions de production des émissions télévisées de santé à Kinshasa
Editions L'Harmattan, 2025
On the evening of 26 January 1926, inventor John Logie Baird held a public demonstration in his workspace on London's Frith Street of a 'seeing by wireless' apparatus that he and many others had been working towards, television. In the years that followed, variants of this astonishing device produced programming that was rich, complex and excitingly imaginative. Familiar television genres, including studio drama, quiz shows, variety spectaculars and sports broadcasts, were all fully realised in the 1930s. At the same time, early television was often strikingly different from later domestic broadcasting.
Television began with intimate entanglements with interwar cinema, theatre, music and dance. And, despite reaching only tiny audiences, from its beginnings television responded to key strands of social history, embracing legacies of the Great War, changing roles for women, suburban living and more.
Magic Rays of Light is a unique and comprehensive cultural history of early television, exploring its technologies and institutions, while also celebrating the programmes and the people, the ideas and the innovations of the first decade of what would become the most consequential medium of the subsequent century.
Jonas Charles Ndeke
Télévisions et médias sociaux au Congo : Appropriation de l'information et espace public (1990-2018), 2 volumes
Editions L'Harmattan, 2024
L'information circule aujourd'hui à travers les espaces de communication traditionnelle, classique, et suprana-tionale. L'auteur questionne dans ce deuxième volume l'appropriation de l'information à travers les J.T. des chaînes nationales, transnationales et des médias sociaux. Il s'appuie sur 400 questionnaires administrés aux téléspectateurs et internautes congolais.
Quel est l'impact du contexte de réception de l'information ? Comment se fait l'appropriation de l'information au Congo ? Quels sont les types d'espace public en jeu et comment fonctionnent-ils ?
Ce livre s'adresse aux étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs, professionnels des médias, décideurs politiques et structures actives dans l'appui des médias africains.
Laurence Leveneur
Mythes et réalités de la télévision sociale : La télé et les réseaux sociaux
INA, 2024
Comment les chaînes de télévision fabriquent-elles l'audience sociale ?
Enrichir les contenus, interagir avec les téléspectateurs, engager les communautés : telles étaient les promesses de la « télévision sociale », qui devait prolonger - sinon sauver - le petit écran.
À l'heure où l'audience n'est plus mesurée au nombre de téléspectateurs mais à la quantité de clics, de réactions et de commentaires sur les réseaux sociaux, les chaînes luttent à armes inégales non seulement avec les plateformes mondiales, mais aussi avec des dispositifs qui imposent leurs logiques de captation de l'attention.
En étudiant les stratégies de communication de TF1, France 2 et M6 sur Facebook, Instagram et Twitter, Laurence Leveneur-Martel revient sur les ambitions qui poussent les chaînes à investir ces espaces, tout en y maintenant une image de marque cohérente et en y valorisant leurs antennes autant que leurs offres délinéarisées.
En questionnant l'analyse quantitative des réactions en ligne, ce livre invite à une réflexion sur les relations nouvelles qui unissent les publics à la télévision ; enfin, il nous interroge : qu'appellerons-nous demain « télévision » ?
Laurence Leveneur-Martel est maîtresse de conférences en Sciences de l'information et de la communication à l'IUT de Rodez (Université de Toulouse Capitole).
Ce livre est issu d'un mémoire d'habilitation à diriger des recherches qui a reçu la mention au prix de la Recherche de l'INAthèque (2023).
Francis Balle, Alexandre Joux
Médias et sociétés : Internet, Presse, Edition, Cinéma, Radio, Télévision (19e édition)
LGDJ 2024
Cette nouvelle édition de Médias et sociétés a été entièrement refondue. Aujourd'hui coécrite par Francis Balle et Alexandre Joux, elle reste fidèle à l'approche qui a fait l'originalité de l'ouvrage, tout en la modernisant :
une approche pluri-médias : médias traditionnels et numériques, imprimés, audiovisuels ou en ligne
dans une perspective pluri-disciplinaire: juridique, historique, technique, sociologique, économique
Destiné aux étudiants de master et aux professionnels du droit et des médias, l'ouvrage met l'accent sur :
-
les bouleversements récents amenés par le numérique et l'internet, aujourd'hui dopés par l'intelligence artificielle
-
le passage du CSA à l'Arcom en France
-
la régulation européenne et américaine à l'encontre des GAFA
-
la politique à l'ère des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu
-
les enjeux du journalisme et de l'information
Points forts :
-
Des chronologies récurrentes sur les médias pour mieux situer certaines notions dans le temps
-
De nombreux schémas et tableaux pour saisir d'un coup d'oeil certains aspects des médias
Christophe Bigot
Pratique du droit de la presse : Presse écrite édition - télévision - radio - Internet (édition 2025-2026)
Dalloz, 2025
Tout le droit de l'expression publique : presse écrite, édition, télévision, radio, Internet et réseaux sociaux.
L'information, et plus généralement l'expression publique, sont des activités encadrées par de nombreuses règles. La première d'entre elles et la plus emblématique est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui représente l´approche d´un compromis optimal entre l'exercice de la liberté fondamentale de l´information et la protection des droits des personnes. Son principe de liberté, limité par des incriminations précises (la diffamation, l´injure, la provocation à la discrimination ou la haine...) et ses mécanismes de régulation de l´information, tels que les droits de réponse et de rectification, restent une référence. Cette loi a su s'adapter aux problématiques nées des nouvelles technologies et des nouveaux médias et à leurs formes d´expression inconnues jusqu´alors, et régit l´ensemble du monde de la communication.
Mais d'autres textes ont également une grande importance. Il en va ainsi des droits de la personnalité, notamment la protection de la vie privée et de l'image, dont le contentieux n'a cessé de croître depuis l'introduction de l'article 9 du Code civil en 1970. Il ne faut pas non plus oublier les multiples infractions régissant l'expression publique qui figurent dans le Code pénal ou le dénigrement qui relève de l'action en responsabilité civile. Cet ensemble hétéroclite est en outre menacé depuis peu par l'hégémonie du droit des données personnelles, qui voudrait s'imposer comme instrument de régulation des contenus dans l'univers numérique.
Enfin, notre droit de l´information s´envisage aujourd´hui autant dans un cadre purement national que dans le contexte d´un droit européen très riche résultant de l´application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, exigeant du juge qu'il renouvelle ses pratiques, pour tenir compte de notions telles que l'intérêt général ou le principe de proportionnalité.
Tous ces aspects sont traités et abondamment illustrés dans ce livre qui embrasse l'intégralité du droit de la presse. Cette cinquième édition est enrichie de nouveaux développements sur la communication au public en ligne, sur l'impact de l'intelligence artificielle générative et tient compte des textes les plus récents, notamment les règlements européens dits DSA et EMFA, et la loi SREN du 31 mai 2024.
Il s'agit au premier chef d'un véritable manuel pratique et pédagogique destiné aux professionnels de la presse et à tous les praticiens du droit : avocats, magistrats, juristes d´entreprises, mais l'auteur n'hésite pas non plus à aborder en profondeur des questions plus théoriques qui intéresseront enseignants et étudiants.
Christophe Bigot est avocat au barreau de Paris, membre du comité éditorial de la revue Légipresse, et commentateur régulier du droit de la presse dans des revues de référence. Il nous livre ici le fruit de trente-cinq années de pratique quotidienne du droit de la presse pour le compte des médias les plus divers, d'entreprises et de personnalités de tous horizons.

VIEW
Volume 13 - Issue 26 - 2024
Archive Television
Storing, Structuring and Accessing Audiovisual Content in the Time of Algorithmic Curation
Edited by Giulia Taurino & Georgia Aitaki
The new VIEW journal issue #26: Archive Television: Storing, Structuring and Accessing Audiovisual Content in the Time of Algorithmic Curation, edited by Giulia Taurino & Georgia Aitaki is online!
This VIEW Journal special issue covers algorithmic curation and its impact on television archiving. It explores how evolving media technologies, streaming platforms, and algorithms shape audiovisual heritage, raising challenges and opportunities for preservation and access.
Taking a historical perspective, it examines the fragmented nature of European television archives and the role of digital and algorithmic practices in shaping cultural identity and collective memory.
The issue highlights the need for collaboration between archivists and media scholars to address the complexities of audiovisual archiving in a data-driven era, ensuring the longevity and accessibility of television content.
Qu'est-ce qui fait que nous aimons tant les K-dramas ? Au-delà de leur grande qualité esthétique, ces séries télé, à la différence de leurs homologues américaines, réenchantent le lien social et nous offrent des récits dans lesquels l'amitié, l'amour, les liens familiaux et professionnels permettent de s'épanouir, de faire face aux inégalités et aux discriminations et de surmonter les épreuves.
En accompagnant le lecteur dans la découverte des scénarios de K-dramas célèbres, les auteurs révèlent les trames d'un lien social désirable, où l'émancipation de l'individu n'est pas contradictoire avec le bonheur collectif.
Thierry Moreau
Télé 7 Jours, de l'ORTF à la TNT : Une histoire de la télévision,
Casa Editions 2024
La télé française est une vieille dame octogénaire qui ne fait pas son âge. Cet ouvrage en retrace l'histoire mouvementée. Une histoire qui s'enracine avant-guerre, mais ne prend son élan qu'à la Libération grâce à ses pionniers avec la création de la RTF, alors qu'on ne compte qu'une centaine de postes de télévision dans tout le pays. Dix ans plus tard, il y en avait déjà un million. Nous avons voulu dégager avant tout les grandes étapes qui ont marqué et modelé cette histoire en mettant en perspective les lignes forces et les mutations successives de son évolution avec ses particularités. Pour cela nous nous sommes appuyés sur le magazine Télé 7 jours parce qu'il s'est très vite imposé comme le magazine de référence par le pari pris dès sa création en 1960 de se focaliser sur le monde et sur les personnalités de la télévision participant de façon décisive à leur immense popularité

Eleanor Patterson
Bootlegging the Airwaves: Alternative Histories of Radio and Television Distribution,
University of Illinois Press, 2024
IAMHIST-Michael Nelson Book Prize for 2025
How fan passion and technology merged into a new subculture
Long before internet archives and the anytime, anywhere convenience of streaming, people collected, traded, and shared radio and television content via informal networks that crisscrossed transnational boundaries.
Eleanor Patterson's fascinating cultural history explores the distribution of radio and TV tapes from the 1960s through the 1980s. Looking at bootlegging against the backdrop of mass media's formative years, Patterson delves into some of the major subcultures of the era. Old-time radio aficionados felt the impact of inexpensive audio recording equipment and the controversies surrounding programs like Amos 'n' Andy. Bootlegging communities devoted to buddy cop TV shows like Starsky and Hutch allowed women to articulate female pleasure and sexuality while Star Trek videos in Australia inspired a grassroots subculture built around community viewings of episodes. Tape trading also had a profound influence on creating an intellectual pro wrestling fandom that aided wrestling's growth into an international sports entertainment industry.

Benoît Cassaigne, Jukien Rosanvallon, Philippe Tassi
La mesure des médias - Histoire, enjeux et perspectives
Economica, 2024
Les médias, qualifiés de « quatrième pouvoir », vivent une mutation accélérée qui remet en cause leurs fondamentaux, leurs identités, et peut-être leurs existences.
Ce livre de référence aborde une dimension importante, celle de la mesure des médias, qui joue un rôle majeur dans la compréhension de leur histoire, des modèles économiques, mais aussi, il ne faut pas l’oublier, dans le succès ou non des contenus proposés. La mesure permet d’apprécier l’ampleur des transformations.
Trois grandes parties le composent. La première, nommée « Histoire et contexte de la mesure », décrit le cadre général historique, scientifique, économique, et les multiples familles d’acteurs. La deuxième traite de la mesure quantitative des médias presse, publicité extérieure, cinéma, radio, télévision et internet. La troisième partie est plus générale et prospective, et aborde les perspectives d’évolution à court ou moyen terme, y compris en matière d’organisation.
Les trois auteurs sont des spécialistes et experts reconnus du domaine de la mesure d’audience et de ses innovations ; ils contribuent à mieux faire comprendre la dimension quantitative des médias, sa diversité et son aven

Sophie Suma
Que font les architectes à la télévision ?
Editions deux-cent-cinq, 2021
Frank Lloyd Wright participant à un jeu télévisé sur CBS; Le Corbusier présentant l’architecture moderne comme une religion à la RTF; Frank Gehry invité de Charlie Rose, ou en personnage des Simpsons, et côtoyant des stars de cinéma comme Brad Pitt; Jean Nouvel parlant de l’avenir de l’architecture dans une boîte de nuit avec Thierry Ardisson… Mais que font les architectes à la télévision? Loin des pratiques médiatiques ordinaires du champ de l’architecture (écriture de manifestes, expositions, conférences académiques, etc.), c’est par l’entremise de la télévision et pour ses qualités inclusives et populaires que les architectes diffusent depuis des années leurs points de vue sur la discipline.
Quel(s) effet(s) le régime sériel de ce média de masse tant consommé a-t-il pu produire sur la représentation des architectes? Ces derniers ont-ils véritablement le monopole des discussions sur l’architecture? De quelle manière la télévision a-t-elle forgé l’image normale de l’architecte masculin qui domine encore aujourd’hui le champ médiatique? Comment valoriser les femmes et les minorités pour investir d’autres représentations de l’architecte d’aujourd’hui?

Annette Hill and Peter Lund (Eds.),
The Routledge Companion to Media Audiences
Routledge 2025
The Routledge Companion to Media Audiences captures the ways in which audiences and audience researchers are adapting to emerging social, cultural, market, technical and environmental conditions.
Bringing together 40 original essays, this anthology explores how our constantly changing encounters with media are complex, contradictory and increasingly commercialized in the modern world. Each specially commissioned chapter by both early-career and experienced international scholars surveys new conceptualizations and constitutions of audiences, and assesses key issues, themes and developments within the field. As such, this companion cements itself as an indispensable guide for students and researchers who seek a comprehensive overview and source of inspiration for a diverse range of topics in media audiences.
The Routledge Companion to Media Audiences is an accessible, landmark tool which enhances our understanding of how media is utilized through advanced empirical research and methodological enquiry. It is a must-read for media studies, communication studies, cultural studies, humanities and social science scholars and students.

Maria Rikitianskaia
The Global Wireless. Transnational Radiotelegraphy and its and Its Disruption in World War I,
De Groover, 2024
Version PDF accessible gratuitement sur le site de l'éditeur.
The Global Wireless charts a history of wireless beginning in the 1910s, when it was used as a tool for global communication, and ending as it declined and slowly fell from view.
Located at a crossroads of media history and science and technology studies, The Global Wireless recounts how the advent of wireless technologies created a novel socio-technical problem: since radio signals easily and unwittingly crossed national borders, they challenged existing systems and standards of national media infrastructure control. The book further examines the political negotiations around the International Telecommunication Union, the growth of international communication networks, and the expansion of global media companies on the eve of World War I. The Global Wireless demonstrates that long before Wi-Fi and 5G, another wireless technology had already spread around the globe and prompted, in its wake, a radical reconsideration of networked communication and community.
The Global Wireless should appeal to a broad range of readers, from specialists in the history of radio, technology, and global politics, to professionals and hobbyists in today’s wireless and radio industries.

Marshall McLuhan
Fragment d'un village global, Traduit de l"anglais par Nathan Esquié,
Editions Alia, Paris, 2025.
“Le présent est toujours invisible parce qu’il est notre environnement même et qu’il imprègne complètement le champ entier de notre attention ; ainsi, hormis l’artiste, homme de pleine conscience, tout le monde vit dans le passé. Bien que nous soyons en plein dans l’âge électronique de l’informatique et du mouvement instantané de l’information, nous croyons toujours être dans l’âge mécanique du matériel informatique. À l’apogée de l’âge mécanique, l’homme se tournait vers les époques antérieures à la recherche de valeurs “bucoliques”. La Renaissance et le Moyen Âge étaient entièrement tournés vers Rome ; Rome était tournée vers la Grèce, et les Grecs étaient tournés vers les primitifs pré-homériques.”
En 1969, Marshall McLuhan est un philosophe en vue, aussi original que contesté.
Observateur froid, sans préjugé moral vis-à-vis de la technique, il fait le constat d’une crise généralisée. Une crise dont les ressorts nous restent toutefois inaccessibles, car nous prenons conscience des changements d’époque toujours trop tard, une fois notre environnement totalement modifié.
Les innovations techniques nous façonnent et révolutionnent les structures sociales et politiques, sans retour en arrière possible. Comme l’alphabet bouleversa les sociétés qui reposaient sur l’oralité, comme l’imprimerie accompagna l’essor de la Révolution industrielle, l’immédiateté des nouveaux médias et technologies (radio, téléphone, télévision, ordinateur…) provoque une transformation brutale à laquelle nous n’étions pas préparés. La scission est si profonde que nous ne parvenons ni à la saisir, ni à l’accepter. La compréhension de ce nouvel environnement sera le seul moyen d'inverser la dynamique, ne plus servir la machine et exploiter ses potentiels.
À travers l’avènement de la télévision, McLuhan perçoit déjà que les médias numériques nous impliqueront tout entier. Il entrevoit ce que l’on ne nomme pas encore IA, la nécessité d’une éducation aux nouvelles technologies, les crises identitaires et le vacillement des démocraties… Il décrit un monde que la technique mène vers une conscience universelle, une communauté intégrale constituée de tribus décentralisées et mondialisées. Et promet un avenir radieux, si nous parvenons à maîtriser le chaos présent.

Karol Hordziej and Daniel Muzyczuk (eds.)
Stones, Ants, and Television. Photographic Works of Zygmunt Rytla 1971-2010,
Spector Bools, Leipzig, 2024
Zygmunt Rytka (1947–2018) était un artiste intermedia associé à la néo-avant-garde polonaise des années 1970 et à la communauté artistique indépendante des années 1980. Dans son travail conceptuel, il combinait une étude philosophique et artistique de la nature et de la perception avec des réflexions ironiques sur les médias et la politique contemporains. L'artiste considérait l'appareil photo comme un instrument qui crée une convention et commence à influencer la réalité. Le livre - la première monographie de son travail photographique en anglais - est un recueil complet comprenant des premiers cycles conceptuels, des œuvres traitant de la culture de consommation, des études analytiques à forte charge politique du langage des médias de masse et des œuvres axées sur la relation entre culture et nature. Les cycles sont commentés par des notes de l'auteur, une interview menée par Anna Maria Leśniewska et de nouveaux textes de David Crowley, Karol Hordziej et Daniel Muzyczuk.

William S. Burroughs,
Révolution électronique, traduit de l'américain par Jean Chopin,
Editions Alia, 2025.
"On peut faire entendre des voix à n’importe qui avec des techniques de brouillage. Il n’est pas difficile d’exposer le sujet au message brouillé dont on peut rendre intelligible n’importe quelle partie. On peut le faire par des magnétophones dans les rues ou dans des voitures, des radios et des télévisions truquées... si possible dans son propre appartement, sinon dans un bar ou un restaurant qu’il fréquente. S’il ne se parle pas déjà, il commencera bientôt."
“Le message, c’est le médium”, disait Marshall McLuhan. Mais quand on brouille le médium, que devient le message ? ‘‘De la dynamite’’, répondrait Burroughs !
Révolution électronique porte un projet d’envergure : la destruction en règle des mass media avec les moyens qui sont les leurs. Dans cette mine de propositions, les suggestions de guérilla affluent.
On pourra répandre de fausses nouvelles à l’aide d’enregistrements diffusés aux heures de pointe. Ou introduire dans le discours enregistré d’un politicien des bredouillements et des bruits d’idiot. En brouillant les pistes, aux sens propre et figuré, l’on parviendra ainsi, non seulement à court-circuiter les réseaux d’information, mais encore à démontrer comment le système médiatique nous manipule. Un cours de subversion, par un maître de la contre-culture.

Yoan Vérilhac
Sensationnalisme. Enquête sur le bavardage médiatique
Editions Amsterdam, 2024.
« Il est contre-intuitif, pour des intellectuels, de trouver essentiel et utile, politiquement, de bavarder, voire de consommer le flux sensationnaliste qu’offrent les médias. »
Qu’ont en commun la presse people et les chaînes d’information en continu ? Les highlights sportifs et les magazines de faits divers ? Toutes ces productions culturelles sont sensationnelles, elles captent leur audience par le frisson. Né au XVIIIe siècle, le paradigme sensationnaliste s’est largement diffusé avec l’avènement des médias de masse et de la publicité. Ainsi est-il devenu la cible de critiques faciles, qui identifient ses manifestations à un bavardage trompeur et superflu faisant obstacle à l’émancipation de leur public. Rien n’est plus faux. Consubstantiel à la démocratisation des sociétés, le sensationnalisme accompagne l’extension de la sphère de la délibération et préserve en quelque sorte les citoyens de l’angoisse de la décision permanente. Parce qu’elle fait constamment circuler le plaisir de la simple présence, parce qu’elle intensifie le sentiment d’actualité, mais aussi parce qu’elle fait l’objet d’un dénigrement rituel, cette culture de l’insignifiance et de la superficialité se révèle un puissant vecteur de cohésion sociale. Par là même, elle rend vivable la double injonction, proprement moderne, à l’individualisme et à la grégarité.

Hendrik Folkerts (ed.)
Ulrike Rosenbach. Witnesses,
ZKM, Karlsruhe, 2024.
L’œuvre d’Ulrike Rosenbach est indissociable de l’histoire de la performance et de l’art vidéo. À partir des années 1970, elle s’est concentrée sur le corps féminin en tant qu’interface entre la nature, la culture et la technologie, en étant pionnière dans la pratique de la performance (éco)féministe et en appliquant dans son travail les nouvelles technologies d’enregistrement et de lecture disponibles. Au sein et entre différentes œuvres, elle a créé une boucle de rétroaction continue entre la performance en tant qu’événement en direct et la vivacité en tant qu’événement enregistré, à partir de laquelle de nouvelles installations et œuvres vidéo ont souvent émergé.
L’histoire de la performance a souvent été racontée comme l’expérience immédiate et temporelle d’un événement avec le spectateur comme témoin. Rosenbach, et par extension cette monographie, s’éloigne de la notion de « témoin » en tant que documentariste de la performance en direct pour inclure des recherches sur la manière dont les différents médias dans lesquels l’artiste travaille – performance, vidéo, sculpture, installation, photographie, dessin – se rapportent à sa pratique de la performance, la canalisent et agissent comme témoins matériels de celle-ci.
Un groupe intergénérationnel et international de chercheurs, d’écrivains, d’artistes et de commissaires d’exposition. et les critiques examinent cette question du fait d’être témoin, tout en soulignant les lignes directrices de la pratique de Rosenbach sur cinq décennies.

Philippe Bourdin et Cyril Triolaire (dir.)
Les spectacles de curiosités en Europe de la Révolution française à la fin du XIXè siècle.
Presses de l'Université Blaise Pascal, 2024
Les spectacles de curiosités ont profondément marqué le quotidien des XVIIIe et XIXe siècles. Ménageries, acrobaties, marionnettes, fantasmagories, lanternes magiques et aérostats animaient les places publiques, foires et théâtres, offrant au public une évasion vers des mondes lointains, où prouesses, monstruosités et altérité se côtoyaient. Ces divertissements populaires, accessibles au plus grand nombre, ouvraient un espace mental où rêve et réalité déformée se mêlaient intimement.
Ce livre propose une première histoire détaillée de ces spectacles, de la Révolution à la Belle Époque, en explorant leurs dimensions financières, idéologiques, culturelles et artistiques. Sommes-nous, à travers les récits médiatiques et cinématographiques modernes, les héritiers inconscients de cet imaginaire fascinant ? Comprendre ces spectacles, c’est éclairer notre propre rapport à l’illusion et au rêve.
Diverses contributions sur les montreurs de boîtes d'optique et de lanternes magiques ou encore sur le spectacle acousmatique de La Femme invisible, devraient intéresser historiens et archéologues du cinéma et des médias.

Sébastien Mort
Ondes de choc. Histoire médiatique et politique de la radio conservatrice aux Etats-Unis
Presses de l'Université libre de Bruxelles, 2014
Avant que la chaîne Fox News ne s'établisse comme relais privilégié du conservatisme au début des années 2000 et bien avant qu'elle ne noue des liens symbiotiques avec la sphère trumpiste la décennie suivante, la popularisation des idées de droite radicale a d'abord été rendue possible par la radio.
Phénomène peu connu des publics francophones, c'est grâce au talkshow radiophonique conservateur, qui s'impose en 1988 avec l'animateur Rush Limbaugh, son père fondateur, que ces idées acquièrent une visibilité sans précédent au sein de l’écosystème médiatique et de la sphère politique, pour s’installer plus nettement dans le débat public.
Ce livre examine l’essor de la radio conservatrice, son rôle dans l’élaboration d’une rhétorique tapageuse et outrancière et ses relations avec le Parti républicain, pour lui rendre sa place dans l’histoire politique et médiatique des États-Unis du tournant du XXIe siècle. Il montre comment le changement de régime médiatique qui s’opère à la fin des années 1980 permet l’émergence d’un nouveau genre radiophonique partisan et la constitution d’une sphère publique « défensive », qui, ensemble, s’établissent comme groupe d’intérêt au sein de la coalition républicaine. Cet appariement se fait par le biais de relations fluctuantes nouées sur des bases idéologiques mais de façon pragmatique avec les élites du parti.
Puissant instrument de la contestation conservatrice et média de prédilection des Républicains au cours des années 1990, la
radio conservatrice engage un bras de fer perpétuel avec les médias grand public – et souvent, avec l’establishment républicain lui-même – pour le contrôle de l’ordre du jour politique et médiatique et s’impose rapidement comme force politique de premier plan au point de contribuer à la reconquête du pouvoir législatif par les conservateurs en 1994 et 2010.

Pierre Jacques Pernuit
"Luminances comparée. Une archéologie plastique de l’image télévisuelle et digitale",
in Transbordeur 8/2024
Pierre Jacques Pernuit livre dans cet article une première publication issue de sa thèse de doctorat. Voici le début de cette contribution passionnante sur les premières tentatives d'exploitation esthétique de la télévision.
"En septembre 1938, les projections lumineuses de l’artiste dano-américain Thomas Wilfred (1889-1968), inventeur du Clavilux, un orgue de lumière interactif projetant des formes abstraites en mouvement, furent télétransmises depuis les studios new-yorkais de la RCA- NBC. Cet épisode unique en son genre, jalon des histoires croisées de la modernité plastique et des technologies de vision à distance, fut diffusé par l’une des premières chaînes de l’histoire de la télévision en Amérique du Nord, la W2XBS, qui émettait depuis août de la même année six heures de programmes télévisuels quotidiens. Wilfred construisit pour l’occasion un dispositif miniature qui reprenait les systèmes optiques de son grand orgue Clavilux mis au point en 1919, soit un assemblage mécanique permettant le modelage sculptural de la lumière émanant d’une ampoule électrique au moyen de réflecteurs et de lentilles. L’appareil dont les projections furent télétransmises diffusait en boucle, sur un écran de trente sur trente-huit centimètres, une séquence monochromatique de formes lumineuses dont l’intensité pouvait être altérée par un rhéostat, afin de correspondre à la sensibilité des caméras de télévision.
Or, cette expérience pionnière dans le champ des arts technologiques contrevenait en tous points à la doctrine de Wilfred en matière de remédiation de son esthétique lumineuse. Les projections du Clavilux, instrument du «nouvel art de la Mobile Color »–le terme adopté aux États-Unis depuis les années 1910 par une dizaine d’artistes-inventeurs analogues–ne pouvaient ni ne devaient être capturées par d’autres médias optiques. Wilfred s’opposera ainsi tout au long de sa carrière à la captation de son art par le film et la photographie,
médias qu’il juge incapables de traduire « la profondeur et la délicatesse des images » projetées par les différents appareils qu’il met au point entre les années 1910 et 1960. Cet interdit de principe sous-tend logiquement son hypothèse quelque peu sentencieuse d’un «huitième» art de la lumière, concurrent de la photographie, du film, et plus encore des tendances plastiques auxquelles furent par la suite assimilés le médium transitoire de la Mobile Color, tels l’art cinétique ou les light-shows psychédéliques."

Laurent Jullier
L'analyse des séries
Armand Collin, 2024
Longtemps dans l’ombre des films, les séries sont désormais un objet d’analyse incontournable auquel de nombreux professeurs et étudiants consacrent cours, mémoires, thèses et autres travaux. Mais devant la multitude d’objets d’étude offerte par les séries, comment structurer une analyse pertinente ? Quels sont les outils et les méthodes qui permettent de construire un cours, un mémoire ou un exposé ?
Conçu comme un guide pratique, applicable à tous les types de séries et à toutes les typologies de travaux, cet ouvrage répondra de manière concise et pédagogique à la question : « J’ai envie d’analyser une série télé, comment je fais ? ». Construit autour de quatre chapitres conçus de manière chronologique (production, récit, langage et réception) et enrichis d’exemples concrets et de conseils méthodologiques, il se révélera le compagnon indispensable de toute personne souhaitant mieux comprendre une série.

Michael F. Leruth
Fred Forest's Utopia. Media Art and Activism
The MIT Press, 2024
“France's most famous unknown artist,” the innovative media provocateur Fred Forest, precursor of Eduardo Kac, Jodi, the Yes Men, RT Mark, and the Guerilla Girls.
The innovative French media artist and prankster-provocateur Fred Forest first gained notoriety in 1972 when he inserted a small blank space in Le Monde, called it 150 cm2 of Newspaper (150 cm2 de papier journal), and invited readers to fill in the space with their own work and mail their efforts to him. In 1977, he satirized speculation in both the art and real estate markets by offering the first parcel of officially registered “artistic square meters” of undeveloped rural land for sale at an art auction. Although praised by leading media theorists—Vilém Flusser lauded Forest as “the artist who pokes holes in media”—Forest's work has been largely ignored by the canon-making authorities. Forest calls himself “France's most famous unknown artist.” In this book, Michael Leruth offers the first book-length consideration of this iconoclastic artist, examining Forest's work from the 1960s to the present.
Leruth shows that Forest chooses alternative platforms (newspapers, mock commercial ventures, video-based interactive social interventions, media hacks and hybrids, and, more recently, the Internet) that are outside the exclusive precincts of the art world. A fierce critic of the French contemporary art establishment, Forest famously sued the Centre Pompidou in 1994 over its opaque acquisition practices. After making foundational contributions to Sociological Art in the 1970s and the Aesthetics of Communication in the 1980s, the pioneering Forest saw the Internet as another way for artists to bypass the art establishment in the 1990s. Arguing that there is a strong utopian quality in Forest's work, Leruth sees this utopianism not as naive or conventional but as a reverse utopianism: rather than envisioning an impossible ideal, Forest reenvisions and probes the quasi-utopia of our media-augented everyday reality. The interface is the symbolic threshold to be crossed with an open mind.

Stephen HERBERT (ed.)
A History of Early Television, vol.1 (e-book)
Routledge, 2024 (e-book Kindle, Google Book).
In the 21st Century, broadcast television is an established part of the lives of many millions of people all over the world, bringing information and entertainment directly into our homes. The pieces in this volume date from 1879 to 1934 and consist of a selection of books, articles and news items relating to the first developmental period of television, before it became the ubiquitous medium that we know today. The selection is English language material only.

Francesco Casetti
Projection/Protection. Les médias qui font écran
Mimesis, 2024
La Fantasmagorie de la fin du XVIII e siècle, les palais du cinéma des années 1920 ou encore les images provenant de nos ordinateurs construisent des bulles physiques ou mentales qui nous servent de refuge. Le postulat de Francesco Casetti se veut provocateur : les écrans qui font partie de notre quotidien depuis plus de deux siècles ne sont finalement pas des extensions de notre vue, mais des formes de protection par rapport à un monde qui se révèle constamment menaçant. La nécessité de se détacher du contexte immédiat, au moyen d’une zone de sécurité qui nous rattache à la réalité par le filtre des images, répondrait à ce besoin de défense. Mais protéger signifie aussi étouffer et limiter, et fait souvent ainsi advenir une autre forme de violence. C’est seulement par le biais d’une nouvelle sensibilité, ouverte aux risques du monde, et non contrainte par nos propres peurs, que l’on pourra rétablir un dialogue productif avec la réalité.

Asma Mhalla
Technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats
Seuil 2024
Intelligence artificielle, réseaux sociaux, implants cérébraux, satellites, métavers… Le choc technologique sera l’un des enjeux clés du xxie siècle et les géants américains, les « BigTech », sont à l’avant-garde. Entités hybrides, ils remodèlent la morphologie des États, redéfinissent les jeux de pouvoir et de puissance entre nations, interviennent dans la guerre, tracent les nouvelles frontières de la souveraineté. S’ils sont au cœur de la fabrique de la puissance étatsunienne face à la Chine, ils sont également des agents perturbateurs de la démocratie. De ces liens ambivalents entre BigTech et « BigState » est né un nouveau Léviathan à deux têtes, animé par un désir de puissance hors limites. Mais qui gouverne ces nouveaux acteurs privés de la prolifération technologique ? A cette vertigineuse question, nous n’avons d’autre choix que d’opposer l’innovation politique !
S’attaquant à tous les faux débats qui nous font manquer l’essentiel, Asma Mhalla ose ainsi une thèse forte et perturbante : les technologies de l’hypervitesse, à la fois civiles et militaires, font de chacun d’entre nous, qu’on le veuille ou non, des soldats. Nos cerveaux sont devenus l’ultime champ de bataille. Il est urgent de le penser car ce n’est rien de moins que le nouvel ordre mondial qui est en jeu, mais aussi la démocratie.

Maxime AUDINET
Un média d’influence d’État. Enquête sur la chaîne russe RT
INA, 2024
Le 24 février 2022, éclatait l’un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Une fois encore, les médias russes transnationaux se trouvent au cœur d’une stratégie d’influence visant à faire primer les récits façonnés par le pouvoir.
Au service de l’État russe et de sa politique extérieure, qu’il cherche à légitimer, le réseau RT (ou Russia Today) a été fondé en 2005 sur des bases modestes. Deux décennies plus tard, il est considéré dans les démocraties libérales occidentales comme une menace, au point que l’Union européenne a interdit sa diffusion.
En usant de toutes les techniques modernes pour détourner l’attention, aggraver la polarisation ou brouiller la frontière entre faits et opinions, RT tente de s’imposer comme une « alternative » aux médias « mainstream » et déploie une rhétorique selon laquelle toute vérité est relative.
Comment un État autoritaire fabrique-t-il l’influence ? Doit-on craindre l’intensification de ce type de propagande ? C’est à ces questions que cette enquête remarquable se propose de répondre ; appelé à devenir un ouvrage de référence, ce livre se veut également un manuel de résistance à l’heure des nouvelles guerres de l’information.
« Un média d’influence d’État, Enquête sur la chaîne russe RT » est une édition revue et augmentée de « Russia Today » paru en 2021, qui reçut le prix du livre « Recherche sur le journalisme » lors des Assises du journalisme de Tours en 2022.

Vivien Philizot
Images premières: Aux origines de la représentation visuelle
Métis Press 2023
Les images s’incarnent dans une infinie diversité d’objets, de phénomènes et de situations, semblant toujours résister à notre irrépressible besoin de les définir. À moins, peut-être, de se demander d’où elles viennent. Œuvres peintes, diagrammes, cartes, images télévisuelles, images scientifiques, ombres, photographies satellites, dessins pariétaux, se côtoient ainsi ici en douze « tableaux », pour nous faire cheminer dans cette zone liminaire et fragile où les images sont tout juste des images. Aux frontières et aux origines même de la représentation visuelle, les images premières peuvent nous aider à préciser, à raffiner, à définir, à la fois ce que nous savons sur l’image et ce que nous pouvons savoir par l’image.

David Colon
La guerre de l'information. Les Etats à la conquête de nos esprits.
Taillander, 2023
Une guerre à laquelle nous n’étions pas préparés se déroule sous nos yeux, pour l’essentiel sans que nous en soyons conscients, et constitue pour nos démocraties une menace mortelle.
Depuis la fin de la guerre froide et l’essor d’Internet et de médias planétaires, la militarisation de l’information par les États bouleverse l’ordre géopolitique. La guerre de l’information, qui oppose les États autoritaires aux régimes démocratiques, démultiplie les champs de bataille et fait de chaque citoyen un potentiel soldat. Plus que jamais, la puissance des États –qu’il s’agisse de leur hard power, leur soft power ou leur sharp power– dépend de leur capacité à mettre leurs moyens de communication au service de leur influence, en recourant à la cyberguerre, à la désinformation ou à l’instrumentalisation de théories du complot. À l’ère de l’intelligence artificielle et de la guerre cognitive, les médias sociaux sont le théâtre d’une « guerre du Net » sans merci, sans fin, dont nos esprits sont l’enjeu.
Dans cet ouvrage, David Colon, spécialiste de l’histoire de la propagande et de la manipulation de masse, décrit les mécanismes de cette guerre longtemps restée secrète en dévoilant les stratégies de ses commanditaires et en décrivant les tactiques et le parcours de ses acteurs, qu’ils soient agents secrets, diplomates, journalistes ou hackers.

Marek Jancovic
A Media Epigraphy of Video Compression
Reading Traces of Decay
Palgrave Macmillan, 2023
This book explores the historical interrelationships between mathematics, medicine and media, and offers a unique perspective on how video compression has shaped our relationship with moving images and the world. It situates compression in a network of technological, visual and epistemic practices spanning from late 18th-century computational methods to the standardization of electrical infrastructure and the development of neurology throughout the 1900s.
Bringing into conversation media archaeology, science and technology studies, disability studies and queer theory, each chapter offers an in-depth look at a different trace of compression, such as interlacing, macroblocking or flicker. This is a story of forgotten technologies, unusual media practices, strange images on the margins of visual culture and inventive ways of looking at the world. Readers will find illuminating discussions of the formation of complex scientific and medical systems, and of the violent and pleasurable interactions between our bodies and media infrastructure.

B. RAPCSAK, M. NIXON and P. SCHWEIGHAUSER (eds.)
Beckett and Media
Manchester University Press, 2022
Beckett and media provides the first sustained examination of the relationship between Beckett and media technologies. The book analyses the rich variety of technical objects, semiotic arrangements, communication processes and forms of data processing that Beckett’s work so uniquely engages with, as well as those that – in historically changing configurations – determine the continuing performance, the audience reception, and the scholarly study of this work. Beckett and media draws on a variety of innovative theoretical approaches, such as media archaeology, in order to discuss Beckett’s intermedial oeuvre. As such, the book engages with Beckett as a media artist and examines the way his engagement with media technologies continues to speak to our cultural situation.

Sous la direction de Françoise Daucé, Benjamin Loveluck et Francesca Musiani
Genèse d’un autoritarisme numérique. Répression et résistance sur Internet en Russie, 2012-2022
Presses des Mines, 2023
Dans le sillage de la fin de l’URSS, l’Internet russe s’est d’abord développé librement, laissant l’initiative à de nombreux acteurs inventant des outils numériques ajustés à leurs usages. Cependant, depuis le début des années 2010, le tournant autoritaire au sommet de l’État russe a entraîné le déploiement d’un maillage d’emprises et de contraintes qui s’est resserré tant sur les acteurs que sur les infrastructures numériques du pays.
Alors que le réseau a longtemps porté les espoirs de démocratisation de la sphère publique russe, son encadrement s’est constitué progressivement, au fil de controverses et d’épreuves. Malgré les critiques et les contournements militants et citoyens, l’oppression numérique a participé de la souverainisation politique et de la dynamique belliciste dont le moment culminant a été l’invasion de l’Ukraine en février 2022.
Le livre, nourri par les enquêtes de terrain réalisées dans le cadre du projet ANR ResisTIC, dessine un panorama de la gouvernance coercitive et des usages numériques émancipateurs en Russie, de la paix à la guerre. Il met l’accent sur les multiples acteurs et objets numériques au cœur des controverses politiques et des tensions d’usage dans l’espace numérique russe dans les années 2010. Il montre les processus de construction de l’oppression numérique, au fil des critiques, conflits et contournements qui mettent aux prises tant les acteurs publics que privés, tant les partisans de l’ordre du net que les défenseurs de ses libertés. Au prisme du cas russe, ce sont les reconfigurations numériques contemporaines, de la surveillance à la souveraineté, que ce livre interroge.
En accès libre sur OpenEdition

Sous la direction de Manon Houtart et Florence Huybrechts
Littérature et radio
Textyles, 65, 2023 between our bodies and media infrastructure.
Recueil de 10 articles sur les rapports entre radio et littérature en Belgique francophone. En accès libre sur OpenEdition

Edité par Yves Citton, Marie Lechner, Anthony Masure.
Angles morts du numérique ubiquitaire – Un glossaire critique et amoureux
Les Presses du Réel, 2023
138 entrées pour explorer les non-dits des nouvelles technologies, intelligences artificielles et autres aspects du numérique, d'algolittérature et asservissement machinique à viralité en passant par capitalisme de plateforme, évangélisme technologique, glitch-féminisme, médiactivisme et technopolice.
Si le numérique est désormais ubiquitaire, s'il s'infiltre partout – pour nous connecter, nous assister, nous augmenter, nous surveiller – quels sont les angles morts de ce regard dont le centre est partout et la circonférence nulle part ? C'est à cette question qu'essaient de répondre les 145 entrées et la vingtaine de contributeur·es de ce glossaire. On y trouvera des expressions-clés, familières ou inattendues, des réflexions originales et des synthèses pédagogiques sur les profondes ambivalences dont ces angles morts sont le lieu. Ces zones d'ombre marquent en effet à la fois des limites et des lacunes des meilleurs efforts de programmation, condamnant certaines réalités à rester exclues de ce qui (se) compte dans notre monde numérisé. Ces angles morts constituent du même coup de précieuses zones d'opacité, qui sont parfois à défendre comme autant de marges de liberté.
C'est pour nous permettre de mieux naviguer parmi ces ambivalences que cet ouvrage propose quelques éléments d'un vocabulaire commun du numérique ubiquitaire. Il se veut critique, parce que les formes prises par les exploitations actuelles du numérique sont souvent inquiétantes et demandent à être restructurées. Il se dit amoureux pour renouer avec une veine d'espoirs et d'émerveillements devant les potentiels d'émancipation et d'intelligence collectives dont reste porteuse la computation.

Octavian Ioan BALTAG
Istoria Televiziuni Analecte
Editura Performantica, Iaşi, 2023
4 volumes parus sur les 6 annoncés. Un important recueil des textes et brevets sur les aspects techniques de l'invention de la télévision, par le Professeur Batlag,
Professor EmeritusProfessor Emeritus
"Gr.T.Popa" Univ. of Medicine and Pharmacy

Revue Pallas, Revue d'études antiques, n)122, 2023
Cet ouvrage s'intéresse aux pratiques, discours et représentations attachés à l'oeil en Grèce et à Rome, dans une approche d'anthropologie historique, suivant trois axes : médecine et religion ; mythe et identité ; regard et pouvoir. Les questionnements sur l'anthropologie du regard dans l'Antiquité ont été initiés par des travaux comme ceux de J. -P. Vernant et F. Frontisi-Ducroux en Grèce ancienne et ceux de Jas Elsner sur les images romaines.
Mais l'oeil en tant que tel, comme organe sensoriel et investi d'une puissance particulière, a peu été étudié en dehors des travaux sur l'histoire de la médecine consacrés aux mécanismes de la vision. C'est à la croisée entre histoire des sciences et histoire des représentations que se place ce dossier qui approfondit, dans une perspective d'anthropologie historique, la manière dont les Anciens ont développé pratiques, discours et imaginaire autour de l'oeil.
Il s'organise autour de trois axes : entre médecine et religion, des soins des yeux aux ex-voto oculaires dans les sanctuaires ; autour des mythes d'Actéon, Lyncée et Argos, et des identités sociales ; autour des jeux de regard, de l'esthétique et de la place de l'oeil dans les dispositifs polysensoriels, et de son agentivité, de ses pouvoirs politiques, érotiques, et même mortels.

Jean-Paul FOURMENTAUX
Surveillance
Les Presses du Réel, 2023
Pour un art des contre-visualités : à la frontière des arts et des surveillance studies, cet ouvrage analyse le rôle technopolitique des nouvelles « machines de vision » et envisage la sousveillance comme un contre-pouvoir
démocratique.
Jean-Paul Fourmentraux, socio-anthropologue (PhD) et critique d’art (AICA), est professeur à Aix-Marseille Université et membre du Centre Norbert Elias (UMR CNRS 8562).

Estelle Bunout , Maud Ehrmann and Frédéric Clavert
Digitised Newspapers – A New Eldorado for Historians? Reflections on Tools, Methods and Epistemology
De Gruyter, 2023
The application of digital technologies to historical newspapers has changed the research landscape historians were used to. An Eldorado? Despite undeniable advantages, the new digital affordance of historical newspapers also transforms research practices and confronts historians with new challenges. Drawing on a growing community of practices, the impresso project invited scholars experienced with digitised newspaper collections with the aim of encouraging a discussion on heuristics, source criticism and interpretation of digitized newspapers.
This volume provides a snapshot of current research on the subject and offers three perspectives: how digitisation is transforming access to and exploration of historical newspaper collections; how automatic content processing allows for the creation of new layers of information; and, finally, what analyses this enhanced material opens up.

Gallimard 2023
Dans L’espace public (1962) Jürgen Habermas montrait comment à partir du XVIIIe siècle le principe de Publicité avait défini un nouvel espace politique au sein duquel s’opérait une médiation entre la société et l’État, sous la forme d’une "opinion publique" qui visait à transformer la nature de la domination. À travers les discussions publiques ayant pour objet des questions d’intérêt général, l’autorité politique était soumise au tribunal d’une critique rationnelle. Mais bientôt, à l’heure des démocraties de masse, Habermas constatait (en 1990) que l’interpénétration des domaines privé et public conduisait à une manipulation de la Publicité par des groupes d’intérêts et à un singulier désamorçage de ses fonctions critiques subverties en un principe d’intégration. Aujourd’hui, Habermas radicalise son analyse. Les réseaux sociaux effacent pour certains de leurs utilisateurs la délimitation constitutive entre sphère privée et sphère publique : chacun peut parler individuellement comme auteur d’une parole publique. Si dans l’espace public traditionnel, il fallait, pour devenir un tel auteur, se soumettre à la médiation des médias qui mesuraient la vérité, la rationalité et la cohérence logique de la parole, avec les réseaux sociaux la position d’auteur est immédiatement acquise pour chacun. Cette publicité immédiate de la parole intime et privée conduit à l’érosion des critères de rationalité. "Maintenir une structure médiatique permettant à l’espace public de rester un espace inclusif et permettant à la formation de l’opinion et de la volonté publiques de conserver son caractère délibératif ne relève donc absolument pas du simple choix politique : il s’agit d’un impératif proprement constitutionnel."

Les Editions de Minuit, 2023
La voix est une énigme. Même tonitruante, elle est cette sonorité fragile qui s’élève depuis nos cavités intérieures, depuis les vides ou les creux qui nous habitent.
Pour tenter d’en sonder l’énigme, nous nous sommes tourné·e·s vers les accidents de la voix. Lorsqu’elle se détache du corps auquel elle semblait appartenir. Lorsqu’elle se désynchronise d’avec ce qu’elle était censée dire. Lorsqu’elle verse dans le sans-mesure du chuchotement ou de la vocifération.
Nous nous sommes donc attardé·e·s dans les marges de la voix. Nous avons ausculté les résonances de la caverne de Platon et de l’antre où complotent les sorcières de Purcell. Nous avons écouté les ventriloques, dans la Bible comme au cinéma. Nous avons prêté l’oreille aux bégaiements de Ghérasim Luca ou de MC Solaar, aux murmures de Carmelo Bene, aux cris silencieux chez Hitchcock et Dante, aux hurlements saccadés de Bill Viola.
Notre exploration de ces altervocalités reconduit chaque fois vers une hypothèse : c’est lorsque la voix déraille que l’on commence à entendre ce qui la rend possible.

Editions Amsterdam, 2023
Depuis les années 2000, les vidéos partagées sur internet ont pris une place prépondérante dans les luttes sociales et politiques. Partout, du Liban au Chili, des États-Unis à l’Iran, les manifestations, affrontements et autres exactions policières sont documentés par celles et ceux qui les vivent. En France, les Gilets jaunes n’ont pas cessé de filmer, se filmer et partager leurs images. Mais l’image produit-elle des effets concrets ? À quelles conditions peut-elle devenir un outil efficace de contestation des inégalités et des oppressions ?
Pour clarifier ce problème, il faut replacer ces pratiques récentes dans la plus longue histoire des expériences audiovisuelles militantes. Telle est la proposition de ce livre, qui, des premiers groupes ouvriers français aux expériences états-uniennes de guerrilla television, des collectifs argentins combattant l’hégémonie occidentale au médiactivisme italien, revient sur les tentatives de produire d’autres régimes de visibilité et de représentation. Il nous montre que, par-delà les mutations technologiques, la contestation audiovisuelle obéit toujours au même élan fondamental : arracher l’image au pouvoir, se la réapproprier et, ainsi, mobiliser.

Folio, Gallimard, 2023
En avril 2022, le président ukrainien Zelensky se rend à Boutcha pour attester, par sa présence, les crimes de guerre commis par l'armée russe. Il annonce qu'il disposera, pour les prouver, de «bien plus d'outils que ceux qui ont poursuivi les nazis après la Seconde Guerre mondiale». En 1945, à Nuremberg, la documentation filmée des «atrocités» avait été déterminante dans la confrontation des nazis à leurs crimes. Depuis, l'instance judiciaire s'est familiarisée avec ce type de pièces à conviction, même si la projection d'images est l'objet de débats. Celui qui filme doit-il respecter certaines règles s'il veut faire preuve ? Un témoignage filmé vaut-il un récit sous serment, fait à la barre d'un tribunal ? Qu'en est-il du statut de vérité des images ? Autant de questions qui ont trouvé à s'illustrer à la Cour pénale internationale de La Haye ou aux États-Unis lors des jugements des violences commises par la police. Une forme partagée d'attestation, commune aux démocraties, s'élabore ainsi, sous la forme d'archives qui offrent un appareil à la fois documentaire et critique pour l'écriture d'une histoire immédiate du temps présent

Isabelle KERSIMON
Les mots de la haine. Glossaire des mots de l'extrême-droite
Rue de Seine, 2023
L’extrême droite, qui a lu Gramsci, mène depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale un « combat culturel » dans lequel la bataille des mots est fondamentale. Cette bataille vise à fabriquer, dans nos imaginaires, une réalité alternative extrêmement perverse, dans laquelle George Orwell – non seulement invoqué, mais approprié – contredit George Orwell lui-même : dans ce monde, les pires maux ont été fomentés par la furie vengeresse des femmes ; l’antiracisme est le véritable racisme ; l’antisémitisme est une invention musulmane ; la démocratie est un totalitarisme et le quatrième pouvoir un geôlier. Dans ce monde, l’extrême droite dominante est harassée et censurée par la violence des Droits de l’homme. Dans ce monde, la haine revêt le masque de la lucidité et les passions tristes celui de la rationalité.
Nourri par un réseau foisonnant de médias traditionnels et surtout de nouveaux médias issus d’internet, cet imaginaire a trouvé dans la violence et le traumatisme des attentats djihadistes un terreau fragilisé par la peine et la terreur dans lequel a pu s’épanouir la fleur la plus vénéneuse : celle qui contamine l’espace républicain.
Ce glossaire propose de reconnaître, dans l’écosytème d’un fascisme qui vient, les mots et les concepts qui ont empoisonné le débat public pour imposer leurs vues hégémoniques.

Clément Dessy, Selina Follonier et David Martens (dir.).
Textyle, Revue de littérature belge francophone, 2022.
La présente livraison de Textyles étudie les relations entre littérature belge et télévision en abordant tour à tour les émissions littéraires, les captations théâtrales (les « dramatiques ») ainsi que des séries adaptées (Mariages de Charles Plisnier). Elle s’intéresse aussi aux relations ambiguës de plusieurs figures des lettres belges avec la télévision, comme Maurice Carême, Amélie Nothomb et Jean-Philippe Toussaint, et met en avant le travail inlassable de promotion par des journalistes, comme celui de Christian Bussy en faveur du mouvement surréaliste. Sont en outre décortiquées des émissions qui ont marqué les histoires croisées de la télévision et de la littérature, à travers l’interview de Georges Simenon à Apostrophes et la réception de Marguerite Yourcenar à l’Académie française. Elle accueille enfin des réflexions de spécialistes du champ littéraire belge, ainsi que des témoignages de professionnels de la télévision.

Philippe BAUDOUIN
Walter Benjamin au micro. Un philosophe sur les ondes (1927-1933)
Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2022
Walter Benjamin est resté célèbre grâce à ses travaux en tant que philosophe, historien de l’art ou encore critique littéraire. Cet ouvrage présente un aspect méconnu de ses activités : entre 1927 et 1933, Benjamin a enregistré une centaine d’interventions au microphone sur les antennes de Berlin et Francfort et s’est efforcé de dépasser les formes journalistiques de pur divertissement. À travers ses chroniques littéraires ou ses contes radiophoniques pour enfants, le philosophe berlinois a souhaité repenser le matériau sonore diffusé sur les ondes.
Ce livre original propose d’aller à la rencontre de Walter Benjamin par le prisme de sa voix. Les recherches de Philippe Baudouin à l’origine du présent ouvrage tendent à faire entendre l’écho du philosophe, en proposant de redécouvrir l’intérêt à la fois théorique et pratique dont il témoigna pour la radio. L’ouvrage comprend également des annexes sonores, avec d’une part les deux seuls témoignages sonores du philosophe connus à ce jour, extraits de la pièce radiophonique pour enfants Chahut autour de Kasperl, diffusée à la radio de Cologne le 9 septembre 1932, et d’autre part une interview de Stéphane Hessel réalisée par Philippe Baudouin pour France Culture, dans laquelle ce premier témoigne reconnaître la voix de Benjamin dans le personnage de Kasperl.
Ce livre est une réédition augmentée du livre de Philippe Baudouin paru en 2009 aux Éditions de la Maison des sciences de l’homme. Il a reçu le prix Inathèque décerné par l’Institut national de l’audioviosuel.

Anne-Katrin WEBER
Television before TV. New Media and Exhibition Culture in Europe and the USA, 1928-1939
Amsterdam University Press, 2022
Television before TV rethinks the history of interwar television by exploring the medium’s numerous demonstrations organized at national fairs and international exhibitions in the late 1920s and 1930s. Building upon extensive archival research in Britain, Germany, and the United States, Anne-Katrin Weber analyses the sites where the new medium met its first audiences. She argues that public displays offered spaces where television's symbolic, cultural, political, and social definitions were negotiated and eventually stabilized; for the historian, the exhibitions therefore constitute crucial events to understand not only the medium's pre-war emergence, but also its subsequent domestication in the post-war years. Designed as a transnational study, her book highlights the multiple circulations of artefacts and ideas across borders of democratic and totalitarian regimes alike. Richly illustrated with 100 photographs, Television before TV finally emphasizes that even without regular programmes, interwar television was widely seen.

Presses du Réel, 2022
Un état des lieux complet des études sur la culture visuelle, de ses origines dans l'histoire de l'art aux perspectives actuelles ouvertes par les nouvelles technologies, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle.
Cet ouvrage présente les concepts fondamentaux, les questions principales et les nouvelles perspectives de recherche des études sur la « culture visuelle ». Après avoir retracé les origines de cette notion dans la tradition de l'histoire de l'art et dans les théories de la photographie et du cinéma des premières décennies du XXe siècle, le livre reconstruit le développement récent, au niveau international, des visual culture studies et de la Bildwissenschaft. Les chapitres suivants proposent des outils essentiels pour étudier la dimension techniquement déterminée, mais aussi historiquement et socialement située, des images comme des formes de la vision. Les exemples analysés proviennent de contextes culturels et de périodes historiques très variés et concernent jusqu'à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les nouvelles images produites par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies de machine vision.

Flammarion, 2022
« Le 5 mai 2017, durant l’entre-deux-tours de la présidentielle, un tweet révèle des milliers de courriels de l’équipe d’En Marche. Il sera massivement relayé pour tenter de faire basculer l’opinion, et avec elle l’élection.
Qui était à la manœuvre de ces MacronLeaks ?
Le GRU russe, qui aurait hacké les boîtes mail, l’alt-right, l’extrême droite française… et 20 000 bots, des robots pilotés par intelligence artificielle. »
D’élection en élection, une lame de fond s’abat sur chaque citoyen : les réseaux sociaux nous manipulent et déchirent notre tissu social. De fait, la science révèle notre dangereuse inadaptation à la nouvelle donne numérique. Comment se prémunir des intoxications à l’heure du vote ? Une analyse stupéfiante doublée de pistes concrètes, tant individuelles que collectives, pour nous protéger et préserver nos démocraties.

Points, 2022
Giphantie de Charles Tiphaigne de la Roche est un texte méconnu que seuls quelques passionnés jusqu’à présent ont lu. Cette édition est l’occasion de découvrir cet étonnant roman d'anticipation et il n’est que temps : c’est toute l’histoire jusqu’à aujourd’hui qui peut être remise en ordre. Ainsi y lira-t-on la description de ce qu’on a appelé plus tard la photographie, mais on y croise aussi les lentilles de contact… et s'y annonce l’ère de la mésinformation et la culture de la vigne en Normandie dont le réchauffement climatique de la Terre nous montre que ce n’est plus un horizon lointain. C’est bien cet enjeu qui au fond emporte tout sur son passage : Charles Tiphaigne de la Roche fait voir ce que notre présent a pris l’habitude de penser sous le nom de Gaïa - la Terre - comme un corps fait d’une « zone critique » où les espèces se retrouvent.
Yves Citton, inconditionnel et l’un des rares spécialistes de ce texte, y souligne combien, par les prodiges de l’imagination, dès 1760 s’énonçait déjà ce qui fait notre condition de vivants dans les ruines du capitalisme. Avec ce roman d’anticipation, c’est toute notre cosmologie qui apparaît depuis l’espace, comme nous sommes capables de le voir maintenant comme jamais.

Bloomsbury Academy, 2021
While highlighting the prevailing role of television in Western societies, Art vs. TV maps and condenses a comprehensive history of the relationships of art and television. With a particular focus on the link between reality and representation, Francesco Spampinato analyzes video art works, installations, performances, interventions and television programs made by contemporary artists as forms of resistance to and appropriation and parody of mainstream television.
The artists discussed belong to different generations: those that emerged in the 1960s in association with art movements such as Pop Art, Fluxus and Happening; and those appearing on the scene in the 1980s, whose work aimed at deconstructing media representation in line with postmodernist theories; to those arriving in the 2000s, an era in which, through reality shows and the Internet, anybody could potentially become a media personality; and finally those active in the 2010s, whose work reflects on how old media like television has definitively vaporized through the electronic highways of cyberspace.
These works and phenomena elicit a tension between art and television, exposing an incongruence; an impossibility not only to converge but at the very least to open up a dialogical exchange.

Aida Estela Castro, Carlos Natálio, Catarina Patrício, Hermínio Martins, João Ribas, José Bragança de Miranda, José Gomes Pinto, Luís Cláudio Ribeiro, Luís Mendonça, Manuel Bogalheir
Crítica das Mediações Totais – Perspectivas Expandidas dos .media
Documenta, 2021
É a crise desta noção estável e circunscrita do conceito de media — crise que se foi manifestando desde o final do século passado com a generalização dos computadores e a abstracção progressiva dos seus comandos — que constitui o mote deste livro.
Num momento em que nada parece escapar às mediações técnicas, o conceito de media dissolve-se numa generalização possível a todos os campos da experiência. Seja na metáfora da rede, da nuvem, da máquina universal, da mnometecnologia geral, do meta-medium do computador ou do big data, as configurações holísticas proliferam e apontam o aparelhamento geral da experiência como uma nova natureza, uma nova metafísica ou um novo sublime, dependendo da metaforização que se queira fazer do cenário. Uma crítica da mediação enquanto totalidade implica reconhecer que os media constituem a infra-estrutura de determinação da experiência, a partir da qual os próprios media e o real são reconhecíveis e pensáveis, mas implica também reconhecer que essa infra-estrutura se encontra saturada de processos de individuação e de objectos potentes e instáveis, no limiar do desvio, da imprevisibilidade e da entropia, que compõem uma imagem viva do real, não antecipável e constantemente remodelável.

Les Impressions nouvelles, 2022
Illustrateur et satiriste de génie à l’influence considérable, Albert Robida (1848-1926) est resté fameux pour ses fresques d’anticipation, comme Le Vingtième siècle ou La Vie électrique, ou pour ses grands dessins de presse. On voit parfois en lui un précurseur de la science-fiction, un prophète visionnaire des sociétés du XXe siècle, ou même l’inventeur avant l’heure de la télévision, du téléphone et du voyage en avion… Contre ces raccourcis quelque peu anachroniques, cet ouvrage a pour ambition de replacer les grandes anticipations de Robida dans leur contexte, celui de la presse satirique et de ses cibles, mais aussi celui des logiques du rire au XIXe siècle : les transports, les médias, les femmes, la technophilie, les spectacles… c’est toute la culture de l’époque qui est passée au crible de sa verve satirique à travers une technique d’exagération qui le conduit à imaginer inlassablement ce que pourraient donner dans l’avenir les mutations qui transforment en profondeur le XIXe siècle finissant.

Gabriele Balbi, Nelson Ribeiro, Valérie Schafer, Christian Schwarzenegger (eds.)
Digital Roots. Historicizing Media and Communication Concepts of the Digital Age
De Gruyter, 2021
As media environments and communication practices evolve over time, so do theoretical concepts. This book analyzes some of the most well-known and fiercely discussed concepts of the digital age from a historical perspective, showing how many of them have pre-digital roots and how they have changed and still are constantly changing in the digital era. Written by leading authors in media and communication studies, the chapters historicize 16 concepts that have become central in the digital media literature, focusing on three main areas. The first part, Technologies and Connections, historicises concepts like network, media convergence, multimedia, interactivity and artificial intelligence. The second one is related to Agency and Politics and explores global governance, datafication, fake news, echo chambers, digital media activism. The last one, Users and Practices, is finally devoted to telepresence, digital loneliness, amateurism, user generated content, fandom and authenticity. The book aims to shed light on how concepts emerge and are co-shaped, circulated, used and reappropriated in different contexts. It argues for the need for a conceptual media and communication history that will reveal new developments without concealing continuities and it demonstrates how the analogue/digital dichotomy is often a misleading one.

Editions Amsterdam, 2021
Tantôt dénigrée pour sa loufoquerie, tantôt assimilée à un « totalitarisme » qui broie les individus, l’utopie a toujours subi le feu nourri des critiques. C’est oublier qu’avant d’être programme, elle est désir : révolte contre les injustices spécifiques de ce monde et aspiration à la transformation radicale de ce qui existe. L’une des grandes réussites de l’idéologie dominante est de la rendre non seulement impossible, mais, surtout, indésirable. À l’heure où le système capitaliste s’enlise dans d’incessantes crises, il est urgent de renouer avec le sens du futur qui a pour nom utopie.
Tel est l’objet de ce maître ouvrage, qui, pour démontrer la pertinence politique de cette forme littéraire, nous fait traverser l’espace et le temps, visiter des univers stupéfiants et rencontrer de mystérieux aliens, en embrassant à la fois les textes essentiels de la tradition utopique, de Thomas More à William Morris, et la science-fiction, de H. G. Wells à Kim Stanley Robinson, sans oublier bien sûr Philip K. Dick et Ursula Le Guin. La capacité à rêver le futur est la mesure de notre puissance collective.

Edward BELLAMY
Egalité
Traduction de Paul Zimmermann, revue, complétée et modernisée par Philippe Éthuin.
Editions Publie.net, 2022,
Auteur en 1888 de Dans cent ans ou l’an 2000 qui connut un succès mondial et de multiples éditions en France à partir de 1891, Edward Bellamy propose une suite de ce classique de l’anticipation utopique avec Égalité (Equality). De ce second roman, seule « La parabole du réservoir d’eau » a largement été diffusée dans la presse libertaire et socialiste. Mais bien d'autres aspects du texte sont importants : Bellamy place les femmes à égalité avec les hommes (éducation, mariage, vie professionnelle, revenus, vêtements…), se positionne comme auteur précurseur de l'économie distributive (revenus annuels non capitalisables, propriété d'usage…), questionne la défense de l'environnement, la protection des animaux, l'impact des activités humaines sur la Terre, ainsi que l'unité de l'humanité (chaque habitant parle sa langue maternelle et la langue universelle). Il ne néglige pas non plus les progrès techniques et l'on voit apparaître l'électroscope, les disques phonographiques, les voitures à moteur et les véhicules aériens… Il invente également — il écrit ces lignes en 1897 — une « carte de crédit » qui permet aux citoyens du XXe siècle de régler toutes leurs dépenses.
Pour la première fois, ce texte majeur de la littérature d’anticipation utopique est disponible en français.

Duke University Press, 2020
Already in the late nineteenth century, electricians, physicists, and telegraph technicians dreamed of inventing televisual communication apparatuses that would “see” by electricity as a means of extending human perception. In Seeing by Electricity Doron Galili traces the early history of television, from fantastical image transmission devices initially imagined in the 1870s such as the Telectroscope, the Phantoscope, and the Distant Seer to the emergence of broadcast television in the 1930s. Galili examines how televisual technologies were understood in relation to film at different cultural moments—whether as a perfection of cinema, a threat to the Hollywood industry, or an alternative medium for avant-garde experimentation. Highlighting points of overlap and divergence in the histories of television and cinema, Galili demonstrates that the intermedial relationship between the two media did not start with their economic and institutional rivalry of the late 1940s but rather goes back to their very origins. In so doing, he brings film studies and television studies together in ways that advance contemporary debates in media theory.
















