
La critique de l'usage de dispositifs acoustiques pour mystifier le public crédule, tel que dénoncé par Ibn Hazm, Della Porta, Cervantes, Athanasius Kircher, Van Dale, Fénélon ou Laurent Bordelon reste bien entendu une pratique de lettrés, qui n'empêche pas les mystificateurs de continuer à y recourir.
De même, les accusations calomnieuses des savants, accusés de construire des statues démoniaques, que Gabriel Naudé avait si bien caractérisées, continuent à être d'usage. En 1700, le moine Bonaventure d'Argonne, connu sous le nom de Vigneul -Marville colporte une histoire sur Descartes, qui aurait fait embarquer sur un bateau un automate de sa construction. Le capitaine du navire, par curiosité, aurait ouvert la caisse contenant l'automate et effrayé de le voir bouger l'aurait jeté à la mer, croyant que ce fut un diable. .En 1749, Charles-François Tiphaigne reprend cette histoire dans son premier livre, L'amour dévoilé et l'amplifie dans la tradition des statues parlantes : l'"homme à ressorts" qui ne faisait que bouger chez Vigneul-Marville, "roule des yeux, prononce quelques mots confus, s'agite et entre dans des mouvements convulsifs". (2)
-
Les Récréations de E.G. Guyot et W. Hooper
Le 18ème siècle va connaître, particulièrement en France et en Angleterre, une recrudescence de la pratique des statues parlantes, peut-être stimulé par le succès de la traduction du Quijote et de la circulation des théories de Della Porta et de Kircher. Le contexte a cependant changé : la vogue des démonstrations scientifiques, dans le cadre de la "bonne société" conduit des illusionnistes à impressionner un public qui n'est plus nécessairement dupe, mais qui a plaisir à admirer l'habileté du démonstrateur et à s'étonner de la mise en oeuvre de principes scientifiques à des fins de divertissement.
De tels dispositifs sont décrits, dans les Nouvelles récréations physiques et mathématiques (1769-1770) par Edme-Gilles Guyot (1706-1786), Directeur du bureau des déboursés à la Grande Poste de Paris et en Angleterre par les Rational Recreations de William Hooper, qui ne fait souvent qu'adapter l'ouvrage de Guyot.
On ne possède que peu d'information sur la formation scientifique de Guyot et sur l'origine de ses connaissances en matière de récréations physiques et mathématiques (4). Belhoste et Hazebrouck suggère qu'il aurait pu être en contact avec Gauthier d'Agoty, inventeur d'un procédé d'impression en couleurs, et avec le Père Castel, collaborateur scientifique du Journal de Trévoux, la revue des Jésuites. Ils indiquent également que nombre des récréations décrites sont inédites. Cependant, dès la préparation de la première édition, Guyot fut attaqué par Charles Rabiqueau, tenant cabinet de physique et de mécanique rue Saint-Jacques, qui s’indigne de voir un concurrent, “un envieux qui nous prend pour des sots, ,”abuser de sa “bonne place à la Grande poste[...]pour écraser les autres.” (5)
Diverses récréations concernent les techniques de communication : encres sympathiques, écriture incompréhensible, lanterne magique, miroirs magiques, communication optique par signaux, communication par porte-voix ou tube acoustique. Dans son Histoire de la télégraphie, Chappe l'Aîné s'est demandé si le système de communication par signaux optiques décrit par Guyot n'était pas celui dont Guillaume Amontons fit une démonstration au Jardin du Luxembourg en 1695 (6). Toujours est-il que les Anglais considérerons Hooper - qui adapta la récréation de Guyot en anglais - est un des précurseurs de leur propre télégraphe optique.
Parmi des figures assez complexes fournies sur des planches colorées, Guyot n'hésite pas à inclure des dessins très simples de porte-voix (dont il explique comment en construire un) et de tube en fer blanc, ce qui nous laisse penser qu'il considérait que ces objets n'étaient pas encore tout à fait familiers à ses lecteurs.
En matière de statues parlantes, Guyot emprunte, sans le nommer, à Della Porta, sans que l'on puisse déterminer si il a lu les Magiae Naturalis, des auteurs intermédiaires ou si il transcrit sur une pratique des illusionnistes issue de Della Porta L"androïde du siècle" (que Hooper rebaptisera conversive statue) est une reprise un peu plus sophistiquée du "miroir parlant" (speculo loquente), utilisant deux miroirs concaves séparés par une tapisserie (7). Quant à Récrétation LX décrite dès l'édition de 1770, qui fait s'entretenir deux figures ^par l'intermédiaire d'une tube de plomb, elle paraît elle aussi inspirée par Della Porta, citant d'ailleurs comme lui l'exemple d'Albert le Grand. Dans la première édition, Guyot n'utilise pas l'expression "Statue parlante". (8) Celle-ci va apparaître, en 1776, à l'article "Statues parlantes" du Dictionnaire de l'industrie.(9) Les reprises par Hooper, "Recreations L et LI de Hooper sont dénommées "The communicative busts" et "The oracular head") Dans l'édition de 1786 de ses Récréations, Guyot utilise l'expression "Têtes parlantes", mais celle-ci a été utilisée auparavant par l'Abbé Mical.
-
Les automates - Têtes parlantes de l'Abbé Mical (1783)
L'histoire des automates n'est pas directement en rapport avec la transmission des sons, mais interfère néanmoins avec notre propos. La réalisation d'automates musicaux (comme le Flûteur automate de Vaucansson présenté à l'Académie des Sciences en 1738) constitue une première maîtrise mécanique de la reconstitution des sons.
La mise au point d'automates capables de dire quelques phrases devient un sujet de recherche dans les années 1780 (10) Le grand mathématicien Euler en avait posé les enjeux en 1761 (11) :
(1) Voir chapitre 8. Mystifications au porte-voix - La querelle des Oracles
(2) VIGNEUL-MARVILLE, Mélanges d'histoire et de littérature, Tome 2, Chez Elie-Yvans, Rotterdam, 1700, pp.124-125 ; TIPHAIGNE DE LA ROCHE Charles-François, L'amour dévoilé, ou Le systême des simpathistes , où l'on explique l'origine de l'amour, des inclinations, des simpathies, des aversions, des antipathies, Paris, 1749, pp.80-82 ; in Oeuvres complètes, sous la direction de Jacques Marx, Classiques Garnier, 2019, p.161
(3) GUYOT, E.G., Nouvelles Récréations physiques et mathématiques, 4 volumes, Gueffier, 1769-1770, 2ème édition, 1772-1775 ; HOOPER W., Rational Recreations, Davis, 1774
(4) Sur Guyot, voir BELHOSTE B., HAZEBROUCK, D., "Récréations et mathématiques mondaines au XVIIIesiècle :le cas de Guyot", Historia Mathematica, 41, 2014, pp.490-505 ; CHABAUD G., "Littérature savante et assignation culturelle. Le Dictionnaire encyclopédique des amusemens des sciences mathématiques et physiques", Littératures classiques 2014/3 (N° 85), pp 217-232
(5) RABIQUEAU C., Lettre et regrets de souscription d'une jeune provinciale à une de ses amies à Paris , sur l'ouvrage intitulé : Récréations physiques et mathématiques du sieur Guyot, s.l., s.d., (1769)
(6) GUYOT, vol.2, pp. 188-192.; CHAPPE L'AINE, Histoire de la télégraphie, Chez l'auteur, Paris, 1824, p.41


Dessins de tube en fer blanc et de porte-voix dans les Récréations de Guyot, 1770.


"Androïde du siècle" et "Conversive statue", utilisant des miroirs paraboliques (GUYOT, Récréations physiques et mathématiques, 1770 ; HOOPER W., Rational Recreations,)? 1774
(7) GUYOT,, Récréation XXXVI, "L'androïde du siècle", op.cit., vol.3, 1770, pp. 153-155 ; HOOPER W., "Recreation LVIII", in Rational Recreations, 1774, p., 220-223. Un dispositif similaire est décrit in The Conjurer Unmasked, London, 1790, pp.99-100.
(8) GUYOT, E.G., Récréation LX vol. 4,, Gueffier, Paris, 1770, pp.163-166,; . Edition de 1775, vol.IV, pp.78-83 ; Edition de 1786, vol. II, pp.331-335 HOOPER W., Rational Recreations, vol. II, L. Davis, London, 1774, pp. 202-203.; 2nd edition; 1782. ; 3rd edition 1787. Recension in Critical Review, 1774, p. 49 et s.

(9) DUCHESNE, H.G., Dictionnaire de l'industrie, ou, Collection raisonnée des procédés utiles dans les sciences et dans les arts Chez Lacombe, libraire, ..., 1776, tome 3, 1776, pp.552-554.
(10) On en trouvera une synthèse bien documentée in BRACKHANE F., Die Sprechmaschine Wolfgang von Kempelens - Von den Originalen bis zu den Nachbauten, Research Reports of the Institute of Phonetics at the University of the Saarland, 2011
(11) EULER L., "Lettre V. Sur les merveilles de la voix humaine", 15 juin 1761, in Lettres à une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique. Tome second. Steidel, Mietau / Leipzig, 1770, p.276
Dans les années 1770, les automates sont à la mode et l'on commence à voir apparaître des automates parlants, qui ne sont plus issus d'une "miliace de fables et impertinences" que dénonçait Gabriel Naudé, mais d'un vrai travail de réflexion, de création mécanique basé sur une analyse de la physiologie de la prononciation, de la phonétique, mais aussi de l'amplification des sons obtenus.
Au moins quatre inventeurs ont apporté une contribution au 18ème siècle : Christian Gottlieb Kratzenstein, l'Abbé Mical, Erasmus Darwin et Wolfgang von Kempenlen.
Kratzenstein, dont la démarche était inspirée du fonctionnement des tuyaux d'orgue, n'arriva qu'à reproduire quatre des cinq voyelles, à l'exclusion du i. On ne sait pas grand chose de la machine d'Erasmus Darwin, le grand-père de Charles, si ce n'est pas un témoignage tardif de Richard Lovell Edgeworth, indiquant qu'elle pouvait dire quelques mots.
En France, les plus connues de ces machines furent celles présentées par l'Abbé Mical (1727-1789 ?). Dès le 4 mai 1778, les Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France évoquent une tête d'airain capables de prononcer distinctement les paroles "Le roi fait le bonheur de ses peuples et le bonheur de ses peuples fait celui du roi" (12). Selon la rumeur publique, l'Abbé aurait détruit un de ses premiers modèles après qu'il eût été critiqué pour une scène de nudité (13). Le 18 juin 1783, l'Abbé présente à deux membres de l'Académie des Sciences, Benjamin Franklin et au Comte de Milly, ainsi qu'à deux membres de la Royal Society, deux têtes automates capables de prononcer alternativement les phrases suivantes (14)

L'abbé présente ses automates à l'Académie en juillet 1783 et Vicq d'Azir en fait un rapport à l'institution le 7 septembre. Celui fit l'éloge du dispositif, mais le Lieutenant général de police, Jean Charles Pierre Lenoir ayant été trop critique, il ne fut point acheté par l'institution (15). L'année suivante, une brochure de présentation des têtes parlantes est publié, posant le problème de l'adéquation du à la langue française (16) et Rivarol en fait un éloge enflammé dans son discours De l'universalité de la langue française et fournit brièvement une description du mécanisme. Le dispositif repose sur deux claviers : "l'un en cylindre, par lequel on n'obtient qu'un nombre déterminé de phrases mais sur lequel les intervalles des mots et leur parodie sont marqués correctement. L'autre clavier contient, dans l'étendue d'un ravalement, tous les sons et tous les tons de la langue française, réduits à un petit nombre par une méthode ingénieuse et particulière à l'auteur".(17). De nos jours, les têtes parlantes de l'Abbé Mical, parfois considérées comme le premier synthétiseur vocal, continuent d'intriguer les acousticiens (18).
D'autres dispositifs furent proposés, en particulier par le créateur d'automates Wolfgang von Kempelen, qui considérait que son Joueur d'échec n'était qu'une bagatelle des plus faciles à concevoir. Informé des statues parlantes de l'Abbé Mical, il va rapidement protester de son antériorité. Il est un peu vain d'essayer de départager ces deux inventeurs, tant leurs appareils sont différents. Les premières démonstrations de la Sprachmaschine de van Kempelen nous sont connues par des témoignages publiés en 1784 qui attestent qu'elle pouvait prononcer quelques mots tels que "papa, maman" (19), mais c'est surtout le livre publié par l'inventeur en 1791, et immédiatement traduit en français qui nous fournit une description extrêmement détaillée, au point que des reconstitutions en sont possibles. . L'appareil inclut notamment un soufflet, servant de poumons, et une sorte de pavillon en caoutchouc désignée sous le terme de "elastische Flasche" ("machine de gomme élastique qui ressemble à une petite bouteille") (19)

Les têtes parlantes de l'Abbé Mical, gravure du 18ème siècle (Source : WikiCommons)
(12) "4 mai 1778", Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France, chez John Adamson (A Londres), Tome XI, 1784, p.217
(13) "1er février 1779", Mémoires secrets, Tome XIII, 1780, p.270
(14) "1er juillet 1783", Mémoires secrets Tome XXIII, 1784, p.38
(15) "Mical (L'Abbé)" in RABBE, VIELH DE BOISJOLIN, SAINTE-BEUVE, Biographie universelle et portative des contemporains, T.. V - Supplément, Levrault, 1834, p.461.
(16) Têtes parlantes inventées et exécutées par M. l'abbé Mical., s.l., s.d. (1784 ?)
(17) RIVAROL, De l'universalité de la langue française (1784), 2ème édition, Berlin, 1785, pp.140-142
(18) RAMSAY G., "L'Abbé Mical et les Têtes parlantes : L'Histoire de sa vie, l'histoire de son oeuvre" (abstract), 10ème Congrès Français d'Acoustique, Lyon, avril 2010.
(19) HINDENBURG C.F., Ueber den Schachspieler des Herrn von Kempelen : Nebst einer Abbildung und Beschreibung seiner Sprachmaschine, Müller, Leipzig 1784 ; "Schreiben über die Kempelische Schachspiel- und Redemaschine". , Berliner Monatschrift, v4, Juli-Dezember 1784, pp. 495-514.
(20) VON KEMPELEN, W., Mechanismus der menschlichen Sprache. Wien, 1791. (= Le mécanisme de la parole, Vienne, 1791) Recension, Journal encyclopédique, avril 1792, p. 418 ; DUDLEY H., TARNOCZY, T.H., "The Speaking Machine of Wolfgang von Kempelen", Bell Telephone system technical publications, 1950 ; LIENARD, J.S., "Ce que nous disent les premières machines parlantes", Présentation, 2014 ; TROUVAIN, J., BRACKNANE, F., "Zur heutigen Bedeutung der Sprechmaschine von Wolfgang von Kempelen", ids-pub.bsz-bw.de, 2010.
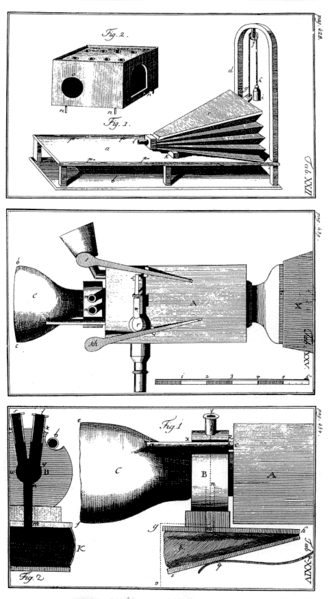
La machine parlante de Von Kempelen (1791) (Source ; Wikicommons)
La machine parlante de von Kempelen reconstituée au département de Phonétique de l'Université de Saarland par Fabian Brackhne avec l'assistance du facteur d'orgues Hugo Mayer et Dominik Bauer. (2017). Source : Fabian Brackhane . Youtube
Les démonstrations d'automates ou de ce type de machines parlantes va souvent susciter le scepticisme initial de ceux qui ont à l'esprit les trucs utilisés pour les démonstrations de statues parlantes.
Poupées parlantes et speaking figures (1783-1786)
La vogue des automates parlants, qui n'étaient évidemment vus et entendus que par quelques privilégies, semble avoir lancé la mode de démonstrations de "poupées parlantes", pour un public populaire. Les descriptions de la poupée parlante présentée à Paris en octobre 1783, rue de Bondy (l'actuelle rue René-Boulanger, entre le Boulevard Saint-Martin et le Boulevard Magenta), permet de comprendre la différence avec le modèle de la statue parlante que l'on trouvait décrit chez Della Porta, Tabourot ou Cervantes. Il ne repose plus sur un dispositif de tube acoustique montant dans une colonne en dessous de la statue, mais sur un porte-voix, utilisé par une commère cachée dans une armoire derrière la poupée, elle-même équipée d'un porte-voix (21). Ce dispositif faisait donc l'économie d'une infrastructure fixe, dont l'installation était possible dans un palais ou un appartement bourgeois, et devait pouvoir être utilisé dans une installation foraine sur les Boulevards.
![La_Magie_blanche_dévoilée ]Decremps_Henr](https://static.wixstatic.com/media/0999d7_7933d30a51f44bdfadd83ed568d3dde1~mv2.jpeg/v1/fill/w_540,h_908,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/La_Magie_blanche_d%C3%A9voil%C3%A9e%20%5DDecremps_Henr.jpeg)
(21) La poupée parlante montrée à Paris en 1783 est expliquée dans PAULET, J.-J., L'antimagnétisme, ou Origine, progrès, décadence, renouvellement et réfutation du magnétisme animal, Londres, 1784 et dans "Poupée parlante" in DECRAMPS, H., La Magie blanche dévoilée, ou Explication des tours surprenants qui font depuis peu l'admiration de la capitale et de la province... suivi de Supplément à la Magie blanche dévoilée, 1785, pp.180-183 Des extraits du texte de Descamps sont repris dans Encyclopédie méthodique. , Dictionnaire encyclopedique des amusemens des sciences mathématiques et physiques , des procédés curieux des arts ; des tours récréatifs & subtils de la magie blanche, & des découvertes ingénieuses & variées de l'industrie, Pancoucke, 1792, pp.829-830. Voir également Le Magasin pittoresque, n.56, 1887.

Le Journal de Paris, 16 octobre 1784

""The Speaking Figure" The Times, 28 April 1785, 20 June 1785
Le spectacle de poupée parlante fait un peu parler de lui, plutôt en mal d'ailleurs, tant le truc est grossier mais ne semble pas avoir duré très longtemps à Paris (22). Dès le 20 août 1784, le chroniqueur des Mémoires secrets note que "L'auteur de la poupée parlante, oubliée depuis un an, ramène la curiosité du public par un nouveau phénomène. C'est un Ventriloque".(23). Le ventriloque est portugais, octogénaire et parle en tenant un automate dans ses bras (24) En septembre, ce même auteur de la poupée parlante, a fait l'acquisition auprès du Dr. James Graham, un charlatan écossais établi à Londres, célèbre par son "lit céleste", d'un automate musical, le Celestiale et l'entrée pour le spectacle de la poupée parlante et du ventriloque est soldée à 30 sols par personne (25). Le spectacle existe toujours en octobre 1784, comme en témoigne une annonce dans le Journal de Paris.(26).
Le jésuite démonologue Jean-Baptiste Fiard, dit avoir assisté en 1788, en présence de trois savants, dont le physicien Charles, au spectacle de la tête parlante, "qui se faisait à Paris dès le commencement du règne de Louis XVI et même auparavant" (c'est-à-dire avant 1774) et met vertement en cause le témoignage et la description que Descramps donne de la poupée parlante. Mais s'agit-il du même spectacle ? (27) La description que donne Fiard pourrait bien être celle d'une variante de la Récréation de Guyot.
(22) Dans son Tableau mouvant de Paris, ou Variétés amusantes (Londres, t.3, p.44, 1787), Pierre Jean Baptiste Nougaret rapporte une lettre d'un Comte de D*** sur la frivolité de sa femme qui se termine par "Pour moi, je prends patience ; mais je n'en suis pas moins désolé d'avoir, au lieu d'une femme, qu'un automate, qu'une simple poupée parlante". Louis-Sébastien Mercier la mentionne dans le Nouveau Paris, tome 6, 1800, p.205.
(23) Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en France depuis 1762 jusqu'à nos jours, 1784, p.164
(24) Journal politique, ou Gazette des gazettes., juillet 1784, pp.63-65 ; Le Journal de Paris, 22 août 1784, p;1000
(25) Le Journal de Paris, 16 septembre 1784, p.1114
(26) Le Journal de Paris, 16 octobre 1784, p.1224
(27) FIARD J.B., La France trompée par les magiciens et démonolatres du dix-huitième siècle, fait démontré par des faits, Chez Grégoire, Paris, 1803, pp.155-164. Sur Fiard, voir ARMANDO D., "Des sorciers au mesmérisme : l’abbé Jean-Baptiste Fiard (1736-1818) et la théorie du complot", Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines 126-1 | 2014



Affiche pour la démonstration "Speaking Figure" (ca 1785) - Bodleian Library / Wikicommons
Le spectacle de la poupée parlante s'est ensuite déplacé à Bruxelles, puis à Londres et ensuite à Edinburgh (28). A Londres, des démonstrations de speaking figures ont d'abord été organisées à Londres par des étrangers (c'est à dire probablement par des Français). Le témoignage vivant et détaillé qu'en donne l'écrivain écossais Henry Mackenzie (1745-1831) dans sa revue The Lounger ne fait guère de doute sur le fait que la poupée vivante qu'il a vue à Bruxelles puis à "Parish of Saint-James" (une ancienne entité religieuse et administrative dans le quartier de Piccadily à Londres) est la même que celle vue par Descremps à Paris. Elle parle à travers un porte-voix et est présentée par un Gascon. Elle répond avec esprit aux questions qui lui sont posées par les visiteurs intimidés, qui paraissent être des bourgeois aisés plutôt qu'un public populaire..
Le spectacle fut par la suite repris par l'illusionniste Denton, Il s'agit probablement des démonstrations anonymes annoncées par The Times (28 avril et 20 juin 1785) et par une affiche : des démonstrations ont lieu tous les jours à la Glass-warehouse, Coventry-Street, près du Hay-market (29). Denton revendit ensuite son procédé à un imprimeur, probablement ce Mr Baley, qui se présente comme propriétaire de la "speaking figure" et annonce des démonstrations au n°42 Bishopgate, sur la couverture d'une réédition de la brochure de Edward Somerset, Marquis de Worcester, A century of the names and scantlings of such inventions (1786). Un spectacle avec automaton speaking figure est encore annoncé dans The Times du 26 août 1786, mais on n'en trouve plus de trace par la suite. D'autres démonstrations, recourant cette fois à deux bustes et des tuyaux de fer blancs sont organisées à Londres en 1787 par le fabricant liégeois d'automates Jean-Joseph Merlin et inspireront la réflexion de Jeremy Bentham sur l'équipement acoustique de sa prison panoptique.
Ces démonstrations de poupées parlantes font l'objet de nombreuses critiques. Une brochure anglaise la dénonce comme une usurpation, au même titre que le jour d'échec, le sophistique automate de Von Kempelen (30). En France, la poupée parlante est mise sur le même pied que les pratiques thérapeutiques de Mesmer, alors au faîte de sa gloire (31) Le souvenir de la poupée parlante persiste durant la Révolution : en 1790 est publiée une brochure La poupée parlante envoyée à l'Assemblée nationale pour instruire le peuple. (32) En 1797 encore Cadet de Gassicourt range la poupée parlante et le ventriloque de la rue de Bondy parmi les origines francs-maçonnes de la Révolution française. Sous l'Empire encore, d'autres n'hésiteront pas à affirmer que "Mesmer, Cagliostro, la cherté des vivres, les tours de cartes, le ventriloque la poupée parlante, voilà autant de prodiges bien capables assurément d'attester le commerce des hommes avec le diable. Sans compter la révolution faite tout entière par des sorciers très-improprement appelés jacobins." (33).
-
Le café mécanique au Palais-Royal (1788)
La poupée parlante abandonnée au souvenir des Parisiens, une autre attraction avec porte-voix se présente en 1786 au Palais-Royal, qui était à l'époque "l'abrégé de l'univers pour les nouveautés" : le café-mécanique (34). Les descriptions du dispositif concordent pour décrire l'arrivée des boissons des consommateurs, par un dispositif de monte-charge dans leurs colonnes des tables, mais varient sur les modalités acoustiques de la commande.. Selon l'Almanach du Palais-Royal, « Les pieds des tables sont deux cylindres creux, dont le prolongement communique avec le laboratoire qui est sous la salle. Il suffit pour avoir ce que l’on désire de tirer sur un anneau adapté au devant de chaque cylindre. Cet anneau répond à une sonnette qui avertit dans le laboratoire, alors s’ouvre sur la table une soupape pour recevoir la demande. Cette soupape se referme aussitôt et ne s’ouvre plus que pour laisser passer une servante à double-étage ». (35) Selon une autre description, « Ce café mérite d’être visité, par la singularité du mécanisme qui fait monter de dessous la table la boisson qu’on demande. Il s’agit de dire les paroles par un trou pratiqué à chaque table, un instant après, et comme par enchantement, s’élève ce que vous avez demandé. Et cela s’engloutit de la même façon. (36)" Selon François-Marie Mayeur de Saint-Paul, "la limonadière a dans son comptoir un porte-voix dont elle se sert pour avertir les garçons qui sont dans les caves" (37).
L'attraction fait accourir le public, bourgeois ou paysanne endimanchée et François-Marie Mayeur de Saint-Paul prend plaisir, un an avant le début de la Révolution, à décrire cette installation pittoresque (38). Le Café-mécanique a survécu à la Révolution, mais n'attire plus que les provinciaux et est délaissé dès les années 1791-1792; Il semble avoir disparu à la fin du siècle (39). Cependant, on en trouve encore une description dans un récit d'un voyageur allemand, paru aux débuts de l'Empire (40)
Les têtes parlantes au tournant du siècle
Une brochure allemande, publiée en 1798 par Heinrich Maximilian Brunner, décrit les dispositifs de figures parlantes et même le dispositif de la femme invisible qui va faire fureur à Paris à partir de 1800, puis en Angleterre ainsi que dans le reste de l'Europe et aux Etats-Unis. (42)
(28) The Lounger, July, 5 1784, pp.184-191. Texte repris dans The works of Henry Mackenzie; Esq.,, Edimburgh, vol. V, 1805; pp.188-199.
(29) ATTICK, R.D., The Shows of London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1978 p.60 ; FRIEDBERG, Window Shopping. Cinema and the Postmodern, University of California Press, 1993., p.219. L'histoire de Denton, et son exécution comme faux-monnayeur, est racontée par The Ipswich Journal, 4 July 1789 et par The European Magazine, n.16, 1789, p.86/

La brochure de Edward Somerset, Marquis de Worcester, A century of the names and scantlings of such inventions, as at present I can call to mind to have tried and perfected est réimprimée en 1786 par ce M. Baley, qui se présente comme propriétaire de la "speaking figure".

CADET DE GASSICOURT, C.L., Le tombeau de Jacques Molai; ou, Histoire secrète et abrégée des initiés, anciens et modernes, des templiers, francs-maçons, illuminés, etc. Et Recherches sur leur influence dans la Révolution française, suivie de La clef des loges, Desenne, Paris, 1797.
(30) The speaking figure : and the automaton chess-player, exposed and detected. Printed for John Stockdale, 1784 Recension in The gentleman's magazine, .vol. 54, pt.2 , 1784.
(31) PAULET, op.cit.
(32) La poupée parlante, envoyée de l'Assemblée nationale pour instruire le peuple, de l'Imprimerie de la Vérité, 1790
(33) H.B., "Lettre à un ami à Berlin sur les dernières productions de la littérature française", Archives littéraires de l'Europe, Henrich, 1804, p.410
(34) LETOURMY-BORDIER, G., "Paris et ses cafés. Le Café mécanique au Palais-Royal", in CHRISTOPHE D., LETOURMY, G. (dir.), Paris et ses cafés, Action Artistique de la Ville de Paris, 2004.
(35) Almanach du Palais-Royal pour l’année 1786 utile aux voyageurs à Paris chez Royez et Morin, libraires au Palais-Royal, Paris, 1786 Etrennes aux amateurs de café
(36) Etrennes aux amateurs de café Etrennes aux amateurs de café
(37) MAYEUR DE SAINT-PAUL, F.M., Tableau du nouveau Palais-Royal, Maradan, Londres, 1788., pp.55-59. Dans une version anglaise, le porte-voix est traduit par "speaking tube" : McCLOY, S.T., French inventions of the eighteenth century., University of Kentucky Press, 1952. pp.109-110.
(38) ISAMBERT G., La vie à Paris pendant une année de la Révolution (1791-1792), F. Alcan, 1896, p.176
(39) "Le café mécanique n'existe plus", MDERCIER DE COMPIEGNE, C.F.X., Manuel du voyageur à Paris, Favre, 1801, p.97
(40) BLAGDON, F.W., Paris, wie es war und wie es ist. G. Fleischer, der Jüngere, Leipzig, V;3, 1806, pp.45-46.
(41) BORET "Sur les Bustes et les Figures parlantes", Le Courrier des spectacles, 18 août 1800
(42) BRUNNER, H.M., Ausführliche Beschreibung der Sprachmaschinen oder sprechenden Figuren: mit unterhaltenden Erzählungen und Geschichten erläutert, Zeh, Nüremberg, 1798



Schéma de poupée parlante dans The speaking figure, John Stockdale (1784).
Illustration des figures parlantes dans BRUNNER, H.M., Ausführliche Beschreibung der Sprachmaschinen oder sprechenden Figuren: mit unterhaltenden Erzählungen und Geschichten erläutert, Zeh, Nüremberg, 1798
Le Courrier des Spectacles du 13 août 1801 rapporte l'anecdote du compère du physicien Rodolphe Jossier qui aurait failliT périr dans l'éboulement d'une tranchée creusée pour tester un spectacle de buste parlant. L'auteur de l'article appelait ironiquement à relire le traité de Guyot. Le fantasmagore Robertson, qui va lui-même contribuer à populariser la femme invisible, rapporte aussi l'anecdote dans ses Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques (1831) (43)

Le dispositif de Jossier. Source originale non identifiée. Reproduit in TOMATIS M., "Il segreto di Rodolphe Jossier", Blog of Wonders, 23 Gunio 2017.


Les bustes parlants et la femme invisible sont associés dans le spectacle du salon d'acoustique-mécanique proposé par Charles Rouy au Passage de Longueville, où est visible le Buste parlant de Trophonius.
(43) ROBERTSON, E.G., Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques, Chez l'auteur, vol.1, 1831, pp. 391-394


Une description des têtes parlantes et une proposition d'explication est fournie en 1803 par le physicien napolitain, établi en Angleterre depuis 1771 dans The Elements of Natural Or Experimental Philosophy. (44)
(44) CAVALLO T., , The Elements of Natural Or Experimental Philosophy, Cadell and Davies, vol.II, 1803, p.341 cité in The British critic. v.22, 1803, p. 271-272


Le retour des têtes parlantes à la fin du 19ème siècle
Des têtes parlantes sont encore présentées à la fin du 19ème siècle. Ainsi l'Anthropoglossos, inventé par Giacopo Saguish, tête de cire parlante qui est exposée en 1864 au St James' Hall, Piccadilly et qui chantait six chansons différentes. (45)
(45) "The Anthropoglossos", The Times, no. 24,932 (23 July 1864), p. 12 ; BECKLAND, F.T., Curiosities of natural history, R. Bentley and son, 1882-83.pp.170-173 ; "L'anthropoglossos", L'Illustration, 6 août 1864 . "Half an Hour with th Anthropoglossos", Fun, 13 August 1864.
_JPG.jpg)
L'anthropoglossos
En 1883, un lecteur de La Nature envoie une lettre décrivant la tête en bois d'un noir, vu dans une fête foraine, qui l'interpellait. Dans ce cas, il s'agit d'un système avec tube métallique, probablement inspiré de du dispositif de la femme invisible de Robertson, tel qu'il va attirer le public européen durant les deux premières décennies du 19ème siècle. (46)
Les têtes parlantes recourant à un système acoustique ne doivent pas être confondues avec le spectacle dit du "décapité parlant", lancé en 1855 par Talrich et qui est basé sur un dispositif de miroirs masquant le corps d'un acteur dont seule la tête est visible. (47)


Caricature politique inspirée par l'Anthropoglossos, Tomawhak, 22 June 1867;
(46) GOY, "Physique amusante. Une tête mystérieuse", La Nature, 3 mars 1883, p.221

(47) Sur le "décapité parlant", voir : TISSANDIER G. "La physique sans appareil", La Nature, 21 août 1880 . "The Magic Cabinet", Scientific American Supplement, n°290? é" july 1881, p. 4624 ; KERLUS S. "La science foraine : les femmes à trois têtes", La Nature, 9 septembre 1882, p. 237-238. "Un nouveau décapité parlant", La Nature, 14 juin 1890, p.32 .. ALBER, "Le décapité parlant", La Nature, 15 mars 1935, pp.276-278

