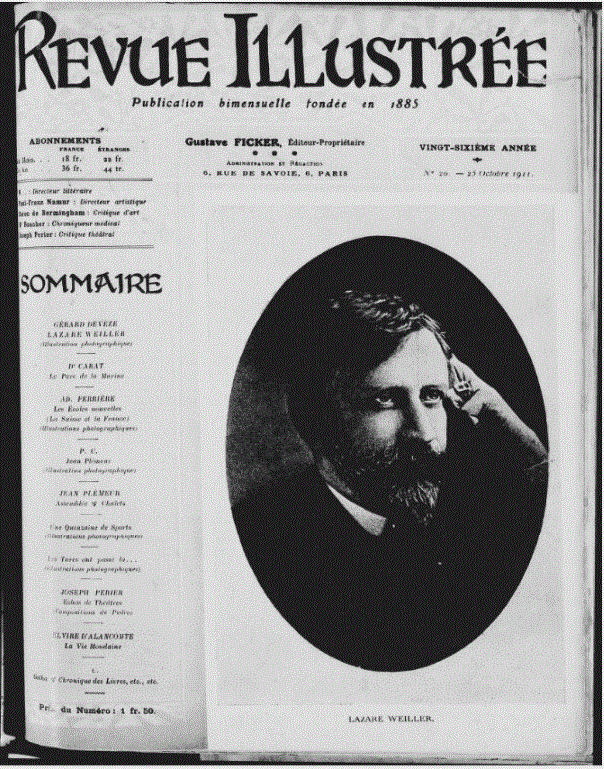Lazare Weiller, météore de l'histoire de la télévision
1. Biographie - Une figure scientifique, industrielle et politique marquante de la IIIème République
Lazare Weiller a marqué l'histoire de la télévision tel un météore. Il signe un seul article, en 1889, "Sur la vision à distance par l'électricité", mais cet article - à l'égal de celui de l'Allemand Paul Nipkow, publié en 1885 - marque les développements de la télévision jusqu'au début des années 1930. Sa biographie est généralement méconnue par les historiens de la télévision, alors que, grand industriel, homme politique et essayiste, il est une des figures marquantes de la IIIè République. Par un curieux paradoxe historique, son initiative, en 1912, d'une alliance industrielle franco-allemande pour contrer l'hégémonie britannique en matière de télécommunications transatlantiques facilitera, vingt-trois plus tard, le transfert vers la France de l'exploitation des brevets RCA sur l'iconoscope de Zworykin qui allait définitivement éliminer la solution de la roue à miroirs proposée par l'inventeur français.
"Tout écrivain qui tenterait de faire de Lazare Weiller un portrait d'une "ressemblance garantie" s'exposerait à faire fausse route" écrit Gérard Devèze en avertissement du chapitre biographique qu'il lui consacre dans La revue illustrée du 25 octobre 1911. Il n'existe malheureusement pas de biographie détaillée de Lazare Weiller, mais de nombreuses notices, plus ou moins exactes, dont la plus vivante, mais trop empreinte de piété filiale et non dénuée d'erreurs, est celle du Commandant Paul-Louis Weiller, héros de l'aviation française. Il suffira d'indiquer que celui-ci crédite son père d'avoir été le premier à suggérer l'utilisation du sélénium dans la conception d'un appareil de télévision pour suggérer qu'elle manque un peu de recul. La contribution la plus fouillée, basée sur les dossiers disponibles aux Archives nationales, se trouve dans le livre d'Emmanuel Chadeau, L'économie du risque. Les entrepreneurs 1850-1980 (1988) mais elle est loin d'avoir dit le dernier mot sur ce personnage complexe, contient également d'importantes erreurs sur l'affaire de la CUTT et passe sous silence les relations complexes de Weiller avec un autre inventeur-entrepreneur et homme politique, Guglielmo Marconi.
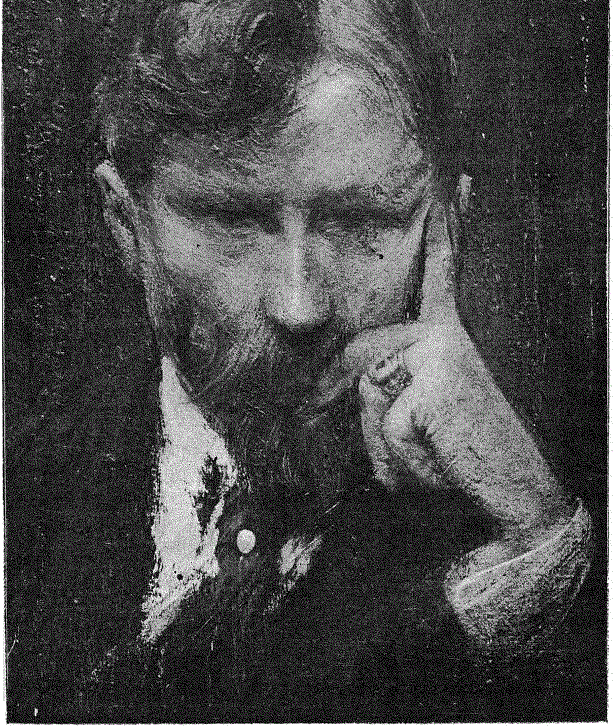
Portrait de Lazare Weiller, peintre non identifié., in : PEYREY, F, L'idée aérienne. Aviation. Les oiseaux artificiels, H. Dunod et E. Pinat, 1909 (Source : CNUM)

Une jeunesse en exil - Débuts scientifiques et industriels
Lazare Weiller est né le 20 juillet 1858 dans une famille juive de Sélestat, petite ville alsacienne qui s'honore d'être le siège de la Bibliothèque humaniste, une des plus anciennes bibliothèques de France, créée en 1452 par l'humaniste Jean de Westhus et qui conserve notamment les incunables et premiers livres imprimés légués par le savant Beatus Rhenanus, ami d'Erasme de Rotterdam. Son père, Léopold Weiller était marchand colporteur et sa mère, Reine Duckes, était servante. En 1808, son grand-père, Bar Koschel, « chaudeur » à Seppois-le-Bas, avait demandé la citoyenneté française. Ayant adopté le nom de Bernhard Weiller, il s’était établi à Sélestat où il était « instituteur judaïque ». Certaines notices biographiques, dont la nécrologie parue dans Le Temps le 13 août 1928, indiquent curieusement qu'il était l'arrière-petit-fils d'un médecin de Louis XIV et fils d'un industriel connu. En fait, selon Chadeau, la mère de Weiller était petite-fille d'un receveur impérial puis royal des Douanes, fils d'un perruquier qui exerçait sous Louis XV....
En 1871, après la défaite de l'armée française face à l'armée prussienne, l'Alsace et la Lorraine sont intégrées dans le Reich allemand. Pour soustraire son fils à l'influence allemande, la mère de Lazare Weiller l'envoie en 1875 travailler et étudier chez des cousins d'Angoulème. Weiller se révèle un élève doué et va terminer ses études à Paris, au Lycée Saint-Louis. Empêché par une fièvre typhoïde de passer les examens d'entrée à Polytechnique il décide d'aller étudier l'anglais au Trinity College d'Oxford, où il découvre notamment les travaux de John Tynsdall (1820-1893), le grand physicien irlandais fondateur de la spectrométrie. Cette expérience de formation et sa connaissance de l'anglais, rare à l'époque, seront pour lui de formidables sources d'ouverture au monde, et de réussite sociale.
Il revient à Angoulème travailler dans l'usine de son cousin, qui produisait des tissus métalliques nécessaires à l'industrie du papier. Il s'intéresse alors aux problèmes de tréfilage des fils de cuivre, qui commençaient à prendre une importance grandissante au moment où le télégraphe, et bientôt le téléphone électrique, prennent leur essor. Il adapte au tréfilage du cuivre une technique jusque-là réservée aux fils d'acier, qui consistait à laminer à chaud le fil machine. Sur cette base, il ouvre en 1881 une petite usine à Angoulême et crée le 20 juin 1883 sa propre entreprise, la Fonderie Laminoirs et Tréfileries de Bronzes et Cuivre Lazare Weiller et Cie, société en commandite par action au capital de 1 250 000 francs.
Ingénieur, Weiller est aussi un chercheur et un inventeur. Il se livre dans l'atelier de son usine à des expériences sur la conductivité de l'électricité par les métaux et lorsqu'il est à Paris, travaille dans un laboratoire du Collège de France. Il met au point un alliage qu'il nomme "bronze siliceux" ou "bronze phosphoreux" et qui allait révolutionner le transport du courant électrique. Cet alliage, alliant la conductibilité du cuivre et la ténacité permettant au fil de rester tendu entre deux poteaux distants de 50 mètres, offrait des garanties importantes aux compagnies de télécommunications. Weiller obtint plusieurs brevets, en France et à l'étranger, et assurait ainsi sa fortune. Ses travaux sur la conductivité des métaux sont réputés internationalement, comme en atteste un article de The Manufacturer and Builder en avril 1887 qui les cite comme référence d'excellence.
Il travaille aussi sur les câbles sous-marins et propose de nouvelles solutions pour leur conception. Cependant, sur ce dernier sujet, les historiens des télécommunications ne sont pas toujours unanimes quant à l'originalité des ses idées et la rigueur de certaines de ses communications à l'Académie des Sciences (Kragh, 1994). En 1889, une polémique l'oppose à Aimé Vaschy devant l'Académie des Sciences sur la question de la propagation du courant dans une ligne télégraphique. Vaschy accuse Weiller de lui avoir emprunté dans un brevet, sans le nommer, les résultats de ses propres travaux, dont il avait eu connaissance.(Comptes rendus hebdomadaires, 1889, CVIII, p.128 et 216).
En 1882, Weiller se convertit au catholicisme, ce qui ne lui épargnera pas tout au long de sa vie les les quolibets et les attaques antisémites, de la part notamment du journal Le XIXème siècle et d'Edouard Drumont, l'auteur de La France juive ou encore, pendant l'Affaire Dreyfus, par L'Intransigeant (9 septembre 1899), qui réfute un témoin simplement parce qu'il est l'employé de M. Lazare Weiller ou nomme ce dernier parmi le "tout-ghetto de la synagogue" qui compose le jury de l'Exposition universelle (18 mai 1900).
L'Annuaire 1973 de la Société des Amis de la Bibliothèque humaniste de Sélestat, dans lequel on trouvera une notice biographique sur Lazare Weiller, rédigée par son fils, le célèbre aviateur Paul-Louis Weiller.

Poteau tendeur Fives-Lille-Lazare Weiller avec embase renforcée in L. WEILLER, Traité général des lignes et transmissions électriques, G. Masson, Paris, 1892. (Coll. A. Lange)

Lazare WEILLER, "La suppression des distances", La Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1898,
pp. 396-423
L'entrée en politique
Le succès de son entreprise lui permet d'entrer en politique. Il fréquente les milieux proches de Gambetta, dont l'équipe du journal modéré La République française. Après la mort de Gambetta (1882), il fera partie des partisans de Jules Ferry. Dès 1883, à l'âge de vingt-cinq ans, il est fait Chevalier de la Légion d'honneur pour des activités de renseignement économique sur l'Alsace occupée. En 1888, il est candidat républicain d'une élection partielle pour le siège de député des Charentes à l'Assemblée. Il est à l'époque proche de Jean Casimir-Perier, qu'il considérera comme son principal protecteur et appartient au courant des Républicains modérés, que l'on désigne alors comme les "Opportunistes". La campagne est très mouvementée et, comme le rapporte le Petit Journal du 10 juin 1888, dans une assemblée houleuse, il se fait traiter de "Boche" et de "Juif". Dans sa profession de foi, il vante les mérites de la Charente, sa terre d'adoption, mais s'affirme Alsacien de vieille souche. Au premier tour, il arrive deuxième derrière un candidat bonapartiste, Étienne Gellibert des Seguins, mais créée la surprise en devançant Paul Déroulède, candidat proche du Général Boulanger. Il recueillit au premier tour 23.993 voix sur 76.770 votants, alors que Gellibert des Séguins en obtenait 31.439 et Déroulède 20.674. Au second tour, c'était Gellibert des Séguins qui était élu avec 37.717 voix, Lazare Weiller n'en recueillant que 27.250 et Déroulède, qui avait refusé de se désister malgré l'appel des Républicains, 11.696.. Le refus de désistement de Déroulède - lequel quelques mois plus tard poussera le Général Boulanger à faire une tentative de coup d'Etat - l'empêche d'être élu. Mais, perdant ces élections dans des conditions honorables, il est devenu une figure connue et respectée du courant républicain.

Lazare Weiller (Photo par Heliog-Dujardin)
Couverture de La Revue illustrée du 25 octobre 1911, consacrée à Lazare Weiller (Source : Gallica)
Un personnage mondain et moderniste
Après le décès de sa première femme, qui était sa nièce, Marie Marguerite Jeanne Weiller, il fait réaliser par le sculpteur Raoul Verlet un tombeau, placé dans une chapelle privée du cimetière de Bardines à Saint-Yiriex (Charente). L'audace choque les esprits conservateurs de l'époque : le jeune couple gît, enlacé, comme après avoir fait l'amour.
Le 12 août 1889, il épouse Alice-Anna Javal, fille d'Emile Louis Javal, député de l'Yonne, membre de l'Académie de Médecine. Il l'a rencontrée dans la famille Elissen, à laquelle elle est apparentée, et qui, investissant dans la première Compagnie générale du téléphone, figure parmi ses clients. Eugène Spuller, rédacteur en chef de La République française (dont Weiller est un soutien depuis les années 70 et administrateur), fidèle de Gambetta et alors Ministre des Affaires étrangères est un de ses témoins tandis que la mariée a pour témoins le poète Sully-Prudhomme, Membre de l'Académie française, qui sera en 1901 le Premier Prix Nobel de Littérature, et Adolphe Carnot, frère du Président de la République.
Selon Jacques Mousseau, "Par ce mariage sans passion, il entre dans un puissant clan d'industriels, de négociants, de banquiers solidement implantés depuis plusieurs générations à Paris et dans toute l'Europe. Il est lié à la Banque franco-suisse, à la Banque commerciale de Bâle, à Bernheim et Cie, et prend des intérêts dans de nombreux secteurs économiques, des chemins de fer au textile et à l'électricité (Compagnie générale d'électricité, société Force et Lumière).". Dans L'Economie du risque, Emmanuel Chadeau a analysé en détail la signification industrielle de ce mariage. La famille Elissen, qui avait fortune dans le commerce du gaz, mais qui, dans les années 1880 opérait une reconversion dans le domaine émergent des télécommunications et de l'électricité. Elle avait investi dans la Compagnie générale des téléphones, créée pour commercialiser le théâtrophone de Clément Ader, puis avait acquis les brevets d'Edison pour les lampes et les génératrices. Pour cette famille, Weiller représentait une compétence technique, était membre du Comité consultatif des chemins de fer disposait de forts soutiens politiques, était censeur de la Banque de France pour le Sud-Ouest, ce qui lui donnait accès aux informations financières sur les crédits et les affaires. Le Figaro du 13 août 1889 rapporte que "le mariage été célébré, hier au milieu d'une affluence considérable. Presque tous les membres du cabinet y assistaient, ainsi qu'un grand nombre de députés et de.sénateurs."
Une contribution majeure à l'histoire de la télévision : le phoroscope et sa roue à miroirs
La carrière d'industriel et d'homme politique ne le détourne pas de la recherche, comme l'atteste sa bibliographie. Il travaille avec quelques uns des grands physiciens et électriciens de l'époque. Il participe, selon Paul-Louis Weiller, à la détermination de l'étalon Ohm (fixé par une conférence en 1884) en collaboration avec Eleuthère Mascart (Secrétaire général de l'Académie des Sciences, auteur de multiples publications dont un important Traité d'optique). Avec Gabriel Lippman, futur Prix Nobel de Physique (1908), il étudie les conducteurs électriques, et il commentera, en 1894, sa théorie de la photographie des couleurs.
A partir d'octobre 1886, Weiller est impliqué dans la préparation de l'Exposition universelle de Paris (1889), dont il est membre du comité technique d'électricité. Est-ce dans ce contexte qu'il commence à s'intéresser à la problématique de la vision à distance, alors que circulent des rumeurs sur les téléphotes de Thomas A. Edison et de Courtonne ? A-t-il eu, par l'entremise de la famille Elissen, eût l'occasion de rencontrer Edison lors de son passage à l'Exposition universelle ? Nous ne le savons pas. Toujours est-il qu'en octobre 1889, alors que se termine l'Exposition, il publie dans Le Génie civil un article majeur "Sur la vision à distance par l'électricité" proposant un appareil, le phoroscope, dont une des composantes, la roue à miroirs, va jouer un rôle éminent dans les expériences de télévision des quatre premières décennies du vingtième siècle.
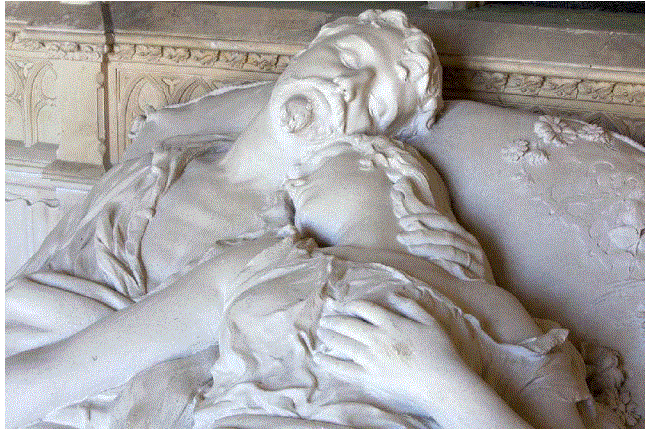
Le tombeau de Jeanne et Lazare Weiller en pierre blanche de Vilhonneur (chapelle Weiller, cimetière de Bardines, Angoulême). Photo Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
Numérisation d'un modèle en plâtre du tombeau de Madame Weiller au Musée d'Angoulême (Source : MuséesAliénor)


Le téléphone à gaz, élément du phoroscope décrit par Lazare Weiller dans son article.de 1889

La roue de miroirs, élément du phoroscope décrit par Lazare Weiller dans son article.de 1889
De la vie scientifique aux activités industrielles
Après cette contribution majeure à la recherche sur la vision à distance, mais qui est sans impact immédiat, Weiller revient à des travaux moins spéculatifs, sur des sujets qui sont ceux qu'il connaît le mieux : les lignes électriques et la fabrication des lignes de transmission. . Il publie deux gros ouvrages de référence à destination des ingénieurs: un Traité général des lignes et transmissions électriques (1892) et un manuel Affinage et traitement électrolytique des métaux (1894). Après cela, ses activités industrielles, politiques et mondaines vont définitivement prendre le pas sur les activités scientifiques. En décembre 1918, il se portera candidat comme Membre de l'Académie des Sciences à la Division de l'application des Sciences à l'industrie, mais n'obtiendra qu'une voix sur 45 (Comptes-rendus hebdomadaires, Séance du 16 décembre 1918). Une nouvelle candidature en 1923, pour succéder à Maurice Leblanc, restera également sans suite.
Les Tréfileries du Havre
En 1896, considérant que son entreprise, devenue une société en commandite par actions au capital de 2 millions de francs, est trop à l’étroit à Angoulême, il achète un terrain de 18 hectares au Havre, qui est à l'époque le premier port d’importation du cuivre et la porte vers le Royaume-Uni et l'Amérique. La croissance est rapide : le chiffre d'affaires passe de six millions de francs en 1897 à trente millions en 1899. En 1899, l’entreprise emploie 2000 ouvriers. Weiller pratique une politique sociale moderniste (société de secours mutuel, coopérative de consommation, société des habitations à bon marché). Une nouvelle augmentation de capital a lieu, portant ce dernier à 15 millions de francs.
Florence Hachez-Leroy décrit ainsi les activités de Weiller au Havre : "Industriel avisé, il avait mené plusieurs voyages à l’étranger, particulièrement en Allemagne et aux États-Unis, et visité les établissements de ses confrères. De fait, l’usine du Havre fut considérée comme une usine très moderne, regroupant des matériels de pointe, tels que les laminoirs automatiques, auxquels Lazare Weiller avait également porté des améliorations. Outre le matériel, c’est aussi l’usage de l’électricité comme force motrice qui retint l’attention de ses contemporains. L’usine était alimentée par sa propre usine de production électrique équipée de 14 machines à vapeur, avec une capacité considérable de 8 300 chevaux. Autre objet d’amélioration : le laboratoire d’études. Lazare Weiller veilla à s’entourer des meilleures compétences : il choisit d’y mettre à sa tête un scientifique, Edmond Jarry, docteur es sciences et préparateur à l’École normale supérieure."
L'intérêt pour l'impact social et stratégique des télecommunications
Lazare Weiller est un homme habile dans les relations sociales et qui base sa stratégie sur des réseaux d'alliances. Comme la Société des Téléphones est un des principaux clients de la tréfilerie, il l'a fait entrer au capital de sa société et lui-même Il entre au Conseil d'administration de cette entreprise, "On peut donc dire que Lazare Weiller fut, à ce titre, un des premiers introducteurs du téléphone" conclut son fils. Après la nationalisation des réseaux téléphoniques en 1889, l'administration des Postes et Téléphones devient un de ses principaux clients.

Atelier de tréfilerie in L. WEILLER, Traité général des lignes et transmissions électriques, G. Masson, Paris, 1892. (Coll. A. Lange)

Sortie de la Tréfilerie du Havre. Carte postale (avec l'aimable autorisation de M. Claude Bredel / Objectif Le Havre)
La Maison des Ingénieurs que Lazare Weiller fit construire aux Tréfileries du Havre (avec l'aimable autorisation de M. Claude Bredel / Objectif Le Havre)


Le téléphone ne l'intéresse pas uniquement dans ses dimensions techniques et industrielles. Les applications culturelles le passionnent également. Se fondant sur un article du quotidien Le Matin, le polémiste antisémite Edouard Drumont, dans son pamphlet La fin d'un monde (1889), lui reproche de s'adonner aux plaisirs du théatrophone tout en lui reprochant son rôle dans le krach du cuivre.
La réflexion de Weiller sur les télécommunications est aussi d'ordre stratégique. En 1898, il publie dans La Revue des deux mondes un article synthétisant l'histoire de la "La suppression des distances" - c'est à dire l'histoire des télécommunications, puis un autre sur l'histoire de l'électricité. Dans le premier de ces articles, il n'hésite pas à affirmer que le problème de la communication intercontinentale et celui de la vision à distance seront bientôt résolus ; "La parole franchira-t-elle bientôt les océans comme elle franchit la Manche, et deux personnes placées des deux côtés de l'Atlantique arriveront-elles à pouvoir s'entendre parler réciproquement et se voir ? Il n'est pas téméraire de penser que le problème de la transmission des sons, comme celui de la transmission de la vision à distance seront bientôt résolus et que la voix ainsi que l'image pourra se reproduire instantanément au delà des mers, comme les signaux de la télégraphie."
Dans cette contribution, l'évocation de la vision à distance s'arrête là, et il n'y a aucun prophétisme sur l'ubiquité à venir comme chez Adriano de Paiva. L'article évoque plutôt les difficultés matérielles pour maintenir les réseaux télégraphiques confrontés à diverses formes de dégradations naturelles, mais aussi humaines, en particulier dans les pays colonisés. Weiller souligne aussi la faiblesse stratégique de la France, par rapport à l'Angleterre, en matière de câbles sous-marins. Son intérêt pour la vision à distance s'est fait discret et il ne semble pas avoir persévérer dans le développement de son phoroscope, Cependant, en 1894, dans son article "La photographie des couleurs", Revue des deux mondes (mars-avril 1894), il évoque la figure de Charles Cros, poète et inventeur du phonographe en nous fournissant cette information inédite : "Il s'attacha à la transmission des images à distance".
Bâtisseur, esthète et collectionneur
Lazare Weiller fut aussi un bâtisseur, un esthète et un collectionneur. Lorsqu'il est élevé au grade d'officier de la Légion d'Honneur, le 3 août 1894, Le Figaro souligne que "le jeune et brillant ingénieur électricien dont les travaux ont largement contribué au développement de l'électricité en France" est aussi "un fin lettré et un poète délicat". Au Havre, il fait construire la Maison des Ingénieurs, dans un style Art Nouveau.
Ayant acheté en 1898 le château de Grouchy, à Osny, dans le Val d'Oise, il y crée une galerie pour sa collection de tableaux. Il achète d'abord des classiques (Rubens, Nicolas de Largillière, Jean-Marc Nattier) puis il s'intéresse aux peintres contemporains, avec un éclectisme qui impressionne les critiques. Le catalogue de la vente chez Drouot, le 29 novembre 1901, de sa collection atteste du modernisme de ses choix. La collection comprenait notamment des toiles de Monet, Félicien Rops, Pissarro, Renoir et Sisley. Il était aussi ami du peintre symboliste Puvis de Chavanne, dont il visitait souvent l'atelier et à qui il acheta la toile Pro Patria Ludus que le peintre vint finir et encadrer sur place. Le 19 juin 1899, la presse rapporte que Monsieur et Madame Weiller viennent de donner en leur château une garden-party pour trois à quatre cent invités - dont un "essaim charmant de jolies femmes", note Le Siècle -, un train spécial les ayant amenés de la Gare Saint-Lazare. Le 12 mars 1901, rendant compte des soutiens dont bénéficie l'Exposition de l'Enfance, Le Matin rapporte que "M. Lazare Weiller a consenti à prêter une très rare collection de petits meubles anciens", La collection est composée des meubles réalisés par les compagnons ébénistes.
La crise au tournant du siècle
La bonne fortune de Lazare Weiller est brusquement menacée dans les années 1899-1901. La crise du cuivre (1900-1903) provoquée par la mise en chantier de nouveaux gisements en Amérique du Sud et en Russie provoque un effondrement des cours et l'obligation de casser les prix des produits. Par ailleurs un mouvement de grève, début 1900, motivé par les cadences de travail qu'impliquait le recours aux fours électriques Garrett, frappe les affaires de l'entreprise. Durant l'année 1900, le cours de l'action chute (Le Matin, 29 octobre 1900). Les commandes s'effondrent. En 1901 sa société enregistre des pertes importantes et tout le conseil d'administration, Weiller inclus, est amené à démissionner. Il abandonne ses actions et son traitement à la disposition de l'entreprise. Il est obligé de vendre son château et sa collection de tableaux. L'exposition chez Drouot de celle-ci est un véritable événement et Le Figaro, le 26 novembre 1901, lance un appel pour que le Ludus Pro Patria de Puvis de Chavanne ne quitte pas le pays. Après divers rebondissements, il voit sa position au sein de l'entreprise marginalisée. Il reste vice-président, mais n'est plus qu'un actionnaire minoritaire et, à partir de 1901 les Tréfileries du Havre ne portent plus son nom.
Portrait de Lazare Weiller à la Maison des Ingénieurs de la Tréfilerie du Havre.(avec l'aimable autorisation de M. Claude Bredel / Objectif Le Havre)
Le château de Grouchy à Osny (Val de Marne), propriété de Lazare Weiller de 1898 à 1901. Vidéo Fahmy Helal / Youtube

Le Figaro, 3 août 1894

Le Siècle, 19 juin 1899


Compte rendu de l'article de Lazare Weiller "La suppression des distances", in La Revue des Revues, 1er août 1899. Voir notre article sur le telediagraph d'Ernest A. Hummel.
Puvis de Chavanne, Ludus Pro Patria (Metropolitan Museum of Arts)
En mission officielle aux Etats-Unis
Le Figaro annonce la nouvelle le 7 novembre 1901 : Lazare Weiller, "le jeune métallurgiste qui, dès ses débuts, attira l'attention des gouvernants eux-mêmes" va .effectuer, avec le Baron Maurice de Lagotellerie, à la demande du Président du Conseil Waldeck-Rousseau et d'Alexandre Millerand, Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes, une mission diplomatique aux Etats-Unis. Les objectifs de la mission sont d'étudier les méthodes économiques industrielles et financières de ce pays, en particulier le rôle des trusts, les coûts des produits de la métallurgie et des minerais et les méthodes de formation à la gestion avec l'idée de créer une école de gestion en France et d'envoyer des étudiants français aux Etats-Unis. Il recommande au gouvernement français la création à Pittsburgh d'une école d'ingénieurs pour les étudiants français. et la création d'une école française des sciences politiques à New-York. La proposition suscite directement des controverses, dont l'opposition du journal Le Temps (17 février 1902).
Outre le rapport confidentiel pour le gouvernement, il rédige à son retour un ouvrage Les grandes idées d'un grand peuple qui célèbre la civilisation américaine dans la lignée de Tocqueville. Cet ouvrage connut un succès considérable et fit l'objet d'une soixantaine de tirages. Son maître à penser est devenu le banquier John Pierpont Morgan, avec qui il a travaillé à New York. En observant la vie économique américaine comprend l'importance de la coopération industrielle à grande échelle et va essayer de la mettre en pratique dans une Europe qui est encore fragmentée par les frontières douanières et les nationalismes industriels. En matière de réseaux de communications, il reprend dans ce livre son analyse de l'hégémonie anglo-saxonne en matière de câbles sous-marins, observe le déploiement des réseaux télégraphiques américains dans un marché concurrentiels et se félicité des relations établies avec les opérateurs locaux, en particulier la Commercial Cable C° de John William Mackay et Gordon Bennett (lequel est par ailleurs directeur du New York Herald et de l'International Herald Tribune et le gendre de Paul Reuter, le fondateur de l'agence Reuters).
Aux Etats-Unis, Weiller comprend aussi que l'important n'est pas de posséder les usines mais de savoir exploiter les brevets, que bien souvent les inventeurs ne savent pas maintenir eux-mêmes.
Cet ouvrage le positionne en grand ami des Etats-Unis et la presse mondaine annoncera régulièrement les "dîners intimes" qu'il donne en l'honneur des nouveaux Ambassadeurs des Etats-Unis (notamment Le Figaro, 13 mars 1907). Par la suite, il affirmera clairement des positions libres-échangistes, notamment à l'occasion d'un grand dîner libre-échangiste qu'il organise le 17 mars 1906, à la suite d'un pari perdu avec Yves Guyot, l'ancien Directeur du journal Le Siècle, pour célébrer la défaite électorale avec un programme protectionniste de Balfour, Premier ministre britannique (Le Siècle, 18 mars 1906).
"Courtier industriel" : les investissements dans les transports : marine marchande, taximètre et navigation aérienne
A partir de cette époque, Weiller se reconvertit dans une activité de "courtier industriel", pour reprendre l'expression d'Emmanuel Chadeau.
Le premier investissement que Weiller réalise à son retour des Etats-Unis ne concerne plus la métallurgie adossée au développent des télécommunications, mais les services liés au secteur des transports. En 1902, il créée une société pour l'importation du charbon américain avec la perspective de bénéficier des primes publiques allouées pour la relance de la marine marchande. La défaillance d'un partenaire a fait échouer le projet et conduit à un long procès qui ne se terminera qu'en 1907 (Le Temps, 10 mars 1905, 5 avril 1907). En 1903, il réintègre, comme simple administrateur, le conseil d'administration des Tréfileries du Havre, qui se diversifient dans la métallurgie, la chaudronnerie, le matériel pour navire et les locomotives.
En 1903, il invente, selon son fils, le taximètre, permettant de d'objectiver le prix des courses en fonction du tarif au kilomètre. Selon les historiens, notamment Jacques Mousseau et Emmanuel Chadeau, il en aurait seulement acheté le brevet à un inconnu pour participer à la fondation, avec ses amis industriels de la Compagnie générale des compteurs. Comme l'analyse Chadeau, il détenait une partie minoritaire, mais recevait une partie importante des bénéfices, des royalties sur l'invention et des "parts de fondateurs", cessibles en Bourse. Le mécanisme est simple, les coûts de production peu élevés et le marché en pleine expansion, l'entreprise ne possède pas d'infrastructure industrielle à amortir, mais gère simplement des comptes, des relevés de droits. Deux ans plus tard, avec le soutien de différentes banques, dont la banque Morgan, il crée la Compagnie française des automobiles de place (1905), première société française de taxis, qui fut à l'origine du succès de l'entreprise Renault, puis des compagnies identiques à Londres, Genève, Milan, Berlin et New York, la première des "Yellow Cab Company";. Il pourrait ainsi être le modèle du personnage de Joseph Quesnel dans Les Cloches de Bâle de Louis Aragon (1934).
A l'occasion d'un de ses voyages d'affaires à Londres, son ami le banquier Henry Deutsch attire son attention sur les développements de l'aéronautique. Un de ses correspondants américains attire son attention sur l'absence de soutien dans leur propre pays des frères Wright, qui ont développé un avion biplan à deux hélices entraînées par des chaînes. Le Ministre de la Guerre, Eugène Etienne, le convainc que les frères Wright ne sont pas des bluffeurs et l'encourage à prendre une initiative. Pour valoriser les brevets en Europe, Weiller crée un groupement d'intérêt économique, à laquelle il associe plusieurs de ses entreprises (Chantiers de Dunkerque, Barriquand et Marre,...) avant de créer la Compagnie Générale de Navigation Aérienne, qui signe le 23 mars 1908 avec les deux frères. Les deux frères recevront 500 000 francs pour l'avion de démonstration et 50 % des actions de la Compagnie. Mais ils s'engageaient aussi à accomplir accomplir auparavant deux vols de 50 kilomètres avec deux personnes à bord et à instruire trois pilotes : le Capitaine Lucas-Gérardville, Paul Tissandier (le fils de Gaston Tissandier, directeur de La Nature), et le Comte de Lambert. Ainsi naquit l'école de pilotage de Pau. Wilbur Wright réalise son premier vol le 21 août 1908.
Dans une interview au journal Le Temps (1er octobre 1908) indique qu'il n'a aucune intention mercantile dans le contrat passé avec les frères Wright, mais qu'au contraire il pense aux intérêts de la Nation. Il expose ses vues sur l'importance que la navigation aérienne va jouer dans les conflits militaires.
Après des vols de plus en plus longs - dont un le 3 octobre avec Alice Weiller à bord - Wilbur Wright remplit son contrat le 11 octobre. Lazare Weiller, qui devait voler pour la première fois ce jour là, cède la place à Paul Painlevé, Président de la Commission scientifique. Lazare Weiller fera don de l'appareil au Conservatoire des Arts et Métiers.
Pour exploiter les brevets des frères Wright, Weiller met en plave un groupement d'intérêt économique et crée la Société de navigation aérienne. S. Champonnois décrit ainsi l'opération : "Ce groupement d’intérêt, qui fait un pari sur l’aviation naissante, investirait dans la fabrication de Flyer vendus ensuite à l’armée, principal débouché potentiel. La Compagnie générale de navigation aérienne (CGNA), qui serait alors créée, achèterait pour la France et ses colonies les brevets des Wright ainsi que la franchise de construire et de vendre leurs aéroplanes. Pour répondre aux futures demandes, Orville construit cinq appareils dérivés du modèle de 1905 Il y ajoute des modifications pour le rendre plus pratique. Cet appareil amélioré est le Flyer A : deux sièges sont disposés pour accueillir le pilote plus son passager et les gouvernes sont commandées par des leviers." Dès 1908, 50 appareils Wright sont en construction dans les ateliers contrôlés par Lazare Weiller. L'homme d'affaire créé un Prix Lazare-Weiller de 25 000 francs pour récompenser les pilotes militaires qui auraient accomplis les plus belles performances d'aviation. En 1912 il sera fait Commandeur de la Légion d'Honneur pour le soutien apporté aux frères Wright. Son fils, le Commandant Paul-Louis Weiller, deviendra un des héros de l'aviation militaire durant la Première Guerre mondiale. Selon Chadeau, cette affaire avec les frères Wright sera un échec financier en France, le Ministère de la Guerre refusant d'acheter un produit d'origine étrangère, mais un succès à l'étranger.
Investissements dans la T.S.F. et relations avec Guglielmo Marconi
Les télécommunications intéressent à nouveau Weiller à partir de 1911. La T.S.F. est alors en train d'atteindre le seuil opérationnel et il est assez normal qu'un industriel qui a fait une fortune rapide dans la production de fil et de câble s'intéresse à la technologie directement concurrente. Curieusement, les historiens de la radio ne se sont guère penchés sur cette question et sur l'histoire de la Compagnie universelle de Télégraphie et de Téléphonie sans Fil (CUTT). Les informations fragmentaires qui circulent sont assez souvent fragmentaires, voire complètement erronées. Voici, à titre provisoire et en attendant de publier une analyse plus détaillée, l'histoire de cette entreprise ambitieuse d'une collaboration franco-allemande en manière de télécommunications transatlantiques, qui tourna au fiasco.
La recherche de solutions pour la communication longue distance a été un des grands sujets des pionniers de la T.S.F. En 1911 un ingénieur allemand, Professeur à l'Université de Darmstadt, a mis au point un alternateur à haute fréquence, qu'il appellera la "roue chantante", qui permet des communications T.S.F. longue distance. Cet appareil est remarqué par les spécialistes, dans la mesure où il constitue une alternative au système Marconi, qui a jusque là un monopole de fait sur les communications longue distance, et en particulier sur les communications transatlantiques. La C Lorenz AG, un groupe allemand spécialisé dans la T.S.F., et concurrent de la T.S.F. achète les brevets de Goldschmidt et constitue la Hochfrequenmaschinen A.G. für drahtlose Telegraphie (en abrégé la Homag), dont le Conseil d'administration est présidé par l'Amiral Wihlem von Büchsel, l'ancien amiral en chef de la Marine allemande, qui fut proche de l'amiral Toplitz et - mais on le saura que plus tard - fut chargé du Operationsplan III, le troisième projet allemand de débarquement aux Etats-Unis. La Homag entreprend la construction d'une station à Eilvese (près de Hannovre) et d'une autre à Tuckerton (New Jersey) afin d'ouvrir une ligne transatlantique concurrente de celle de Marconi et de la ligne Nauen-Sayville que la Telefunken est en train de recourir.
Alerté par un des dirigeants de l'administration des PTT, Jacques Bordelongue, Weiller décide d'investir et prend contact avec les dirigeants de la C Lorenz AG et de la Homag. Il crée en septembre 1912 une société, la Compagnie universelle de télégraphie et téphonie sans fil (en abrégé la CUTT), dont il est président et au capital duquel participe la C Lorenz AG, une banque allemande, des banques et des intérêts industriels français et son ami le richissime banquier américain John Pierpont Morgan. La CUTT passe un accord avec la Homag : elle achète les brevets de Goldschmidt pour leur exploitation en dehors de l'Allemagne ainsi que la station de Tuckerton, qui devra être livrée dès qu'elle sera devenue opérationnelle. Weiller espère construire une station en France pour compléter le réseau.
La construction de réseaux internationaux, visant à connecter les colonies, est à l'ordre du jour en Angleterre, en France et au Portugal. En Angleterre la Marconi Wirelless Telegraph Company est en passe d'obtenir le contrat de construction du réseau impérial, dans des conditions controversées qui donnent lieu au célèbre "Marconi Scandal". Le succès de la liaison Eilvese-Tuckerton, annoncé début juillet 1913, constitue une véritable menace pour la Marconi. En France, Weiller se heurte aux divisions et aux lenteurs de l'administration française des PTT - qu'il qualifiera après la guerre "d'administration fossile". Il semble que, dès le printemps 1913, il approche la Marconi pour céder ses parts dans la CUTT. Cette cession a lieu en septembre 1913, dans des conditions peu claires : lors d'une assemblée extraordinaire, le Directeur général de la Marconi, Godfrey Isaacs, annonce que la société a acheté les brevets Goldschmidt, annihilant la concurrence, ainsi que les parts allemandes de la CUTT. En fait - selon Emmanuel Chadeau - Weiller a vendu les brevets et ses parts en échanges d'une entrée confortable pour lui-même dans le capital de la Marconi Wireless Telegraph Company.
Probablement vexés d'avoir été lâchés par Weiller, les Allemands de la Homag utilisent leur contrôle de fait sur la station de Tuckerton : celle-ci est inaugurée en janvier 1914 par un échange de messages entre l'Empereur Guillaume II et le Président des Etats-Unis Woodow Wilson. Dès le lendemain du début de la guerre, le 5 août 1914, la marine britannique neutralise les câbles sous-marins allemands et la liaison Tuckerton/Eilvese ainsi que la liaison Sayville/Nauen (opérée par l'Atlantic Communication Company) deviennent les seules lignes de communication entre l'Allemagne et les Etats-Unis, en position de neutralité. Les autorités américaines ferment un moment la station de Tuckerton, qui ne dispose pas de licence, mais la Homag obtient sa réouverture, en évoquant l'obligation de neutralité des Etats-Unis. Par décision du Président Wilson, la station est opérée sous contrôle technique et censure de la U.S. Navy. En janvier 1915, alors que les parts allemandes du capital de la CUTT ont été mise sous séquestre en France, la société française est enfin en mesure de revendiquer sa propriété sur la station américaine et intente un procès à la filiale américaine de la Homag,
Ce procès est d'importance stratégique car la prise de contrôle de la station de Tuckerton pourrait conduire à sa fermeture et à l'isolement complet de l'Allemagne. Marconi lui-même est à New York, mais pour un autre procès, qui l'oppose à l'Atlantic Communication Company sur des questions de brevets. Pour le contredire devant les tribunaux américains, la Telefunken a envoyé Ferdinand Braun, inventeur du tube cathodique, mais aussi expert en T.SF. et qui, en 1909, avait partagé le Prix Nobel de Physique avec l'inventeur italien. L'Italie entre en guerre le 23 mai et Roi rappelle Marconi. Le 3 juin 1915, Marconi fait une courte halte à Paris. Il est reçu chez Weiller, puis les deux hommes, tous deux inventeurs, investisseurs et membres de leur Parlement respectif, dînent ensemble au Ritz. On ne connaît pas le contenu de leur conversation, mais il est probable que le procès de la station de Tuckerton et l'avenir de la CUTT ont été parmi les sujets de conversation. La télévision aussi, peut-être, car Weiller dira après aux journalistes, mais ce n'était peut-être qu'une boutade, que M. Marconi invente des appareils qui permettent de voir au-delà des murs.
Le 5 août 1915 la CUTT se verra déboutée par le Tribunal du New Jersey et ne pourra entrer en possession de la station qu'à la fin de la guerre. Sans qu'on sache précisément quel a été le rôle de Weiller dans ce dossier, la CUTT sera finalement incorporée en 1919 dans un nouvelle société à majorité française, la Compagnie générale de Télégraphie sans fil (C.S.F.) dans laquelle la Marconi Wireless détenait 40 %. La Marconi finira par céder ses parts, permettant à la C.S.F. de devenir une force à part entière. Emile Girardeau, que Weiller avait voulu embaucher à la CUTT lorsqu'il n'était encore qu'une jeune dirigeant de la Société française de radioélectricité (S.F.R.) a raconté dans ses mémoires, Souvenirs d'une longue vie, comment la C.S.F. a revendu la station de Tuckerton à RCA, filiale en création de General Electric, en échange d'une compensation financière mais également d'un accès exclusif aux stations T.S.F. que la nouvelle société opérerait aux Etats Unis ainsi qu'un accès gratuit aux brevets de RCA en matière de radiodiffusion et de télévision. C'est ainsi que la C.S.F. a pu accéder au début des années 30 brevets de RCA sur l'iconoscope mis au point par Zworykin, pour les céder à la Compagnie générale des Compteurs. . Cette dernière cession permit à René Barthélemy d'abandonner la "roue Weiller" et le disque de Nipkow, avec lesquels il avait conçu ses premières démonstrations de télévision, au bénéfice de la technologie électronique.
Le résultat paradoxal de l'initiative de Weiller en 1912 en achetant les brevets de la "roue chantante" du Professeur Goldschmidt sera donc, une vingtaine d'annéess plus tard, de tuer définitivement sa propre invention, la "roue à miroirs".
L'affaire de la CUTT a laissé un goût amer à Lazare Weiller : certes il a pu en tirer des avantages financiers - ce qu'il reconnaîtra à Emile Girardeau - en entrant au capital de la Marconi Wireless, mais son projet de contrer l'hégémonie anglaise sur les communications transatlantiques a fait long feu et la coopération industrielle entre la France et l'Allemagne pour laquelle il avait plaidé a été anéantie par un conflit militaire sanglant. Dans un article "L'administration fossile des P.T.T.", il dénoncera en 1919 l'inertie des PTT qui ont empêché la réalisation de son ambitieux projets, laissant la France en retard en matière de télécommunications internationales.

Lazare Weiller, Les Grandes idées d'un grand peuple : mission diplomatique aux États-Unis, F. Juven, Paris, 1903.

Le banquier John Pierpont Morgan (1837-1913) photographié par Edward Steichen en 1913

Calèche avec taximètre, Place Saint-Sulpice, Paris

M. et Mme Lazare Weiller (au centre) et Wilbur Wright au Polygone d'Auvours, Le Mans (1908) [photographie de presse] / [Agence Rol] (Source : Gallica).

Dessin de A. BARRERE, "Les Mécènes de l'Air. M. et Mme Lazare Weiller, Fantasio, 1911.

Rudolf Goldschmidt et son alternateur. Photo reproduite avec l'aimable autorisattion de University Archive TU Darmstadt

Au second plan, l'amiral von Büchsel (1848-1920), futur Président de la Homag, avec l'Empereur Guillaume II, pendant des manoeuvres de la flotte navale (v.1902-1908). Photo Bundesarchiv.

Godfrey Isaacs, Directeur de la Marconi Wireless Telegraph Company

Guglielmo Marconi vers 1915

La tour de la station de Tuckerton en 1916

Emile Girardeau, que Weiller voulut recruter comme dirigeant de la CUTT

La Grimace, 25 mars 1917.
Le retour à la politique
Probablement déçu de ses expériences en matière de T.S.F., Weiller est retourné, dès avant l'éclatement de la guerre, à la politique. Il est élu député de la Charente aux élections du 10 mai 1914, "présenté par la réaction" selon Le XIXème siècle, mais ayant obtenu le soutien de l'Alliance démocratique (centre gauche). Le 26 avril, au premier tour, avec 7.279 voix sur 15.414 votants, il devançait le député sortant qui obtenait 6.321 voix. Au deuxième tour, le 10 mai, Weiller obtient le siège avec 8.313 voix sur 16.185 votants, contre 7.481 à Mairat. Il siège aux côtés de la gauche républicaine, il est membre de la commission de législation fiscale et de la commission des postes et télégraphes.
Pendant la Première Guerre mondiale il intervient en faveur de l'Alsace-Lorraine et de sa population et publie un rapport sur les activités de propagande allemande en Suisse. Il intervient aussi dans la discussion du projet de loi relatif à la participation de la France à l'exposition universelle et internationale de San Francisco, de la loi de finances de 1914, de la proposition de loi concernant la répartition de l'utilisation des hommes mobilisés et mobilisables, des interpellations sur la crise des transports. En juin 1915, il introduit une résolution visant au renforcement massif et rapide de l'administration des postes, téléphones et télégraphes et propose une autonomie de celle-ci. L'exposé des motifs est on ne peut plus explicite:"Jamais nous .n’aurons trop de postes, trop de télégra-phes* trop de téléphones. A vrai dire, nous sommes loin d'en avoir assez" (Le Journal des Débats politiques et littéraires 12 Juin 1915, Le Temps, 20 juin 1915). En février 1916, il demande la taxation des "bénéfices de guerre" réalisés de manière indue par certains industriels dans les marchés publics, tout en défendant l'initiative industrielle, créatrice de richesse. De Suisse, il publie dans Le Temps et dans La Revue de Paris des observations considérations de politique internationale, plaide pou l'isolement de l'Allemagne, l'indépendance de la Bulgarie. En 1917, il plaide dans Le Journal des Débats pour la reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Le 11 novembre 1918, jour de l'Armistice, il acclame à l'Assemblée nationale Georges Clémenceau pour le remercier de la libération de l'Alsace-Lorraine.
En octobre 1919, il plaide à la Chambre pour un statut transitoire de l'Alsace-Lorraine mais perd son siège de député de la Charente aux élections du 16 novembre 1919. qui ont lieu au scrutin de liste. Deuxième de la liste d'union républicaine et clemenciste il ne recueille que 20.570 voix sur 71.033 suffrages exprimés. Sa liste ne remporta qu'un siège qui échut à Poitou-Duplessy lequel avait recueilli 20.805 voix.
La rumeur circule alors qu'il aurait posé sa candidature comme Ambassadeur auprès du Saint-Siège, mais il est élu sénateur du Bas-Rhin le 11 janvier 1920, comme candidat de l'Union populaire républicaine. Il siège à la Commission des Affaires étrangères mais intervient également dans le dossier alsacien. Il effectue diverses missions en Angleterre, où il est, selon Le Temps, "en contact avec les personnalités les plus éminentes, en vue de déterminer les conditions d'une entente définitive". En novembre 1922 il s'inquiète de l'opinion revancharde qui se développe en Allemagne et et plaide pour une meilleure entente avec l('Angleterre sur l'attitude vis à vis de l'assainissement de la crise financière, des dettes de guerre et du dossier du Moyen-Orient. (Le Temps, 10 novembre 1922). Selon Jacques Mousseau, en 1924, il aurait suggéré au Président du Conseil, Raymond Poincaré, la formule qui permit de sauver le franc, attaqué sur toutes les places financières à la suite de l'envahissement de la Ruhr par les troupes françaises en représailles au non-paiement par l'Allemagne des sommes dues en réparation des dommages de guerre.
Il est favorable à la reconnaissance d'une statut particulier pour l'Alsace-Lorraine, réintégrée à la République française, tenant compte par exemple des avancées sociales de la période allemande. Il propose la reconnaissance de la nationalité française pour les Alsaciens né avant 1871 et propose des modalités de francisation des patronymes alsaciens, ce qui lui vaut de nombreux quolibets dans la presse nationaliste. Il s'installe alors à Sélestat, sa ville natale. Selon le témoignage de son fils Paul-Louis Weiller, il est un partisan convaincu de l'idée, lancée par Victor Hugo en 1849, des Etats-Unis d'Europe.
En matière économique, il défend l'affermage des monopoles d'Etat, notamment de la Régie des Tabacs mais semble se prononcer pour une levée régulée du monopole public sur le téléphone, suivant le modèle américain (Voir sa lettre à Eugène Lautier, Directeur de L'homme libre, 17 juillet 1926.).
Selon Le Temps, il se montrait sévère vis à vis des positions radicales de l'aile gauche de son parti - en novembre 1925 il signe une déclaration condamnant le mouvement autonomiste alsacien -, mais il est resté un homme de dialogue.
Ses positions sur les questions des relations sociales au sein de l'entreprise mériteraient une investigation. Il a certainement favorisé une politique sociale paternaliste, mais qui n'excluait pas des mesures fortes en cas de conflit. A plusieurs reprises la presse rapporte des grèves dans les usines Weiller. La première d'entre elles semble avoir eu lieu en février 1893 dans les laminoirs d'Angoulême (Le Temps, 8 et 10 février 1893). En 1897, avril 1897, les tréfileurs sont en grève suite à un passage du paiement à la pièce à un paiement à salaire fixe de la journée (Le Siècle, 4 avril 1897). Nouvelle grève des tréfileurs en août (Le Temps, 7 août 1897) et quelques semaines plus tard, alors que 250 des 1500 ouvriers des usines Lazare Weiller sont en grève - le personnel avait été mis en cause sur la mauvaise finition des fils et des sanctions avaient été définies - les grévistes sont menacés de licenciement et la grève dure plus d'une semaine (Le Petit Parisien, 7 septembre 1897, Le Temps, 12 et 15 septembre 1897). En août 1900, des grèves éclatent sur différents chantiers du Havre et l'armée est déployée pour maintenir l'ordre. La Presse (27 août 1900) rapporte qu'à l'usine Lazare Weiller, un poste de 50 hommes d'infanterie est installé. Le 26 octobre 1898, il y eu aux tréfileries du Havre des explosions faisant plusieurs morts. Le 15 novembre 1898, à l'usine de Graville, un ouvrier nommé Regnier, 26 ans, est happé par la machine et meurt syr le coup. (Le Petit Journal, 16 novembre 1898). Le 20 mai 1901, nouvelle explosion à l'usine de Graville-Sainte-Honorine, quatre ouvriers sont tués (Le Petit Parisien, 21 mai 1901). Comment Lazare Weiller réagit-il à ces drames ? Probablement par des actes de philanthropie empreinte de paternalisme, comme lui et sa femme en annonçaient de temps à autre dans la presse.
Dans son ouvrage sur les Etats-Unis, il analyse la mécanisation du travail, la formation des trusts et la nécessité pour les ouvriers de se regrouper en syndicats sectoriels plutôt que professionnels.. Une analyse que ne désapprouve pas l'Union fédérale des ouvriers des métallurgistes de France dans une brochure programmatique de 1903 qui le cite en confirmation de ses thèses contre les fédérations de métier. A la Chambre, il sera critiqué par les socialistes, durant la guerre, pour les bas salaires des employés de ses usines. Dans son roman historique sur les mouvements sociaux au Havre en 1922, Les émeutiers, (Payot, 2016), Philippe Huet évoque les "sbires" de la "société Weiller" face aux grévistes :"La société Weiller est un poids lourd de la métallurgie, un adversaire plus que coriace. Ce sont des durs, des puissants, qui ne les laissent jamais en paix. Jour après jour, la direction tente inlassablement de reprendre la situation en main sans lésiner sur les moyens de pression. Elle inonde les déserteurs de tracts et communiqués peu aimables, menace de les jeter sur le pavé s'ils ne reprennent pas le travail". Mais comme nous l'avons vu, en 1922, il n'y a plus de "société Weiller" au Havre.
Je n'ai pas repéré de texte ou d'intervention publique sur le statut des femmes, mais quelques anecdotes témoignent de sa sympathie pour les femmes à la recherche d'une émancipation individuelle : il interviendra dans un procès pour témoigner en faveur d'une jeune femme qui a fuit sa famille et sa nièce, la grande journaliste européenne Louise Weiss, a raconté dans ses mémoires comment il l'avait aidée à commencer sa carrière professionnelle.
Lazare Weiller est réélu au Sénat le 9 janvier 1927 par 710 voix sur 1219 votants. Selon le témoignage d'un sélestadien (Le Temps, 22 novembre 1928), il a cherché jusqu'à sa mort à encourager le dialogue entre les Alsaciens et le pouvoir parisien, sans toujours y arriver. Il s'inquiétait des collusions qui s'établissaient entre certains catholiques alsaciens et les communistes.
Lazare Weiller a au total, durant sa carrière, dirigé seize sociétés. Outre la présidence de la la Société des Tréfileries et Laminoirs du Havre, de la Compagnie universelle de télégraphie et téléphonie sans fil, de la Compagnie des automobiles de place et de la Société générale des compteurs de voiture, il a été administreur des Filatures et Tissages de Wittenheim, des Grandes malteries et brasseries de Colmar, lds Carrières des Charentes et du Poitou de plusieurs sociétés minières et électriques de la Banque du Rhin ; il était membre du conseil supérieur des Colonies. Il fut fait Commandeur de la Légion d'honneur en 1912.
Au-delà de ses activités industrielles, les opérations immobilières de Weiller témoignent de son aisance. En 1914, après son élection comme député de la Charente, il conçoit le projet construire une « maison alsacienne », inspirée d’un monastère de Sélestat, dans le quartier Saint-Cybard d'Angoulême. Il achète un à un de petits terrains et obtient un permis de construire en 1917. Il achète encore, en 1920, le château de Dampierre, qui jouxte cette propriété. N'ayant pas été réélu en 1918, il n'y habitera jamais. Elu Sénateur du Haut-Rhin en 1918 après la réintégration de l'Alsace à la France, il revient dans le berceau de sa famille, à Sélestat, et achète l’Hôtel de la Lieutenance, un vieil immeuble du XVIIème siècle qu'il fait aménager. En 1926, il fait également construire une villa de luxe, la Villa Isola Celesta à Cannes, célèbre pour sa roseraie, dont des photos couleurs d'époque ont été conservées.
Il meurt à l'âge de 70 ans dans sa propriété de Valmont-sur-Territet (Canton de Vaud) le 12 août 1928. Il sera inhumé à Angoulème auprès de sa première épouse. Le Président du Sénat, Paul Doumer, prononce son éloge à la séance du 7 novembre 1928.
Le sort tragique de Alice Javal-Weiller
Le patriotisme de Weiller pendant la Première Guerre mondiale, son action pour le rapprochement diplomatique avec le Vatican et ses positions modérées en Alsace avait fait taire les propos antisémites à son égard de la part de l'extrême-droite. Alors qu'en le 27 avril 1912, on pouvait lire dans L'Action française que celle-ci, "n'a jamais cru au sentiment français des Dreyfus et des Lazare Weiller qui souscrivent da,s les colonnes du Figaro", au lendemain de son décès, le 13 août, le même quotidien parle de lui avec respect. Dans un texte non publié, Charles Maurras salue un "Juif patriote". Mais en 1938, dans son pamphlet antisémite L'école des cadavres, Louis-Ferdinand Céline, dix ans après la mort de l'ingénieur, s'en prend à Edmond Barrachin, rédacteur en chef du Petit Journal, "apparenté aux Juifs Lazare-Weiller". Les propos sont repris, mots pour mots dans un autre pamphlet antisémite de Lucien Pemjean, disciple de Drumont, La presse et les Juifs en France depuis la Révolution jusqu'à nos jours, publié en 1941. Quelques mois plus tard, l'épouse de Lazare Weiller, Alice Javal, qui avait également des origines juives, sera déportée à Auschwitz, où elle mourra le 7 septembre 1943 à l'âge de 73 ans.

La maison alsacienne que Lazare Weiller fit construire à Angoulême, aujourd'hui Musée de la bande dessinée (Photo reproduite avec l'aimable autorsation du Patrimoine de Poitou-Charente).

Le château de Dampierre à Angoulême (Photo Patrimoine de Poitou-Charente)

Tiré-à-part du Discours prononcé par M. Lazare Weiller, Député de la Charente, à la séance de la Chambre des Députés du 13 juillet 1917. Sur l'Alsace-Lorraine, extrait du Journal officiel de la République française du 14 juillet 1917, Imprimerie des Journaux Officiels, Paris, 1917. Dédicace : "Pour Madame Alfred Pereire, devant qui j'ai prononcé ces paroles sur ma chère Alsace. L. Weiler. [sic]". Coll. Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg.


Lazare Weiller, La Dépression allemande vue de Suisse, Illustrations de Maurice Neumont, Union des grandes associations françaises, (s. d.). Écrit en août 1918 et publié après l'armistice.

"La taxation des bénéfices", Le Temps, 12 février 1916

"La Chambre. Séance du vendredi 13 octobre", Le Temps, 15 octobre 1916.

L'abbé Nicolas Delsor et Lazare Weiller, lsénateurs du Bas-Rhin : [photographie de presse] / [Agence Rol] (Source : Gallica)

Le sénateur Lazare Weiller,
Source Assemblée nationale

Visite du Président de la République Alexandre Millerand à La Lieutenance, la maison de Lazare Weiller, sénateur [à Sélestat, le 29 mai 1923] : [photographie de presse] / [Agence Rol] (Source : Gallica)
La Lieutenance, acquise par Lazare Weiller à Sélestat (Source : Alsace)

La villa Isola Celesta que Lazare fit construire à Cannes en 1926. (Photo Inventaire du Patrimoine de Provence Côte d'Azur.=

Alice Javal-Weiller
Lazare Weiller et les recherches sur la télévision
Nous ne disposons pas d'indications sur l'intérêt que Weiller a pu porter, après son article de 1889 aux progrès des recherches sur la télé-photographie et la télévision. A-t-il suivi les péripéties des annonces, largement diffusées dans la presse sur le télectroscope de Jan Szczepanik, dont le recours à des miroirs oscillants n'est pas tellement éloigné de sa propre conception ? Il apparaît dans un des comités préparatoires du Congrès international d'électricité qui se tient en août 1900 dans le cadre de l'Exposition universelle et où Constantin Perskyi fait une communication. Il n'apparaît pas dans la liste officielle des membres du Congrès. La crise au sein de son entreprise devait lui donner à ce moment là d'autres chats à fouetter. Nous ne savons rien son éventuel intérêt les travaux menés dans son sillage en France par J.H. Coblyn, Georges Rignoux et Etienne Bélin ou en Angleterre par John Logie Baird - que, théoriquement il aurait pu rencontrer lors de son dernier voyage à Londres, en mai 1928, quelques mois avant sa mort -, ni même sur le fait qu'il eût conscience, avant de mourir, que sa roue à miroirs avait été intégrée dans divers systèmes de télévision mécanique, en France, en Russie, en Allemagne et aux Etats-Unis. On imagine difficilement qu'un homme aussi informé, attentif aux innovations technologiques et aux opportunités industrielles, en contact avec un pionnier de la T.S.F. comme Marconi, n'ait pas continué à se tenir informé de ce chantier auquel il avait brièvement, mais brillamment, contribué.
L'apport théorique de Lazare Weiller à l'histoire de la télévision est incontestable. Le fait que cet apport soit resté purement théorique prête à réfléchir. Il semble en effet significatif qu'un esprit aussi visionnaire - à la fois du point de vue scientifique que du point de vue économique et politique - doté de capacités d'investissements et de soutiens puissants, au plus haut niveau, de la IIIème République, n'ait pas consacré plus d'efforts à la recherche et au développement sur la vision à distance. La télégraphie avec fil puis sans fil et les transports ont retenus son intérêt. Il est probable qu'il a perçu qu'il était prématuré de se lancer dans des opérations dont la faisabilité et la rentabilité ont dû lui paraître bien aléatoires.
André Lange, 5 mars 2018

"Roue Weiller" du récepteur de l'appareil de Karolus présenté à la Funkaustellung de Berlin de septembre 1928 moins d'un mois après la mort de Lazare Weiller. (Photo reproduite avec l'aimable autorisation du Deutsches Museum, Münich).
Sur ce site
"Sur la vision à distance par l'électricité", Le Génie Civil, XV, 12 octobre 1889, pp.570-573.
H.W., "Sur la vision à distance par l’électricité par L. Weiller", La Lumière électrique, 34, 16 nov. 1889. Traduction en anglais "Seeing to a distance by electricity", The Telegraphic Journal and Electrical Review, 29 November 1889
"The Transmission of Visual Images by Electricity", Science, December, 13, 1889, pp.401-402
Extrait de DRUMONT, E., La fin d'un monde. Etude psychologique et sociale, Albert Savine, Paris, 1889
Publications de Lazare Weiller
Lignes téléphoniques aériennes, emploi du fil de bronze phosphoreux, Conférence faite à l'exposition d'électricité de Paris par M. Lazare Weiller",... dans la réunion internationale des électriciens, séance du 15 octobre 1881, A. Derenne, Paris, 1881.
Recherches sur la conductibilité électrique des métaux et de leurs alliages, rapports avec la conductibilité calorifique, Communication faite à la Société internationale des électriciens, dans sa séance du 7 mai 1884, Impr. de Chaix, Paris, 1884 (Résumé dans La lumière électrique, 14 juin 1884 p.430-431)
Études électriques et mécaniques sur les corps solides, conférences par Lazare Weiller,..., J. Michelet, Paris, 1885.
"Observations relatives à une Note récente de M. Vaschy "Sur la propagation du courant dans une ligne télégraphique", Comptes-rendus hebdomadaires de l'Académie des Sciences, CVIII, 1889, p. 128. (Voir également :VASCHY, M., "Réponse à une revendication de M.L. Weiller", ibid., p.216).
"Nouveaux alliages industriels des métaux autres que le fer. Conférence à l'Exposition universelle de 1889. Congrès international des mines et de la métallurgie." Extrait du Bulletin de la Société de l'industrie minérale, 2e série, t. III, 3e livraison, 1889, Saint-Étienne, 1889.
"Sur la vision à distance par l'électricité", Le Génie Civil, XV, 12 octobre 1889, pp.570-573.
(avec VIVAREZ, H.), Traité général des lignes et transmissions électriques, G. Masson, Paris, 1892. (Recension par A.V. in La Lumière électrique, 30 juillet 1892p;245)
"La photographie des couleurs", Revue des deux mondes : recueil de la politique, de l'administration et des moeurs1 fasc.1894. 4e période. T. 122., mars-avril 1894.
Forges, fonderie, laminoirs et tréfilerie du cuivre pur et de ses alliages. Affinage et traitement électrolytique des métaux. Manuel pratique pour l'emploi des conducteurs électriques produits par les usines, Lazare Weiller et Cie, Paris,1894.
"La suppression des distances", in Revue des deux mondes, 1 fasc. 1898, 4e période, T.148, juillet-août 1898. Traduit en anglais : "The annihilation of distance", The Living Age, Volume 219, Issue 2832, Oct. 15, 1898, pp.163-178. (Recension dans Le Temps, 24 juillet 1898)
"Les sources de l'électricité" in Revue des deux mondes : recueil de la politique, de l'administration et des moeurs 1 fasc.1898. 4e période. T. 150., nov.-déc.1898 (Recension dans Le Temps, 27 décembre 1898).
Article "Cuivre", Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banque. Tome premier / publié sous la direction de MM. Yves Guyot et A. Raffalovich, Guillaumin, 1898, pp.1136-1142. (Recension dans Le Journal des Débats politiques et littéraires, 8 September 1899 ).
Les Grandes idées d'un grand peuple : mission diplomatique aux États-Unis, É. Mignot, Paris, (s. d.), [1900 ou 1901] (Note de lecture par E. Lautier dans Le Temps, 2 décembre 1903)
"Qu'est-ce que les trusts ?", Le Temps, 2 juillet 1902, 13 juillet 1902. 24 juillet 1902, 7 août 1902
"Les grandes idées d'un grand peuple", Le Figaro, 10 mars 1903.
Les Grandes idées d'un grand peuple : mission diplomatique aux États-Unis, F. Juven, Paris, 1903.
"Les cascades du cuivre", Le Temps, 2" octobre 1907.
"L'Aviation et l'aéroplane Wright". Compte rendu de la 52e réunion de la Société archéologique Le Vieux papier, le 22 décembre 1908. Extrait du Bulletin de la Société archéologique Le Vieux papier, Paris, 1909.
"J. Pierpont Morgan", France-Amérique, mai 1913.
"Une visite au bureau central militaire de Paris", Le Temps, 23 février 1915.
"Impressions de Suisse", La Nouvelle Revue, avril 1915.
Notes sur l'activité allemande en Suisse, S. l. n. d.[1915]
"La guerre vue de Suisse", Le Temps, 4 octobre 1915, 12 septembre 1916, 16 septembre 1916, 22 septembre 1916, 12 avril 1917, 22 avril 1917.
"Pourquoi la République doit rétablir les relations entre La France et le Saint-Siège", Journal des débats politiques et littéraires, 28 avril 1917, La revue hebdomadaire, 19 mai 1917.
Discours prononcé par M. Lazare Weiller, Député de la Charente, à la séance de la Chambre des Députés du 13 juillet 1917. Sur l'Alsace-Lorraine, extrait du Journal officiel de la République française du 14 juillet 1917, Imprimerie des Journaux Officiels, Paris, 1917
"La dépression allemande vue de Suisse", Le Temps, 22 septembre 1918.
La Dépression allemande vue de Suisse, Illustrations de Maurice Neumont, Union des grandes associations françaises, (s. d.). Écrit en août 1918 et publié après l'armistice.
"L'administration fossile des P.T.T.", L'information, janvier 1919
"Que faut-il faire pour l'Alsace ?"; La Marche de France, mars 1919.
"Préface" in STILWELL, A.E., Le Grand plan, la vraie Société des nations (traduit de l'américain [par C. Georges-Bazile]), Éditions des Cahiers britanniques et américains, Paris, 1919.
"L'Aslace-Lorraine et le Concordat", Journal des débats politiques et littéraires, 21 avril 1919
"Un geste", Le salut public, 10 mai 1919.
"La Guerre aurait-elle pu être terminée plus tôt ?", in La Revue de Paris, Paris, 15 août 1920,
"Préface" in BEHE, Martin, Heures inoubliables. Recueil des relations des fêtes de libération, des discours prononcés dans plus de 80 villes et villages d'Alsace et de Lorraine en novembre et décembre 1918 et des impressions personnelles des maréchaux et généraux, F.-X. Le Roux, Strasbourg, 1920.
Discours prononcé au Sénat par M. Lazare Weiller,... à la Séance du 13 décembre 1921 sur "La Reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège.", Impr. des journaux officiels, Paris, 1921.
"Souvenirs d'Amérique", Journal d'Alsace et de Lorraine, 16 juin 1921.
'Comment entretenir le rayonnement public de la France ?", La revue hebdomadaire, juillet 1922;
"Les moeurs, la politique et les affaires", Revue de Paris,1. Année 31. T. 4., Juillet-août 1924.
"Le mirage de l'esprit laïc", L'information, 9 octobre 1924
"Le salut financier pourrait être établi par l'affermage des monopoles d'Etat", Le Journal, 12 décembre 1925.
In memoriam. Pro Alsatia Paroles et écrits de Lazare Weiller,... publiés par son fils Paul-Louis Weiller, La Renaissance du Livre, Paris, 1925. Seconde édition Impr. de Crété, Corbeil, 1930
Schatten über dem Elsass! : ernstlich überlegte Betrachtungen eines Elsässers, ohne Vorurteil, ohneErbitterung noch Unwille gegen einen oder den andern seiner elsässischenLandsleute, s.l., ca 1926.
"L'Alsace d'aujourd'hui", Revue de Paris , 1927. 1. Année 34. T. 3. Mai-juin 1927
Notices biographiques
BELLAMY, H., "Le sénateur Lazare Weiller", Le Progrès civique, n°331 du 19 décembre 1925. et 2 janvier 1926.
C. Ba., "Weiller Jean Lazare", in Encyclopédie de l'Alsace, vol.12, Editions Publitotal, Strasbourg, 1986, pp.7707-7708.
CHARLES, A., "La télévision inventée par un Sélestadien", Alsacollections, n°9, Sélestat, 1995, pp.29-30.
COUSIN R, "Weiller Lazare", Site Mémoires de guerre, 10 janvier 2010.
DEVEZE G., "Lazare Weiller", La revue illustrée, 25 octobre 1911
JAEGER, J.A., "Sur la vie de M. Lazare Weiller", L'Alsace française, 26 août 1928.
JOLLY, J. "Lazare Weiller", Dictionnaire des parlementaires français, 1960-1977 (repris sur le site du Sénat).
LANGE A., "La rencontre entre Marconi et Lazare Weiller - La CUTT et l'échec d'une stratégie franco-allemande de communication transatlantique avant la Première Guerre mondiale", à paraître.
LANTHIER, P., "Lazare Weiller" in CHATRIOT, A., FRABOULET D., FRIDENSON, P. et JOLY, H. Dictionnaire historique des Patrons français, Flammarion 2010, p. 710-712
LEDOS, J.J., "Lazare Weiller", article du Dictionnaire historique de la télévision, L'Harmattan, 2013, pp.582-584.
"Lazare Weiller", Le Temps, 13 août 1928.
"Lazare Weiller", Wikipedia.fr, consulté le 3 janvier 2018.
LE GRIMACIER, "Lazare Weiller", La Grimace, 25 mars 1917.
THERMEAU G.M., "Lazare Weiller: un esprit visionnaire", Contrepoints, 16 octobre 2016.
UN VIEUX SELESTADIEN, "Figures alsaciennes. Lazare Weiller", Le Temps, 22 novembre 1928.
WEILLER, Paul-Louis, "Un Précurseur : Lazare Weiller", in Annuaire 1973 de la Société des Amis de la Bibliothèque de Sélestat, Sélestat, 1973, pp. 81-87. Le même article, "par ses enfants Marie-Thérèse Brulé et Paul-Louis Weiller, membre de l'Institut", 1973 a été déposé sous forme de tiré à part à la Bibliothèque nationale.
Etudes historiques évoquant Lazare Weiller
BERTIN C., Louise Weiss, Albin Michel, 2015.
BIRNBAUM, P. Les Fous de la République: Histoire politique des Juifs d'Etat, de Gambetta à Vichy, Fayard, 1992
BURNETT, T., Irishmen in the Great War: Reports from the Front 1915, Pen and Sword, 2015)
CHADEAU, E., "Poids des filières socio-culturelles et nature de l'invention: l'aéroplane en France jusqu'en 1908", L'Année sociologique, Troisième série, Vol. 36 (1986), pp. 93-112
CHADEAU, E., « Produire pour les électriciens : les Tréfileries et Laminoirs du Havre de 1897 à 1930 », in Des entreprises pour produire de l’électricité, Actes de l’Association pour l’histoire de l’électricité en France, Paris, PUF, 1988, p. 285-303
CHADEAU., E., L'économie du risque, Les entrepreneurs, 1850-1980, Olivier Orban, 1988.
CHAMPONNOIS, S. Les Wright et l’armée française : les débuts de l’aviation militaire (1900-1909), Revue historique des armées, n.255, 2009, p. 108-121
COCHET, M.N., Entre métallurgie et électricité : les Tréfileries et Laminoirs du Havre, des origines à 1912, Maîtrise d’histoire, Université Paris-IV Sorbonne.
GIRARDEAU, E., Souvenirs d'une longue vie, Berger-Levrault, 1968.
GRISET, P., Entreprise, technologie et souveraineté: les télécommunications transatlantiques de la France, XIXe-XXe siècles, Editions Rive droite, 1996
GROSSMAN, R., Le choix de Malraux. L'Alsace, une seconde patrie, La Nuée bleue, Strasbourg, 1997. (L'ancien maire de Strasbourg évoque, pp.74-76, l'amitié entre Malraux et Paul-Louis Weiller, ainsi que le père de celui-ci)
GUIERRE, M., Les Ondes et les hommes, Julliard, Paris, 1951.
HAU, M. et STOSKSOPF, N., Les dynasties alsaciennes, Editions Perrin, 2005, p. 284-287
JOLY, L., "D’une guerre l’autre. L’Action française et les Juifs, de l’Union sacrée à la Révolution nationale (1914-1944)", Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2012/4 (n° 59-4)
KRAGH, H., "The Krarup Cable: Invention and Early Development", Technology and Culture, Vol. 35, No. 1, January 1994, pp. 129-157
LAGANA M.; "A propos de l'interdépendance des milieux d'affaires et des milieux politiques : le cas des Tréfileries et laminoirs du Havre de 1901 à 1918", Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 66, n°242-243, 1er et 2e trimestres 1979. pp. 59-71.
MAILLARD, J.-L., Jean-Louis. "Capitaux et révolution industrielle au Havre", in Annales de Normandie, 31ᵉ année, n°2, 1981. pp. 147-164
MIRON, F., L'éclairage électrique: Traité pratique de montage & de conduite des installations d'éclairage, Librairie industrielle, 1896.
PEYREY, F, L'idée aérienne. Aviation. Les oiseaux artificiels, H. Dunod et E. Pinat, 1909
MOUSSEAU, J., Le siècle de Paul-Louis Weiller 1893-1993 : as de l'aviation de la Grande guerre, pionnier de l'industrie aéronautique, précurseur d'Air France, financier international, mécène des arts, Stock, 1998.
MOUSSEAU J., La conquête du ciel 1903-1933, Perrin, 2003.
TRIBOUT DE MOREMBERT, H., "L'ascension d'une famille juive d'Alsace. Les Weiller", Mémoires de l'Académie nationale de Metz, CLXXVIe Année - Série VII - Tome VIII, 1995, pp. 131-142.
VIVAREZ, H.E., Construction des réseaux électriques aériens en fils de bronze silicieux. Lignes télégraphiques, téléphoniques, transport de force, lumière électrique, Librairie centrale des sciences J. Michelet, 2ème édition 1885
WEISS, P. Le cuivre, J.B. Baillière, Paris, 1894.
WILKINS, M., The History of Foreign Investments in the United States to 1914, Harcard University Press, 1989.
Documents
"Cie des Etablissements Lazare Weiller", in EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900, Catalogue général officiel, Tome V, Electricité, Annexe pp. 279-286
Dossier Lazare Weiller dans la base LEONORE des personnalités décorées de la Légion d'Honneur.
HÔTEL DROUOT. Catalogue des tableaux modernes et aquarelles composant la collection Lazare Weiller. Paris, 29 Novembre 1901. La collection comprenait notamment des toiles de Monet, Félicien Rops, Pissarro, Renoir et Sisley.
OURRY Yann, Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. « La Maison alsacienne à Angoulême (Charente) » : construite en 1914 à la demande de Lazare Weiller à Angoulême, probablemement oeuvre de Louis Martin, architecte à Angoulème.
Une note financière du Monde illustré (1er décembre 1923)
sur l'absorption de la CUTT par la Compagnie générale des télégraphes.
Sites relatifs au début de l'aviation, aux frères Wright et au Prix Lazare Weiller :
Air Journal
Wright Brothers Aeroplane Company
André Lange 27 décembre 2001 - Révision complète, 5 mars 2018.