Une idée et son mythe : le "disque de Nipkow"
1. L'invention du téléscope électrique par Paul Nipkow
Paul Nipkow est certainement un des inventeurs ayant contribué à l'"invention de la télévision" sont le nom est le plus connu. La présentation du "disque de Nipkow" figure dans toute histoire de la télévision digne de ce nom, aussi brève et schématique soit elle, surpassant souvent en notoriété son système quasi contemporain, la "roue à miroirs" ou "roue de Weiller".
Un inventeur célèbre, mais méconnu
La célébrité de Nipkow tient au fit que les premiers systèmes de télévision opérationnels présentés en 1925 par C. Francis Jenkins aux Etats-Unis, John Logie Baird en Angleterre puis par René Barthémemy; Henri de France et Marc Chauvierre en France utilisaient des formes modernisées de "disque de Nipkow".. La notoriété de l'inventeur a également été renforcée par son utilisation de son nom, à partir de 1935, par le régime nazi à des fins de propagande nationaliste. Pourtant il n'existe pas, à ma connaissance, de monographie détaillée sur Paul Nipkow. Les historiens de la télévision comme système technique (Burns, Abramson) s'en tiennent à une présentation technique de l'invention principale de l'ingénieur allemand et néglige la biographie de celui-ci. A l'inverse, C.-D. Schmidt, un industriel allemand né comme Nipkow à Lebork, auteur d'une très utile monographie publiée par le musée de cette ville, de Nipkow, à l'occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance de l'inventeur, se focalise sur l'individu mais ne le situe pas vraiment dans l'histoire des développements scientifiques et techniques. Schmitt a le mérite de fournir de nombreux renseignements biographiques sur Nipkow, obtenus de membres de sa famille, ainsi que quelques documents conservés au Mitte Museum de Berlin, mais son livre présente d'importantes lacunes en ce qui concerne les travaux de l'inventeur sur la télévision : les sources autres qu'allemandes ne sont pas exploitées et le travail de Nipkow n'est pas vraiment positionné par rapport à celui de ses contemporains (1).
A l'inverse de la vie flamboyante de Lazare Weiller, inventeur de la roue à miroirs, système concurrent, le parcours de Nipkow paraît relativement terne, mais l'inventeur allemand a su, par quelques entretiens avec des journalistes de presse, au débat des années 30, créer lui-même la légende sur les circonstances de son invention. C'était une personnalité discrète et l'on ne connaît de lui que quatre déclarations à la presse, d'une convergence confondante .(2) Le premier de ces entretiens a lieu le 22 août 1930, le jour des 70 ans de Nipkow, avec un journaliste autrichien, K.H. Norweg. Norweg voit dans Nipkow le "prototype de l'inventeur" qui a eu une idée géniale mais n'a pu en tirer un sou. Fin 1932, un certain Wilhelm Schrage, correspondant en Allemagne des magazines de Hugo Gernsback Television et Radio News trouve par hasard les coordonnées de Paul Nipkow dans l'annuaire téléphonique de Berlin. Il le pensait russe, et probablement décédé, mais va, non sans émotion, rendre visite à l'inventeur, qui a alors 72 ans. Bien que bref, le récit de cet entretien est publié dans le numéro de janvier 1933 de Television et constitue une source précieuse. Quelques mois plus tard, le 6 août 1933, Nipkow a les honneurs du New York Times, à l'initiative de Orin Dunlap Jr., qui suit les actualités sur les développements de la radio pour le Scientific American et deviendra bientôt Vice-Président de RCA.
A partir de 1935, la gloire internationale de Nipkow va donner au régime nazi le projet de le récupérer dans le cadre d'une propagande nationaliste et ce qui biaise encore aujourd'hui certaines des narrations sur l'inventeur, présenté comme un génie unique, complètement déconnecté de son contexte scientifique.
Enfin, un malentendu existe sur l'invention de Nipkow, résumée en "disque de Nipkow" (Nipkow Scheibe). Or le disque - ou plus exactement les disques - ne sont que des éléments d'un appareil complet que l'inventeur lui-même désignait par le nom de "télescope électrique", en référence probable à la terminologie proposée en 1879 par Adriano de Paiva.
Dans son entretien avec K.H. Norweg, en 1930, Nipkow regrettait que personne ne s'intéressait vraiment à l'origine de son idée. Cela reste largement vrai aujourd'hui. Le présent article vise à combler cette lacune.
Un intérêt précoce pour la télescopie et les télecommunications
Paul Julius Gottlieb Nipkow est né le 22 août 1860 à Lauenburg, en Poméranie (aujourd'hui Lebork, en Pologne), où son père était boulanger et conseiller municipal. Il s'intéresse très tôt aux questions d'optique :
"Looking back half a century, I see myself having left the pro-gymasium in my native town of Lauenburg in Pomerania. I then went to the full-gymnasium in our little neighbor city of Neustadt to battle with Homer, Zenophon, Tacitus and Horace. And I was on the verge of launching several experiments aided by the pocket money of an advanced high-school boy. First, I made an astronomical telescope three meter in length out of pasteboard (3)
En avril 1882, il entreprend des études de mathématiques et de sciences physiques à l'Université Friedrich Wilhelm de Berlin. Il suit aussi les cours d'optique physiologique de Hermann von Heimholtz et ceux d’électrotechnique d'Adolf Slaby (futur pionnier de la T.S.F.) à l’Institut Technique de Charlottenbourg. Il est initié aux techniques de télécommunications par le professeur Zetzsche, qui a fondé en 1880 la revue Elektrotechnischen Zeitschrift (4). Selon la plupart des notices biographiques, il doit abandonner ses études pour des raisons financières, après la mort de son père, survenue le 13 novembre 1882. En fait, selon Schmitt, il n'a interrompu ses études qu'en août 1885, pour commencer un service militaire volontaire d'un an (Einjährige Freiwilliger") La raison en paraît simple, sa fiancée Sophia Colonius, rencontrée début 1883 était enceinte. Ils se marièrent le 12 décembre 1885 et leur première fille naquit quinze jours plus tard. (5).
Selon Walter Bruch, l'idée de créer un appareil de vision à distance lui serait venue le soir de Noël 1883, alors qu'il observait assis sa lampe à pétrole dans son appartement meublé du n°13 a de la Phillipstrasse, à Berlin-Mitte (6). Voici le récit qu'en donna Nipkow lui-même dans son interview au New York Times :
"One raw Winter evening I was cheered by receiving from the post-office the loan of a genuine Bell telephone for two hours" I lived in one room, which served as a living room, sleeping chamber, laboratory and workshop. The remarkable simplicity of the telephone astounded me. It gave me an idea and I constructed a microphone, using nails. It was successful in transmitting noises and words from one attic to another. This experience is what started me thinking about the problem of television.
That puzzle stayed with me from then on, even during the lectures of Helmholtz and Slaby in Berlin. Thus a sort of mental training along this line was developed in me and finally, on Christmas Eve, 1883, the solution came to me !
It was the general idea of television. And the details included the perforated spiral distributing disk. The mental experiment was a complete success. The idea of the invention were automatically at hand - as all everyday ideas are. How sure I was of having made a great discovery may be seen from the fact that, despite serious financial difficulties, I did not hesitate to spend the money needed to apply for a patent" (3).
Nipkow semble bien avoir créé lui-même ce mythe de la nuit de Noël déjà évoquée dans l'entretien avec Norweg. Lors de sa rencontre acvec W. Schrage, il raconte qu'il était tellement fou de joie - il se voyait riche - qu'il s'est mit à sauter dans son petit appartement au point que la propriétaire, inquiète, est venue voir ce qu'il se passait. Toujours est-il que le 6 janvier 1884, à l'âge de 24 ans, il dépose une demande brevet pour un "télescope électrique" - utilisant ainsi le vocabulaire proposé en 1879 par Adriano de Paiva. Selon un tradition non vérifiable, c'est sa fiancée Sophia Colonius, rencontrée au début de 1883, qu'il épousera le 12 décembre 1885, qui paya les frais d'enregistrement du brevet. Quinze jours après le mariage, Sophia mettait au monde leur première fille.
Le brevet de 1885 - Le télescope électrique
Le brevet est accordé le 15 janvier 1885 (7). Selon l'historien de la télévision Albert Abramson, ce brevet est le "master television patent", le premier brevet de l'histoire de la télévision, dont l'impact se fera sentir jusqu'à la fin des années 30. Le "disque de Nipkow" fut, jusqu'à l'avènement de la télévision électronique au milieu des années 30, un des deux principaux modèles de balayage de l'image, l'autre étant le tambour de miroirs conçu par Ll.B Atkinson en 1882 et théorisé par Lazare Weiller en 1889. Bien que le brevet de Nipkow soit cardinal dans l'histoire de la télévision, il ne semble pas qu'une traduction complète en ait été publiée en français ni même en anglais. La traduction en français que nous proposons ici doit être considérée comme provisoire et est certainement susceptible d'être améliorée par des spécialistes de l'électricité et de l'optique.
(7) NIPKOW, P. Elektrisches Teleskop. Patentiert im Deutschen Reiche vom 6. Januar 1884 ab, Patentschrift n°30105, Kaiserliches Patentamt, Ausgegeben den 15. Januar 1885. : (Source : DEPATISnet, Deutsches Patent- und Markenamt)

Graphique du "disque de Nipkow" dans la demande de brevet (1884).


(1) SCHMIDT, C.-D., Paul Nipkow. Erfinder des Fernsehens (1860-1940). Sein Leben für den technischen Fortschritt, Museum in Lebork, 2009. Paul Nipkow: wynalazca telewizji (1860-1940) : życie w służbie postępu, Lebork Muzeum, 2009. Voir "Lębork. Powstała biografia Paula Nipkowa', Gp24.pl, 20 juillet 2009.
(2) NORWEG, K.H., "Beim Vater des Fernsehens - Was der siebzigjährige Paul Nipkow erzählt", Neues Wiener Journal, Wien, Vom 23. August 1930 ; SCHRAGE W. "Nipkow still lives !, " Television News, n.2,, Jan-Feb. 1933 ; DUNLAP, O.D. "A Fifty-Year Riddle; Inventor of Television Disk in 1884 Tells How He Thought of the Idea -- He Applauds Latest Marvels", New York Times, August, 6, 1933. Je n'ai pu à ce jour identifier un quatrième entretien, réalisé par l'ingénieur, écrivain et journaliste allemand Eduard Rhein. D'autres entretiens dans la presse allemande existent peut-être, mais ne sont pas identifiés à ce jour, même par C.-D. Schmidt. Une étude du statut de Nipkow dans la presse grand public et dans la presse technique de la République de Weimar serait nécessaire.
(3) Lettre de Nipkow, citée in DUNLAP, art.cit.
(4) Karl Eduard Zetzsche (1830-Dresden, 1894) qui était l'éditeur du Elektrotechnischen Zeitschrift (Berlin) et a publié divers ouvrages sur la télégraphie :
-
Die Kopiertelegraphen, Typendrucktelegraphen und die Doppeltelegraphie, Leipzig, 1865
-
Kurzer Abriss der Geschichte der elektrischen Telegraphie, Berlin, 1874
-
Die Entwicklung der automatischen Telegraphie, Berlin, 1875
-
Handbuch der elektrischen Telegraphie, Berlin, 1877
Entre 1883 et 1894, il collabore régulièrement à la revue française La lumière électrique.
(5) L'acte de mariage (en allemand) est publié sur le site de la Ville de Lebork.
(6) BRUCH, W., Kleine Geschichte des deutschen Fernsehens. Buchreihe des SFB, Band 6, Haude und Spener, Berlin 1967, cité in SCHMITT, op.cit., pp.25-26.
.

La rue de la maison natale de Nipkow à Lauenburg en Poméranie, aujourd'hui Lebork, en Pologne (Photo : Site de la ville de Lebork, qui a créé une promenade Nipkow permettant de visiter les lieux où Nipkow passa son enfance)

Schéma du télectroscope de Nipkow. (PEETERS, J.J., "A History of television" in TV 50 Years, EBU/UER, Genève,1987. reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur).
Le disque de Nipkow
L'histoire a retenu l'expression "disque de Nipkow". En fait, il serait plus exact de parler des "disques de Nipkow". L'élément de base de l'appareil de Nipkow est constitué par constituées par un couple de disques : un disque de balayage, doté de trous de forme carrée et disposés en spirale et un disque de synthèse recomposant l'image pour l'observateur.
Trois parties sont à considérer dans le système :
-
la réalisation des mouvements synchroniques entre les deux stations (disque T et disque T1 )
-
la transformation du signal lumineux en signal électrique (analyse)
-
la transformation su signal inverse au poste de réception (synthèse)
Nipkow propose de forer de 24 trous les disques à intervalles réguliers le long d'une ligne en spirale. Le disque T tourne devant l'objet dont l'image est à transférer. Derrière le disque est disposé un panneau. Les distances entre les trous sont sélectionnées de sorte que le trou suivant apparaisse sur le bord droit de la fenêtre de l'iris dès qu'un trou atteint le bord gauche de la fenêtre de l'iris. Le disque est mis en mouvement de manière régulière par une horloge.

Paul Nipkow étudiant, vers 1884.

Un télescope électrique de Nipkow conservé au Telemuseet d'Oslo. Les précisions sur l'origine et la date de construction de cet appareil ne sont pas disponibles. Il s'agit probablement d'un appareil construit dans les années 20.
Hauteur : 110 cm, largeur 60 com, profondeur : 40 com.

Karl Eduard Zetzsche

"Le disque de Nipkow, sous sa forme la plus simple", HEMARDINQUER P., "Les progrès de la Radiovision en France", La Nature, 1er juin 1935

"La transmission électrique des images optiques", Revue du génie militaire, janvier 1929

Détail d'un disque de Nipkow. L'arc rouge décrit l'espacement d'une ligne de télévision. la cellule de sélénium convertit la luminosité en valeurs de résistance électrique. Source M2Consulting/PCMagazin
Lorsque le dernier des 24 trous atteint le bord gauche de l'ouverture, le disque a effectué une révolution complète en balayant une image entière de 24 lignes. Le balayage d'image commence au début avec la rotation suivante pour l'image suivante. Pour la transmission, la valeur de luminosité de chaque pixel que les ouvertures de disque respectives libèrent doit maintenant être convertie en une valeur électrique. En outre, Nipkow imagine une cellule de sélénium qui convertit la luminosité du point en une valeur de résistance électrique.
Pour le récepteur, Nipkow utilise un disque identique à celui du transmetteur, qui était également piloté par un mouvement d'horlogerie et donc synchronisé avec la station d'émission en tours uniformes. Du côté du récepteur, les valeurs de résistance obtenues du côté de l'émetteur par l'échantillonnage devaient à présent être converties à nouveau en valeurs de luminosité des pixels individuels.Les sources de lumière électrique présentes au moment de la demande de brevet étaient la lampe à arc de carbone et la lampe à filament déposé par Edison en 1879 pour un brevet. Les deux n'étaient pas adaptés pour la conversion directe des changements de luminosité rapides requis par le processus électromécanique de Nipkow. Il s'est donc inspiré de l'effet de la rotation de la polarisation de la lumière découverte par Michael Faraday en 1846. Dans ce cas, le plan de polarisation d'un faisceau lumineux, qui passe dans un milieu transparent, est entraîné en rotation par un champ magnétique le long de ce milieu.
Entre les deux disques, Nipkow imagine ce qu'il appelle la "station II" (figure 3 de son brevet) et que l(on appellera plus tard un "relais de lumière". La bobine N est enroulée autour du corps O, ce qui est approprié pour le plan de polarisation d'un passage à travers elle d'un faisceau de lumière polarisée sous l'influence d'un courant électrique balayant la spirale, p. un cylindre de Faraday en verre lourd, ou un tube rempli de disulfure de carbone, fermé des deux côtés par des plaques de verre plat. P est une source de lumière, Q une lentille convexe, R et S sont des prismes de Nicol. Un prisme Nicol est constitué de deux prismes reliés par un adhésif spécial. Il a la propriété de polariser le faisceau lumineux entrant d'une source lumineuse, de sorte qu'à la sortie du faisceau lumineux il n'y a qu'un seul niveau de vibration. Nipkow déclare que les deux prismes de Nicol sont torsadés l'un contre l'autre de sorte que la lumière de la source de lumière n'apparaisse plus à la sortie du "relais de lumière". Les plans de polarisation des deux prismes de Nicol sont alors perpendiculaires entre eux. Or, lorsque le courant traverse la bobine, l'effet Faraday fait tourner le plan de polarisation du faisceau lumineux en traversant la tige de verre et n'est plus perpendiculaire au plan de polarisation du prisme de Nicol à la sortie. Alors la lumière peut arriver. Avec la force du courant, l'angle de la rotation de polarisation et donc la luminosité peuvent être contrôlés.
Qu'en est-il de l'interaction des stations émettrice et réceptrice? La luminosité de chaque pixel (Bildungpunkt) (8) est convertie par la résistance au sélénium en une valeur de résistance analogue. La batterie entraîne un courant correspondant à la valeur de résistance à travers la bobine du «relais de lumière» et, par conséquent, la luminosité s'ajuste elle-même à la sortie du «relais de lumière». L'œil et le cerveau de l'observateur devant le disque tournant de Nipkow du récepteur réassemblent les élément de l'image originale à partir de la luminosité des pixels transmis individuellement.
Nipkow décrit dans son brevet d'autres modes de réalisation de son "relais de lumière", mais qui ne sont pas adaptés à la transmission d'images. De plus, il donne le conseil d'exécution suivant, qu'il justifie par des hypothèses sur le système visuel: l'œil subit une impression de lumière momentanée pendant 0,1 à 0,5 seconde. Une image cohérente résulterait de son "télescope électrique" si les deux tranches ont accompli une révolution en 0.1 secondes. Son système délivre donc 10 images par seconde.
(8) Sur la traduction de Bildpunkt par pixel, voir LYON, R.F., "A Brief history of 'pixel'", Digital photography, 2006. Lyon indique que J.R. Price (ingénieur chez Bell Telephone, inventeur du mot transistor), dans la présentation du disque de Nipkow qu'il donne dans son livre Electrons, Waves and Messages (1956), a traduit le terme Bildpunkt par picture element qui deviendra pixel chez un des pionniers de l'image numérique, Fred Billingsley, en 1965

Paul Nipkow vers 1887. (Source : SCHRAGE W. "Nipkow still lives !, " Radio Review and Television News, n.2,, Jan-Feb. 1933)
L'article de 1885
Le brevet est attribué le 15 janvier 1885. Nipkow, selon ses souvenirs, fait quelques présentation parmi les milieux professionnels et, quelques mois plus tard, publie un des rares articles, qu'on possède de lui et qu'il a écrit durant son service militaire : "Der Telephotograph und das elektrische Teleskop", Elektrotechnische Zeitschrift, 6, 1885, 419-425
Cet article commence par un état de la question dans lequel Nipkow affirme n'aboir pas eu connaissance de tous les travaux existants au moment où il a déposé son brevet et que ce n'est que durant l'été 1884 u'il a pris connaissance, grâce au Professeur Zetzsche des travaux d'Ayrton et Perry et de Bidwell.
Dans cet article, il revient sur le problème de la synchronisation des deux disques. Il abandonne les deux mécanismes d'horloge envisagés dans la demande de brevet et suggère le recours à des "roues crénelées", sur le modèle décrit par La Cour en 1878 et 1882.(9) Il s'agit de a "roue phonique" (phonic wheel) dont le danois Poul La Cour et l'Américain Patrick B. Delany allaient se disputer l'invention en 1886 (10). Le mécanisme a été inventé en août 1875 et breveté en 1877 par La Cour. Il s'agit d'un moteur synchrone entraîné par un diapason, qui utilisait un électro-aimant pour faire tourner la roue dentée du moteur d'une dent pour chaque vibration. Avec deux roues phoniques synchrones à distance, une multitude de dispositifs télégraphiques étaient possibles.

(9) DAGUENET.C. "PAUL LA COUR. - Das Tonrad (La roue phonique)" Copenhague, 1878. J. Phys. Theor. Appl., 1879, 8 (1), pp.213-213.
L’instrument consiste en une roue dentée de fer doux, mobile autour d’un axe vertical, en face du pôle d’un électro-aimant placé dans son plan. Ce pôle est assez petit pour agir sur une seule dent à la fois. Lorsqu’on fait passer dans le fil un courant interrompu par un diapason ( courant phono-électrique), et qu’on donne à la roue une vitesse telle que le nombre de dents qui passent devant le pôle dans un temps donné soit égal au nombre d’interruptions pendant le même temps, le mouvement continue avec la même vitesse ; c’est la vitesse régulière de la roue. On pourrait aussi obtenir des vitesses mul tiples ou sous-multiples, mais cet état d’équilibre serait moins stable que le premier. Les irrégularités du mouvement disparaissent, si le moment d’inertie de l’appareil est suffisamment grand; on obtient facilement cette régularité en plaçant sur la roue un disque de bois creusé d’une rainure circulaire remplie de mercure ; le métal agit à la fois par son poids et par son frottement sur le disque pour maintenir la vitesse constante. On peut faire varier entre des limites étendues le nombre des dents et le nombre de vibrations du diapason interrupteur, et obtenir ainsi un mouvement de rotation régulier plus ou moins rapide, applicable à des chronographes, à des appareils synchrones dans la télégraphie, etc.
(10) Report of the special committee appointed october 20, 1886, to investigate the protest of poul la cour against an award of the elliot cresson medal to Patrick B. Delany for his synchronous multiplex telegraph system, Journal of the Franklin Institute, Volume 124, Issue 2, August 1887, Pages 81-108

Les deux graphiques illustrant l'appareil de Nipkow dans son article "Der Telephotograph und das elektrische Teleskop", Elektrotechnische Zeitschrift, 6, 1885, 419-425
La légende de l'invention et les sources de celles-ci
Il existe autour de l'invention de Nipkow une légende répétée dans de nombreuses notices biographiques : "D'après ses propres souvenirs, l'idée lui en serait venue le soir de Noël 1883, alors qu'il observait assis sa lampe à pétrole dans son appartement meublé du n°13a de la Phillipstrasse, à Berlin-Mitte : il s'agissait de recomposer une image couleur par projection d'une mosaïque de points de couleurs sur un disque spiralé." (11) Je ne sais où Walter Bruch, réputé être l'inventeur du système PAL de télévision en couleur, est allé chercher cette histoire de lampe à pétrole, qui n'apparaît dans aucun des trois entretiens connus de Nipkow avec les journalistes.
Dans sa lettre au New York Times, Nipkow évoque le contexte de son invention (12) : "Now, however, my pen hesitates? Did I at that time think about the scope and future of the 'electric telescope', alias television ? Hardly! We must remember that in those days the use of the telephone was only in its first stages. Indeed the idea of television over the telephone wires appeared before me. But then Heinrich Herz (discoverer of Hertzian waves) had not yet taught. Marconi had not telegraphed. How then, could such far-flung ideas have come to the modest student of philosophy ? No; my thoughts and worries during the next decades were devoted to my professional work, which was the practical development of the system of making railroad traffic safe. Only occasionaly was I able to give any time to my first love - television". Dans son entretien avec Norweg en 1930, Nipkow était plus explicite sur la fonctionnalité de son idée : il s'agissait bien d'un appareil permettant à des interlocuteurs téléphoniques de se voir pendant l'entretien. L'dée d'une diffusion de masse était donc absente, comme chez la plupart des concepteurs de l'époque.
L'image que Nipkow donne de lui-même en modeste étudiant en philosophie prête à sourire dès lors qu'on examine de près son brevet et son texte de 1885 : il a eu connaissance étendue et précise des travaux récents dans le domaine de l'électricité et de l'optique et connaît, par Zetzsche, les travaux pionniers de Caselli et Bain en télégraphie des images. Il peut avoir ignoré, en janvier 1884, les travaux britanniques de Ayrton, Perry et Bidwell, mais il connaissait les travaux de Bell et Tainter sur le photophone, et, lecteur de La lumière électrique, il ne pouvait ignorer les contributions de de Paiva et Senlecq, abondamment commentée par Th.du Moncel.
L'idée des disques perforés peut lui être venue en étudiant le photophone de Bell et Tainter, mais plus encore celui de Mercadier qui proposait en 1881 la "roue interruptrice".(13). Différents systèmes optiques à base de disques rotatifs existaient dans la recherche optique comme l'anothorscope (1827) et le phénakistiscope (1832) de Joseph Plateau, exploités sous formes de jouets ou encore le disque rotatif de Charles Wheatsone (1841) conçu pour des applications en télégraphie Morse. La "roue interruptrice" de Mercadier est un perfectionnement du photophone de Bell : une roue de de verree recouverte de papiers noiris est percée de plusieurs rangées de trous concentriques qui permettent de capter les intensités lumineuses et d'en percevoir les effets sonores à travers un cornet accoustique.
(11) Voir par exemple la notice sur Nipkow du site du Deutsches Fernsehmuseum et l'article "Paul Nipkow" de Wikipedia.fr, traduit de Wikipedia.de, (consulté le 25 décembre 2017) qui cite Walter Bruch, Kleine Geschichte des deutschen Fernsehens, 1967, S. 14
(12) In DUNLAP, art..cit.
(13) MERCADIER, E., "La Radiophonie", La lumière électrique, 1er janvier 1881. Un des photophones conservés au Musée des Arts et métiers dispose dispose d'une roue perforée. Voir photo 0002117_005 Voir également, DU MONCEL Th.n Le microphone, le radiophone et le phonographe, Hachette, 1882, p.146 ; "Radiophonie", Elektrotechnische Zeitschrift, Juni 1881, pp.198-203)

Disque du phénakistiscope de Plateau

Le disque rotatif de Charles Wheatsone (1841) (Annual Report of Commission of Patent, 1846)
La roue interruptrice de Mercadier (1881), source d'inspiration possible de Nipkow.


Le radiophone avec roue perforée de Mercadier (DU MONCEL Th.n Le microphone, le radiophone et le phonographe, Hachette, 1882, p.146 et. s.)

Le radiophone avec roue perforée de Mercadier (in SARTIAUX E. et ALIAMET. M. Principales découvertes et publications concernant l'électricité de 1562 1900, Rueff, 1900; p.34)

Radiophone à disque perforé de Tainter
("Radiophonie", Elektrotechnische Zeitschrift, Juni 1881, pp.198-203)
Le photophone de Bell et Tainter, les radiophones à disques perforés de Mercadier et de Tainter avaient été largement décrits dans différents numéros de la revue Elektrotechnische Zeitschrift en 1881. Certes les radiophones de Mercadier et de Tainter étaient des appareils de recomposition du son à partir d'impulsion lumineuse et ils ne concernaient pas la transmission des images. Mais ils ont pu fournir à Nipkow un modèle conceptuel. Quoiqu'il en soit, comme me le fait remarquer Mark Schubin, l'originalité de Nipkow réside dans le recours à un disque perforé avec des trous en spirales, ce qui ne produit pas seulement des lignes de balayage (que l'on trouvait déjà chez Bain, Senlecq, Bidwell,...) mais aussi des cadres continus.
Les commentateurs de Nipkow, y compris les rares commentateurs qui lui furent contemporains, ont douté que Nipkow ait jamais expérimenté son appareil. C'est une interprétation qui colle mal avec l'image du jeune Nipkow actif expérimentateur sur un téléphone et avec les détails et les alternatives suggérées dans la demande de brevet. Il me paraît plus probable que Nipkow a, d'une manière ou d'une autre, fait des expériences, mais que celles-ci n'ayant pas été concluantes, il n'en a rien dit et n'a jamais envisagé une démonstration publique. Quoi qu'il en soit, K.L. Maul (14) résume bien pourquoi l'appareil ne pouvait pas fonctionner en 1884 :
-
La cellule au sélénium utilisée aurait été trop léthargique pour traduire les luminosités des pixels.
-
Le "relais de lumière" basé sur l'effet de Faraday aurait nécessité de tels courants élevés pour la rotation de la polarisation qu'ils n'auraient pas pu être générés avec une seule cellule au sélénium.
-
L'auto-induction de la bobine du «relais de lumière» n'aurait pas permis les changements rapides du courant requis pour la transmission de l'image.
-
La synchronisation des deux lecteurs de disque n'a pas été résolue.
Nipkow abandonne ses travaux sur le télescope électrique mais non la recherche
Après avoir obtenu son brevet et publié son article de 1885, Nipkow a abandonné ses recherches dans le domaine de la télévision, pour n'y revenir que dans les années 20. Lorsqu'en 1932 W. Schrager lui demande si il a proposé son appareil aux services de la Poste ou si il a trouvé une autre possibilité de l'utiliser, il répond 'Ni l'une ni l'autre. J'étais tellement pauvre que j'ai du laisser expirer mon brevet après un an. Je n'avais même pas l'argent pour continuer mes études, pour ne pas parler de l'argent qui aurait été nécessaire pour des expériences."
Quelques explications juridiques sont nécessaires pour comprendre pourquoi Nipkow n'a pas pu maintenir ses droits sur son brevet. Selon les articles 7-8, de la loi des brevets allemande de 1877, la durée du brevet est de quinze ans; la durée de ce délai court à compter du jour suivant le dépôt de l'invention. Par contre, pour chaque brevet, une taxe de 30 marks doit être payée pour chaque brevet. En outre, une taxe est perçue pour chaque brevet à partir du début de la deuxième année et pour chaque année suivante; cette taxe est de 50 marks pour la première fois et continue à augmenter de 50 marks par an. Le breveté qui prouve qu'il en a besoin peut différer les taxes pour la première et la deuxième année de la durée du brevet jusqu'à la troisième année et, si le brevet expire au cours de la troisième année, il peut y renoncer. Selon l'article 9, le brevet expire si le breveté y renonce ou si les taxes ne sont pas payées dans les trois mois suivant la date d'échéance au plus tard. (15)
La suite de sa vie jusqu'au début des années 20 a souvent été considérée comme éloignée des recherches. En fait, il n'en est rien. En 1886, le registre de la Elektronisches Verein de 1886 dont il est membre le présente comme "cand. philo " Il publie encore, en 1887 et 1889 trois articles dans le Elektrotechnische Zeitschrift sur les convertisseurs électriques et sur la mesure du courant alternatif, le sujet qui amènera Ferdinand Braun, quatre ans plus tard,à inventer le tube cathodique.
Après l'interruption de ses études, Nipkow passe une année au bataillon de chemin de fer à Berlin-Schöneberg .Après son service militaire, il est engagé par la société Zimmermann et Buchloh, spécilaisée dans la signalisation pour les chemins de fer, où il terminera sa carrière en 1919 avec le titre d'ingénieur principal (Oberingenieur). Au sein de cette entreprise, il conçoit différents appareils : verrou escargot (Schnekenriegel), Kit de rebondissement (Preelbockuntersatz), bloc mécanique et rouleau de compensation pour les signaux ferroviaires.
Entre 1886 et 1891, six brevets sur des sujets assez divers : relais à induction, microphone à courant alternatif, circuit pour la génération de moteurs de courants alternatifs avec des phases décalées utilisées pour l'excitation des aimants de champ, appareil pour entraîner simultanément le mouvement de rotation et le mouvement longitudinal d'une broche, Les deux derniers, obtenus en 1889, concernent un projet d'aéronef à hélice, inspiré des ailes des libellules. Il était en effet, comme d'autres des chercheurs que nous rencontrons dans cette histoire (Constantin Senlecq, Graham Bell, Clément Ader, Henry Sutton, Lazare Weiller,...) un passionné d'aéronautique. Son modèle d'aéronef basé sur le modèle des insectes était clairement en opposition à celui d'Otto Lilenthal (1848 - 1896).
La famille Nipkow va s'aggrandir au fil des ans, avec trois filles et trois garçons. Elle déménage plusieurs fois, dans le quartier de Pankow. La vie visiblement tranquille de Nipkow bascule en 1919 avec le décès de sa mère, puis le 31 juillet 1919 par son départ à la retraite anticipé, son employeur ayant considéré qu les circonstances politiques conduisent à une réduction de la demande et qu'il est temps de se séparer d'un employé avec lequel les relations ont été cordiales pendant 33 ans. Nipkow a 59 ans, il touche une pension mensuelle de 250 000 marks. Les années 20 paraissent avoir été difficiles : non seulement les revenus du travail, mais aussi les économies, investies dans des emprunts d'Etat, avaient disparus.
Nipkow reprend ses recherches sur l'image en 1919
Selon son biographe, C.R. Schmitt, Nipkow aurait repris ses travaux sur la télévision en 1924, en prenant connaissance par la presse des travaux sur la télévision du Professeur de Physique de l'Université de Leipig, August Karolus. Cette vision des choses ne résiste pas à l'analyse. On peut imaginer qu'il était resté en contact avec le milieu des électriciens berlinois et qu'il avait accès, d'une manière ou d'une autres, aux revues techniques assurant la veille des brevets. Il ne peut être resté insensible aux développements de la T.S.F. et du cinéma. En effet, dès le 22 mai 1921 Nipkow dépose une nouvelle demande de brevet sur un procédé d'enregistrement et de reproduction d'images animées utilisant une bande d'image en continu et un élément d'exposition en mouvement continu, brevet qui lui sera accordé le 7 janvier 1924 (N. 388005). Ce brevet concerne une amélioration du Kinetograph de Frank Fowell, évoqué dès le premier paragraphe, qui avait obtenu un brevet britannique en 1915. Selon la recension de Science et industrie photographique (1er avril 1925) "Les images sont enregistrées au travers d'un obturateur flexible fenestré, se déplaçant dans le même sens que le film, ou dans le sens opposé". Cela indique clairement que Nipkow s'était tenu au courant - ou en tout cas remis à jour - des développements en cours, y compris sur des découvertes de notoriété plutôt réduite.
Son véritable retour dans le domaine de la recherche sur la télévision intervient le 9 décembre 1924 lorsqu'il il dépose une demande de brevet pour un dispositif de synchronisation dans un appareil de transmission d'image électrique, qui lui sera accordé le 1er mai 1930 (N. 498415), dans lequel il propose, pour la synchronisation des stations d'émission et de réception, le recours au courant alternatif. Il précise que cette proposition est valable aussi bien pour les appareils à disques, que pour ceux à roues de miroirs ou à tube cathodique, autre évidence qu'il est bien au courant des alternatives proposées à son idée de 1885. Ce brevet sera acquis en 1930 par la société Siemens & Halske de Berlin.
C'est probablement à ces deux brevets que Nipkow fait allusion, dans son entretien avec Schrage, fin 1932, en parlant d'un brevet sur la synchronisation et d'un brevet dit du "moulin à images" (picture mill).
La suggestion de Schmitt selon laquelle ce sont les annonces de presse relatives à l'appareil de Karolus, sauf documents non connus qui seraient à produire, paraît bien être un anachronisme : Karolus a déposé le 21 juin 1924 une demande de brevet relative à la cellule de Kerr, mais sa première demande de brevet pour un appareil de télévision n'a été déposée que le 5 septembre 1925. Il ne semble pas qu'il ait communiqué au sujet de son appareil avant novembre 1926.
La réaction de Nipkow est probablement plus le résultat de ce qu'il a pu lire au sujet des premières expériences de John Logie Baird, que celui présente dans son article "An Account of some experiments in television", Wireless World and Radio Review, 7th May 1924, dans lequel l'inventeur écossais décrivait pour la première fois son premier appareil recourant à un disque percé. Les trous n'étaient pas en spirale, le nom de Nipkow n'était pas cité, mais le principe de base était bien celui qu'il avait suggéré en 1884. Nipkow, qui n'avait pas renouvelé les droits de son brevets de 1885, a dû se sentir lésé. Fin 1932, il déclare à Schrage : "Ce que les autres on produit avec le téléviseur à disque - sur base de mon brevet de base - ne va pas mettre le feu au monde. Après tout, c'est essentiellement mon vieux concept, perfectionné suivant l'état actuel des technologies".
Dans le prolongement du brevet 498 415, il dépose une autre application, le 27 août 1927 qui vise à résoudre le problème de la transmission des images dans le cadre de l'interconnexion transfrontalière des réseaux d'électricité. Le brevet sera accordé le 26 mai 1932.
Par la suite, il obtiendra encore deux autres brevets : le brevet 577533, dont la demande a été introduite le 2 décembre 1930 , et qui est accordé le 1er juin 1933 porte également sur la synchronisation. Le dernier brevet, pour lequel la demande a été introduite le 10 mai 1938 (à l'âge de 78 ans !) porte sur un "extracteur d'images rotatif" (Bildzerleger) à usage de télévision, est accordé le 29 décembre 1939. Il est tellement passé inaperçu que même Georges Shiers ne le cite pas dans son impressionnante bibliographie Early Television.
Au total, l'inventeur de Pankow aura obtenu pas moins de 13 brevets, mais un seul a fait sa gloire. Ces dernières vingt années de travail de Nipkow nous paraissent aujourd'hui plus symboliques que réellement marquantes. Mais il nous faut à présent examiner l'impact de la proposition de 1884/1885, puis examiner l'aspect navrant des dernières années de la vie de l'inventeur berlinois : la récupération de sa gloire nouvelle par la propagande nationaliste du régime nazi.
Documents
Brevets de Nipkow
-
Elektrisches Teleskop. Patentiert im Deutscchen Reiche vom 6. Januar 1884 ab, Patentschrift n°30105, Kaiserliches Patentamt, Ausgegeben den 15. Januar 1885.
-
Induktionsrelais, Patentschriften, n.33833, 1885 ou 1886, Voir Elektrotechnische Zeitschrift, 1886, p. 46.
-
Mikrophon mit Wechselstrom im primären Kreis, Patent vom 31.10.1888, Number 47506. (cité dans Elektrotechnische Zeitschrift,, 10, 1889) p;458 et La lumière électrique, 9 novembre 1889, pp.271-272)
-
Schaltung für Wechselstromkraftmaschinen-Erzeugung der zur Erregung der Feldmagnete benutzten Wechslströme mit verschobenen Phasen, Patent vom 4.10.1889 mit der Nummer 57396.
-
Rotierendes magnetisches Field, Patent vom 4.10.1889 mit der Nummer 56741.
-
Schaltung der Ankrtwucklung für Wechselstromkraftmaschinen, Patent vom 15.4.1890 mit der Nummer 58723
-
Vorrichtung zur Erziehung gleichzeitiger Dreh-und Längsbewegung einer Spindel, Patent von 20.1.1893 mit Nummer 73311
-
Rad mit beweglichen Schaufeln für Luftfahrzeuge, (Insektenflugzug-Libelle) Patent vom 14.9.1897 mit der Nummer 116287 und 112506
-
Verfahren zum Aufnehmen und Wiedergeben bewegter Bilder unter Verwendung eines stetiglaufenden Bildbandes und eines stetig laufenden Belichtungsgliedesn Patent von 07.01.1924 mit der Number 388005A demande introduite le 22.5.1921)
-
Einrichtung zur Erzielung des Synchronismus bei Apparaten zur elektrischen Bildübertragung. - Patent vom 1. Mai 1930 mit der Number 498415 (Demande brevet déposée le 9 décembre 1924, brevet accordé le 1er mai 1930.)
-
Verfahren zur Erzielung des Gleichlaufs bei elektrischen Bilduebertragungsanlagen - Patent vom 15.6.1932 mit der Number 552675A (demande introduite le 27.8.1927)
-
Synchronisierverfahren bei Apparaten zur elektrischen Bilduebertragung - Patent vom 1.6.1933 mit der Number 577553 (demande introduite le 2.12.1930)
-
Rotierende Bildzerleger- bzw. Zusammensetzanordnung fuer Fernsehzwecke - Patent vom 29.12.1939 mit der Number 685917 (demande introduite le 10.5.1938)
Articles de Nipkow
-
NIPKOW, P., "Der Telephotograph und das elektrische Teleskop", Elektrotechnische Zeitschrift, 6, 1885, 419-425
-
"Versuche über die Bestimmung der Koeffizienten der Selbsinduktion von Telephonen", Elektrotechnische Zeitschrift,, 8, 1887, pp.347-348
-
"Transformator für Gleichstorm", , Elektrotechnische Zeitschrift,, 8, 1887, p.538-539.
-
"Messinstrument für Wechselströme mit isolierten Drehkörper", Elektrotechnische Zeitschrift,, 10, 1889, pp. 28-29.
Comptes-rendus d'époque de l'article de 1885 sur le télescope électrique
-
"Seeing by Electricity", The Electrical World, New York, November, 14, 1885
-
CLEMENCEAU, P., "De la vision des objets à grande distance", La lumière électrique, Paris, 5 décembre 1885, pp.433-440
-
"On parle depuis quelque temps...", La lumière électrique, 12 décembre 1885
-
"Das electrische Teleskop"., Elektrotechnische Zeitschrift, 1886
-
"La transmission des phénomènes visibles par l'électricité", L'Année électrique Trosième année, janvier 1887, pp. 362-363
-
WALLENTIN I.G., 'Ueber das Fernsehen mittels Elektricität mit besonderer Berücksichtigung des "elektrsichen Teleskope" von P. NIPKOW, Central-Zeitung für Optik und Mechanik 9, 1888, 97-101.
-
LIESEGANG R.E., Beiträge zum Problem des elektrischen Fernsehens, Liesegang's Verlag, 1891.
-
Compte-rendu in BUDDE R., Die Fortschritte der Physik ces Aether im Jahre 1885, Verlag von Georg Reimer, 1891, pp.256-257
-
BERTHIER, A., "La télectroscopie", Cosmos, 17 juin 1893, pp.362-366 ; suite, 25 juin 1893, pp. 391-394 ; suite et fin, 1er juillet 1893, pp.425-428
Autres
-
Film des funérailles de Nipkow.- L'INA possède dans ses archives un film des Actualités mondiales (diffusé en France le 18 septembre 1940) des funérailles officielles de Nipkow (18 août 1940) où l'on peut voir des officiels nazis et des drapeaux à la croix gammé. Voir également les photographies conservées à l'Österreisische Nationalbibliothek.
-
Pankower Fernseh-Geschichte (Quelques documents sur le Paul Nipkow Fernsehsender, installé à Pankow) ( (> Historisches Heimatarchiv Pankow-Berlin par Willy Manns)
Bibliographie des textes et articles sur Paul Nipkow
-
BENEKE, K. "Nipkow, Paul Julius Gottlieb (22.08.1860 Lauenburg, Pommern - 24.08.1940 Berlin)", Site Histoire de la télévision, 2002.
-
"Die Nipkow-Story", Deutsches Fernsehmuseum (1) Wiesbaden, consulté le 12 janvier 2018.
-
DUNLAP, O.D. "A Fifty-Year Riddle; Inventor of Television Disk in 1884 Tells How He Thought of the Idea -- He Applauds Latest Marvels", New York Times, August, 6, 1933.
-
GOEBEL, G., "Paul Nipkow - Versuch eines posthumen Interviews", in Fernseh-Rundschau, 4, (1960), 8, pp. 334-348.
-
GOEBEL, G., "Paul Nipkow", in Elektrotechnische Zeitschrift, 12 (1960), 20, pp. 490.
-
GOEBEL G., "Aus der Geschichte des Fernsehens. Die ersten fünfzig Jahre". in: Robert Bosch GmbH/Bosch Technische Berichte, vol. 6 (1979) p. 211–235.
-
HAGEMMEYER, F W,, "Information und Kommunikation". In: Troitzsch U, Weber W (Hg), Die Technik. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Unipart-Verlag, Stuttgart, 1987, pp. 420-432
-
KNIESTEDT J., "Die Grundidee de elektrischen Fernsehens von 1884". in Archiv für das Post- und Fernmeldewesen vol. 36. Nr. 1 (Februar 1984) p. 35–51.
-
KRAWINKEL, G., "Paul Nipkow", Elektrotechnische Zeitschrift, 5 September 1940,p. 840
-
KRÜTZEN M., "Der Punkt / Die Matrix. Paul Nipkows Scheibe, Vilém Flussers Universum und der Würfel der Borg". in ENGELL L. und SIEGERT B. (Hrsg.), Licht und Leitung. Archiv für Mediengeschichte, Universitätsverlag, Weimar 2002
-
LINDNER, H., "Nipkow, Paul" in New German Biography 19 (1999), page 279
-
MAUL, K.L., "Das erste deutsche Fernsehpatent von Paul Nipkow", PC Magazin, 30 Mai 2015.
-
MÖBUS W., Wegbereiter der Funktechnik, Radio-Praktiker-Bücherei (RPB), Band 35 - 1. Auflage 1951
-
"Nipkow, Paul Julius Gottlieb"in ROLLKA, B., SPIESS, V., THRIENE, B. (Hrsg.), Berliner Biographischer Lexikon, Hemde und Spanersche, Verlagsbuchhandlung GmbH, Berlin, 1993, p.298.
-
"Nipkow, Paul (Julius Gottlieb)" in KILLY, W. und VIERHAUS, R. (Hrsg.), Deutsche Biographische Enzyklopädie, K. G. Saur, München, Band 7, 1998, p. 421.
-
NORWEG, K.H., "Beim Vater des Fernsehens - Was der siebzigjährige Paul Nipkow erzählt", Neues Wiener Journal, Wien, Vom 23. August 1930
-
"Paul Nipkow - überschätzt?" (Diskussionsreihe. T. 4), in FernsehInformationen. Jg. 41. 1990, Nr. 24. S. 731-735.
-
"Paul Nipkow", Wikipedia.de (consulté le 24 décembre 2017).
-
SCHMIDT, C.-D., Paul Nipkow. Erfinder des Fernsehens (1860-1940). Sein Leben für den technischen Fortschritt, Museum in Lebork, 2009. (= Paul Nipkow: wynalazca telewizji (1860-1940) : życie w służbie postępu, Lebork Muzeum, 2009.)
-
SCHRAGE W. "Nipkow still lives !, " Radio Review and Television News, n.2,, Jan-Feb. 1933
-
SCHULZE, H.M., Pioniere der Nachrichtentechnik, 1956.
(14) MAUL, K.L., "Das erste deutsche Fernsehpatent von Paul Nipkow", PC Magazin, 30 Mai 2015.
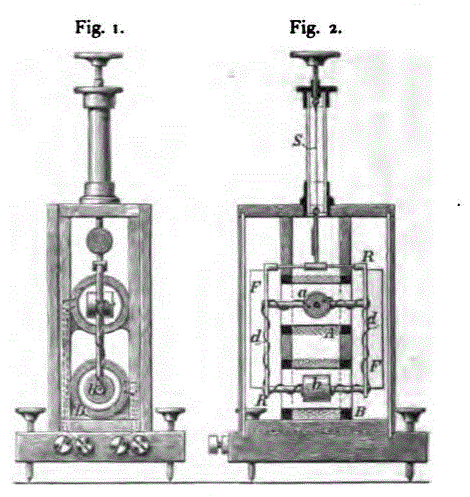
Instrument de mesure du courant alternatif conçu par Paul Nipkow (1889)

Mikrophon mit Wechselstrom im primären Kreis, Patent vom 31.10.1888, Number 47506.
(15) Patentgesetz, Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, Nr. 23, Seite 501–510, Fassung vom:25. Mai 1877 Bekanntmachung:30. Mai 1877, Inkrafttreten:1. Juli 1877. Information aimablement communiquée par Francisco Cabrera, Observatoire européen de l'audiovisuel.

Vorrichtung zur Erziehung gleichzeitiger Dreh-und Längsbewegung einer Spindel, Patent von 20.1.1893 mit Nummer 73311
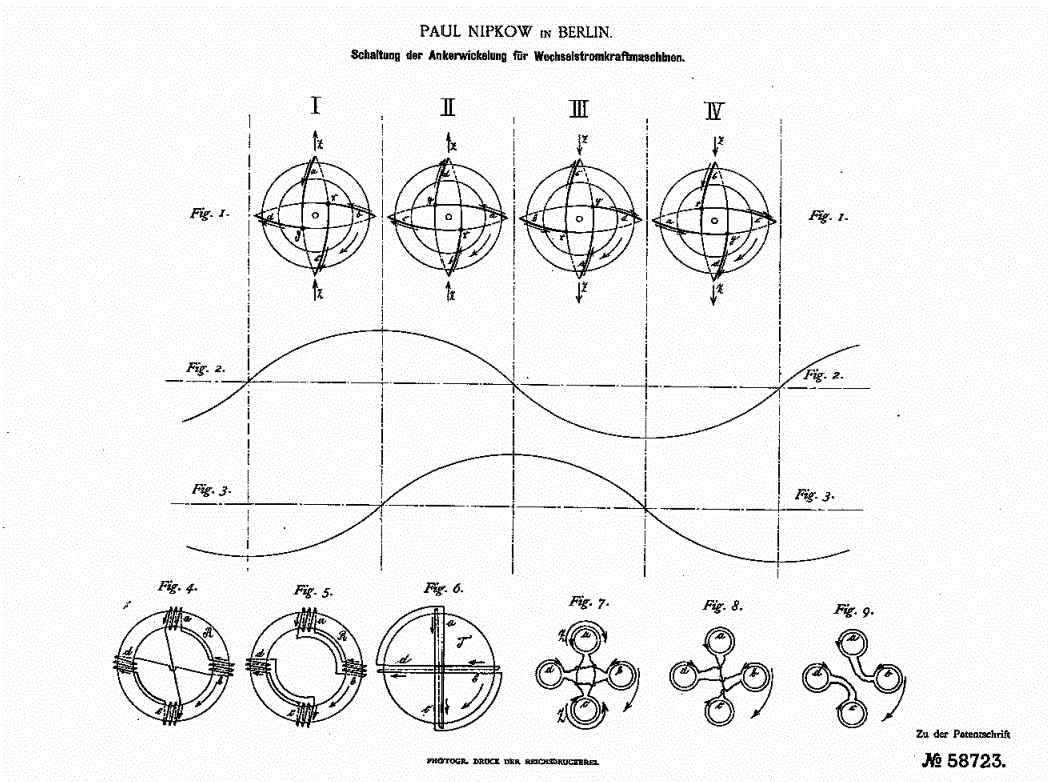
Schaltung der Ankrtwucklung für Wechselstromkraftmaschinen, Patent vom 15.4.1890 mit der Nummer 58723

La libellule de Nipkow - Rad mit beweglichen Schaufeln für Luftfahrzeuge, (Insektenflugzug-Libelle) Patent vom 14.9.1897 mit der Nummer 116287

Graphique du brevet de 1919/1924 sur le cinéma. (Verfahren zum Aufnehmen und Wiedergeben bewegter Bilder unter Verwendung eines stetiglaufenden Bildbandes und eines stetig laufenden Belichtungsgliedesn Patent von 07.01.1924 mit der Number 388005A demande introduite le 22.5.1921)

Paul Nipkow photographié fin 1932 par W. Schrage. (Source : SCHRAGE W. "Nipkow still lives !, " Radio Review andTelevision News, n.2,, Jan-Feb. 1933)

Nipkow et son biographe E. Rhein 1930
2. L'impact de l'invention de Nipkow
3. La glorification de Nipkow par le régime nazi
4. Evocations littéraires et artistiques de Paul Nipkow et de son disque


The Electrical World, 2 January 1886.

SCHRAGE W. "Nipkow still lives !, " Radio Review and Television News, n.2,, Jan-Feb. 1933
(by courtesy of Radio World History)


